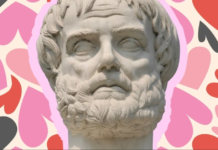La Chine a connu un boom économique massif dans les années 1990 et 2000, qui a accru sa demande d’importations de ressources, comme le pétrole, en provenance d’Afrique. Cela a conduit à un modèle de financement du développement dans lequel la Chine finançait les infrastructures des pays africains en échange d’un accès aux ressources. Cette approche est connue sous le nom de modèle angolais , car tout a commencé avec un partenariat infrastructure-pour-pétrole entre la Chine et l’Angola en 2004.
En une décennie, cependant, un changement d’approche de la Chine s’est avéré nécessaire, pour plusieurs raisons.
Premièrement, les pays africains sont vulnérables aux chocs et ont du mal à suivre le rythme des remboursements croissants de leur dette. Par exemple, dans le cas de l’Angola , le prix du pétrole est passé d’un maximum de 115 dollars américains à moins de 50 dollars américains à la mi-2014. Plus récemment, l’impact des fermetures économiques dues à la COVID-19 et des chocs d’approvisionnement liés à la guerre en Ukraine a fait des ravages.
Deuxièmement, les besoins intérieurs de la Chine évoluent. Ces dernières années, le changement climatique et l’évolution des régimes alimentaires ont exercé une pression sur l’approvisionnement alimentaire national de la Chine. Cela a suscité un intérêt pour des partenariats qui pourraient aider. La Chine s’éloigne également du statut d’exportateur d’industrie lourde et de produits manufacturés à forte intensité énergétique. Il se concentre davantage sur les domaines de croissance, tels que l’agriculture et l’industrie manufacturière à plus forte valeur ajoutée. Sur le plan géopolitique, elle souhaite également soutenir le développement de l’Afrique et sa propre sécurité alimentaire.
Ces changements révèle une relation changeante entre la Chine et l’Afrique, qui va au-delà d’une focalisation principalement sur le pétrole et les matières premières extractives. Le nouvel accent est mis davantage sur la production industrielle, la création d’emplois, les investissements qui conduisent aux exportations africaines et les opportunités agricoles et numériques améliorant la productivité.
Ce modèle, appelé « modèle du Hunan » , doit son nom à la province du sud de la Chine qui mène cette campagne. Les bureaucrates, les chercheurs, les associations commerciales et les entreprises africaines devraient comprendre ce qui se passe au Hunan. Cela les aidera à saisir de nouvelles opportunités et à garantir que les entreprises africaines soient compétitives.
Qu’est-ce que le « modèle du Hunan » ?
Le modèle du Hunan vise à soutenir la Vision 2035 de la coopération sino-africaine en encourageant :
- coopération médicale
- réduction de la pauvreté et développement agricole
- commerce
- investissement
- innovation numérique
- développement vert
- Renforcement des capacités
- échanges culturels et entre les peuples
- la paix et la sécurité.
La réalisation de ces objectifs se déroule sous l’égide de l’ Exposition économique et commerciale Chine-Afrique et d’une zone pilote pour une coopération économique et commerciale approfondie sino-africaine. Les deux sont centrés sur Changsha, la capitale de la province du Hunan.
La province du Hunan a été choisie comme nouvelle frontière des relations sino-africaines, en partie parce que de nombreuses industries chinoises compétitives y sont basées. Il s’agit notamment de grandes entreprises agro-technologiques, d’un leader chinois de véhicules électroniques (BYD Changsha) et d’entreprises d’équipement de fabrication et du secteur de la construction. Beaucoup de ces entreprises ont une présence et une stratégie à long terme sur les marchés africains.
Salon économique et commercial Chine-Afrique
L’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique propose de nombreuses activités et événements organisés dans de grands centres d’exposition. Cela permet de nouer de nouveaux partenariats commerciaux avec rapidité et facilité logistique. Lors d’un événement organisé en 2023, rassemblant 10 000 participants chinois et 1 700 étrangers, il a été rapporté que 120 projets, d’une valeur totale de 10,3 milliards de dollars, avaient été signés. Les 53 pays africains avec lesquels la Chine entretient des relations diplomatiques étaient présents.
Zone pilote
La zone pilote de coopération économique et commerciale approfondie entre la Chine et l’Afrique est une vaste zone qui a été développée dans le but d’élargir le commerce bilatéral, de remédier aux goulots d’étranglement dans le commerce et la coopération et d’améliorer la logistique entre les deux régions. Parmi les exemples de goulots d’étranglement typiques figurent l’accès au marché, les finances, la logistique, les talents et les services tels que le marketing et le droit.
Certaines des initiatives que l’on peut trouver dans la zone pilote comprennent la formation professionnelle et éducative et un centre de services numériques qui soutient les entreprises chinoises dans leurs efforts d’engagement économique en Afrique. La zone comprend une plateforme d’exposition permanente et un parc de démonstration.
Quelques implications du changement
Le modèle du Hunan se concentre spécifiquement sur l’agriculture, les équipements de l’industrie lourde et les transports tels que les automobiles et les trains électriques. Ce sont des domaines dans lesquels le Hunan est un leader en Chine. Et ce sont des industries en croissance dans de nombreux pays d’Afrique.
Pour la Chine, cela pourrait conduire à de nouvelles sources de sécurité alimentaire ainsi qu’à de nouveaux marchés pour les produits technologiques et à des opportunités d’établir des normes technologiques. Cette approche place ainsi l’Afrique dans une position importante pour saisir de nouvelles opportunités et façonner les domaines de coopération connexes – au niveau national, avec la Chine et à l’échelle mondiale.
Le modèle du Hunan vise également à soutenir un commerce plus efficace. De nouveaux passages commerciaux ferroviaires, fluviaux, aériens et maritimes sont en cours de construction pour mieux relier le Hunan aux pays africains, en particulier aux pôles commerciaux.
Des efforts sont également déployés pour résoudre les problèmes d’ accès aux devises et encourager une plus grande utilisation des monnaies locales. À l’heure actuelle, une grande partie du commerce international se fait en dollars américains, car il est largement accepté dans tous les pays. Mais de nombreux pays en développement ont du mal à accumuler des dollars s’ils n’ont pas de produits de base comme le pétrole ou le gaz à exporter. Les petits et moyens commerçants (PME) sont particulièrement confrontés à des difficultés et sont moins en mesure de supporter les risques de change par rapport à la valeur de leur propre monnaie locale. La zone du Hunan comprend un centre qui teste les systèmes de paiement commercial basés sur d’autres devises. Cela pourrait devenir un modèle plus large pour le commerce en monnaie locale des PME.
En fin de compte, le programme chinois pour le Hunan aura des significations différentes pour les différents pays africains et évoluera au fil du temps. Il s’agit d’un changement récent, surtout depuis 2018, mais au-delà de son potentiel à améliorer la sécurité alimentaire et la capacité de production en Chine et dans les pays africains, il y aura d’autres implications importantes. Il pourrait faciliter la logistique numérique et des communications pour le commerce entre la Chine et l’Afrique, ainsi que la recherche sur la technologie, les normes industrielles et commerciales, ainsi que les flux et tendances commerciaux.
Lauren Johnston
Chercheur principal, Institut sud-africain des affaires internationales et professeur agrégé au China Studies Centre, Université de Sydney