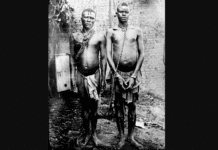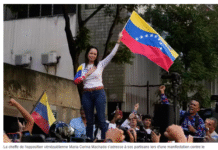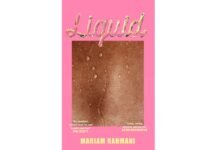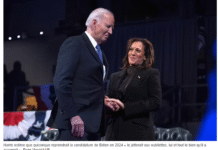Les élections harmonisées de 2023 au Zimbabwe ont été largement décrites comme une bataille entre les deux « grands hommes » – le président Emmerson Mnangagwa du Zanu-PF au pouvoir et Nelson Chamisa du principal parti d’opposition, la Coalition des citoyens pour le changement (CCC). Une attention médiatique considérable s’est concentrée sur les règles du jeu inégales entre le parti au pouvoir et l’opposition.
Les résultats des élections annoncés le 26 août sont contestés en raison d’informations faisant état de retards de vote, d’intimidations d’électeurs et d’irrégularités sur les bulletins de vote. Mnangagwa a été annoncé comme vainqueur officiel du scrutin présidentiel, mais le CCC a rejeté ces résultats .
Une autre préoccupation particulière à cette élection était la forte baisse du nombre de femmes candidates désignées par les principaux partis politiques pour les élections directes.
Nous travaillons sur un projet de recherche de trois ans axé sur la représentation des femmes en politique au Ghana, au Kenya et au Zimbabwe ainsi que sur la violence électorale sexiste. Ce projet cherche à explorer les obstacles à la participation des femmes à la politique en Afrique et les voies à suivre, initialement étudiées dans le livre Gendered Institutions and Women’s Political Representation in Africa .
Le Zimbabwe se classe au bas de l’échelle des mesures de parité entre les sexes en Afrique australe. L’Afrique du Sud, la Namibie et le Mozambique comptent respectivement 46 %, 44 % et 42 % de femmes au parlement. Les partis politiques du Zimbabwe doivent présenter davantage de femmes aux élections directes, en dehors des limites des quotas, afin d’atteindre la parité des sexes.
Quota de genre
La constitution du Zimbabwe de 2013 a introduit un quota de genre pour garantir la représentation équitable des femmes au parlement. Le parlement du Zimbabwe est composé d’une Assemblée nationale (chambre basse) et d’un Sénat (chambre haute). Le quota exige que la chambre basse réserve 60 de ses 270 sièges (22 %) à des représentantes. La chambre haute doit nommer 60 de ses 80 sénateurs à partir d’une liste alternant femmes et hommes, appelée « liste zèbre ».
L’objectif de ce quota est de pousser le pays vers la parité entre les sexes – une représentation 50/50 femmes/hommes – comme le prévoient le Protocole de Maputo de 2003 et le Protocole de 2008 de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement .
Cependant, la représentation des femmes au parlement du Zimbabwe a diminué depuis 2013, malgré les quotas. En 2013, les femmes représentaient 33 % à l’Assemblée nationale et 48 % au Sénat. Seulement 12 % de ces femmes ont été élues directement. En 2018, les chiffres à l’Assemblée nationale et au Sénat sont tombés respectivement à 31 % et 44 %.
Le nombre de femmes candidates aux élections de 2023 a considérablement diminué. Seulement 68 (11 %) des 633 parlementaires aspirants à des élections directes étaient des femmes.
Malgré ces difficultés, 23 femmes ont été élues au Parlement (contre 26 en 2013 et 25 en 2018 ). Les 23 femmes nouvellement élues s’ajouteront aux 60 femmes nommées grâce au quota, soit un total de 83, soit 30,7% de représentation des femmes, à la chambre basse. Après la nomination des sénateurs, comme le prévoit la constitution , le nombre de femmes au sein du Parlement augmentera. Bien que louable, cela place toujours le Zimbabwe en dessous de la moyenne de la région.
Ces gains pourraient ne pas dépasser les 31 % de représentation atteints en 2018 . Les femmes à l’Assemblée nationale représenteront toujours moins de 50 % des parlementaires et disposeront de pouvoirs de décision limités. De plus, il y a peu d’indications sur l’impact substantiel que ces femmes auront sur l’autonomisation des femmes zimbabwéennes, compte tenu de leur nombre limité. Les déficits démocratiques du pays constituent un autre défi important.
Les femmes parlementaires nouvellement élues disposent peut-être d’une marge de manœuvre limitée pour promouvoir l’égalité des sexes dans ce contexte politique. Mais elles restent importantes en tant que décideurs, législatrices et modèles pour d’autres femmes désireuses d’entrer en politique.
Regarder au-delà du quota
Un audit sexospécifique de la liste publiée des candidats désignés aux élections directes révèle que les partis politiques du Zimbabwe n’ont pas présenté suffisamment de femmes pour atteindre la parité des sexes en 2023.
Les données montrent que 633 candidats enregistrés se sont présentés pour 210 sièges au suffrage direct. Parmi ces candidats, 68 seulement étaient des femmes. Autrement dit, seulement 11 % des parlementaires aspirants à des élections directes étaient des femmes. Sur ces 68, le Zanu-PF a présenté 23 femmes (34 %), le CCC en a présenté 20 (29 %) et les 25 femmes restantes étaient issues de petits partis minoritaires (27 %) et de candidats indépendants (10 %).
Lire la suite : Animal Farm a été traduit en Shona – pourquoi un groupe d’écrivains zimbabwéens a entrepris cette tâche
Les provinces de Harare et de Bulawayo ont désigné le plus grand nombre de candidates aux élections. Dans le Mashonaland Central, une seule femme a été nommée dans 18 circonscriptions. Seules deux femmes ont été nommées dans le Matebeleland Sud dans 12 circonscriptions.
Il est important de se demander pourquoi les partis politiques ne présentent pas davantage de femmes aux élections directes. Et ce que cela signifie pour l’avenir de la politique représentative au Zimbabwe.
Préjugés sexistes au sein des partis politiques
Les données ci-dessus indiquent un préjugé à l’égard des candidates qui prévaut dans tous les partis politiques. Hormis les femmes nommées dans le cadre des obligations liées aux quotas, ni le CCC ni le Zanu-PF n’ont présenté suffisamment de femmes pour faire de la parité des sexes une réalité lors des élections de 2023.
L’exclusion active des femmes de la politique est motivée par des préjugés sexistes. Celles-ci s’appuient sur des croyances sociales, culturelles et religieuses ancrées dans des valeurs patriarcales qui considèrent les femmes comme intrinsèquement faibles et indignes de confiance.
La menace et le recours à la violence contre les candidates continuent d’être utilisés pour contraindre et décourager les femmes de se présenter aux élections. Comme le soutiennent les universitaires zimbabwéens Sandra Bhatasara et Manase Chiweshe ,
Le patriarcat, étroitement lié à l’augmentation des masculinités militarisées, produit l’exclusion avec des espaces limités pour la participation des femmes.
Une perception négative est également liée aux « quotas de femmes » dans la mesure où elles n’ont pas été élues par « le peuple ». Ces femmes sont souvent soumises à des négociations patriarcales entre élites . Ils répondent principalement aux besoins de leur parti plutôt que de représenter les femmes zimbabwéennes.
Contrôle d’accès
L’existence d’un système de quotas par sexe donne une façade de progrès. Cela cache la dure réalité selon laquelle ni le CCC ni le Zanu-PF ne sont déterminés à accroître la représentation des femmes en dehors des limites des quotas. Les partis politiques fonctionnent comme des « gardiens des élections ». Ils déterminent le niveau d’inclusion des femmes dans la politique représentative, en dehors du système de quotas.
Le nombre de femmes élues indique que, contrairement aux élections précédentes , les Zimbabwéens semblent plus disposés à voter pour des femmes représentantes. Les partis politiques devraient s’appuyer sur ces modestes acquis et nommer davantage de femmes aux élections. Cela permettra au pays de se rapprocher des objectifs de parité, d’égalité des sexes et de pluralité démocratique.
Shingirai Mtero
Chercheur postdoctoral, The Nordic Africa Institute