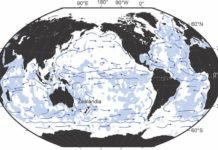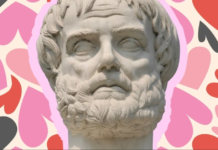La sécheresse de cette année a une fois de plus mis les agriculteurs sous le feu des projecteurs, avec des rendements de certaines cultures en baisse allant jusqu’à 50 %. Mais derrière les gros titres sur les réservoirs vides et les champs dépérissants se cache un problème plus important : la manière dont le système alimentaire britannique est organisé, géré et gouverné.
Depuis des générations, la politique alimentaire britannique privilégie avant tout la stabilité et la stabilité des prix . Cette politique remonte à l’abrogation des Corn Laws en 1846 et à la naissance du libre-échange des céréales. Si cette politique visait à maintenir le prix du pain à un prix abordable, son influence perdure. L’idée que les aliments doivent rester bon marché et à prix stables , souvent au détriment de la résilience face aux chocs climatiques, est profondément ancrée.
Aujourd’hui, cela signifie que les rayons des supermarchés restent pleins et que les prix augmentent plus lentement que dans de nombreux autres pays européens . Mais ce modèle a un coût caché : il affaiblit la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Lorsque des conditions météorologiques extrêmes surviennent, tout le système vacille, et les consommateurs finissent par payer de toute façon.
Le Royaume-Uni produit environ 62 % des aliments qu’il consomme , mais seulement 53 % des légumes frais. Le reste provient des importations, souvent en provenance de régions vulnérables au climat comme l’Espagne, l’Italie et l’Afrique du Nord.
Cette dépendance diversifiait autrefois les risques. Aujourd’hui, lorsque plusieurs régions sont touchées par la sécheresse ou les inondations, les alternatives sont bien plus rares.
Au Royaume-Uni, les supermarchés utilisent des systèmes logistiques « juste à temps », ce qui signifie que les produits sont livrés aux centres de distribution et aux magasins exactement au moment où ils sont nécessaires, avec peu ou pas de stock en réserve.
Ce modèle est conçu pour réduire les coûts et le gaspillage. Pour les denrées hautement périssables comme les fruits et légumes frais, il peut sembler essentiel. Mais il fragilise également le système : lorsque les récoltes sont mauvaises ou que les importations sont retardées, les rayons se vident rapidement.
Le stockage stratégique – qu’il s’agisse de réserves de céréales, de produits surgelés ou de centres régionaux de « chaîne du froid » – pourrait assurer la résilience sans compromettre la fraîcheur des produits à courte durée de conservation.
Actuellement, les agriculteurs livrent leurs récoltes directement des champs aux centres de distribution, ne laissant aucune marge de manœuvre en cas de mauvaise récolte. De plus, les contrats sont souvent à sens unique. Si une récolte ne répond pas aux normes esthétiques strictes ou si un détaillant modifie sa commande , les agriculteurs supportent la perte.
Tout cela signifie que dès que les conditions météorologiques réduisent l’offre, les pénuries se répercutent sur toute la chaîne et le consommateur constate une hausse des prix. En juin 2025, l’inflation alimentaire a atteint 4,5 % en glissement annuel , soit la hausse la plus rapide depuis début 2024 .
Pourtant, le Royaume-Uni jette encore 9,5 millions de tonnes de nourriture chaque année, pour une valeur d’environ 19 milliards de livres sterling. Environ 60 % de cette quantité est gaspillée par les ménages, mais les supermarchés sont loin d’être irréprochables.
Les détaillants jettent plus de 200 000 tonnes de produits frais chaque année, souvent parce qu’ils ne répondent pas aux normes strictes d’apparence. Les agriculteurs signalent devoir retourner en terre des récoltes parfaitement comestibles lorsque des contrats sont annulés en raison de prévisions de demande erronées.
Ce n’est pas seulement mauvais pour l’environnement, cela compromet aussi la sécurité alimentaire . Alors que les agriculteurs peinent à produire leurs récoltes, l’idée qu’un tiers de la nourriture soit perdue ou gaspillée dans le monde illustre la mauvaise gestion du système.
Les attentes des consommateurs doivent-elles changer ?
La vérité dérangeante est que la résilience peut signifier moins de prévisibilité. Le modèle actuel protège les consommateurs des variations saisonnières en répartissant les risques tout au long de la chaîne, généralement sur les agriculteurs ou les producteurs étrangers. Mais cela se fait au détriment de la stabilité à long terme.
Si, au contraire, les consommateurs acceptaient que les prix puissent fluctuer davantage à court terme – reflétant le coût réel des chocs climatiques –, les chaînes d’approvisionnement pourraient être repensées pour être résilientes. Les agriculteurs pourraient être rémunérés équitablement pour investir dans l’adaptation, et les distributeurs pourraient privilégier les contrats sûrs aux importations les moins chères.
À long terme, cela protégerait les ménages des pics de prix plus dommageables causés par une défaillance du système. Cependant, les ménages à faibles revenus consacrent déjà une part bien plus importante de leurs revenus à l’alimentation. Les hausses de prix à court terme doivent donc s’accompagner d’un soutien public ciblé pour lutter contre l’insécurité alimentaire.
Alors, à quoi ressemblerait un système alimentaire plus sûr ? D’après mes recherches , trois changements se démarquent.
1. Des réseaux locaux renforcés : Investir dans des pôles régionaux de transformation et de stockage permettrait de mieux connecter les produits alimentaires d’Écosse, du Pays de Galles, d’Irlande du Nord et d’Angleterre et de réduire la dépendance aux importations. Le gouvernement devrait financer les infrastructures et l’aide à la planification, les distributeurs devraient s’engager dans des contrats à long terme qui rendent les pôles locaux viables et les producteurs pourraient collaborer pour partager leurs installations.
2. Des contrats plus équitables : Il est nécessaire d’améliorer le partage des risques entre les agriculteurs, les transformateurs et les supermarchés afin qu’une mauvaise récolte ne ruine pas les producteurs. Actuellement, les distributeurs détiennent l’essentiel du pouvoir, fixant souvent des normes strictes et annulant les commandes à court terme. Mais si les agriculteurs continuent d’assumer tous les risques, nombre d’entre eux pourraient quitter le secteur, laissant les distributeurs avec moins de choix et une plus grande volatilité.
3. Une politique valorisant la résilience : le gouvernement devrait soutenir les producteurs dans leur adaptation à long terme, notamment en favorisant des cultures résistantes à la sécheresse et en gérant l’eau. C’est une meilleure stratégie que des subventions ponctuelles après chaque crise, comme c’est le cas actuellement.
La sécurité alimentaire est une question de sécurité nationale. Pourtant, au Royaume-Uni, elle est encore traitée comme une question de prix hebdomadaires. Chaque sécheresse, inondation ou vague de chaleur révèle la même fragilité : un système conçu pour fournir des aliments bon marché aujourd’hui, mais incapable d’absorber les chocs de demain.
Si les consommateurs souhaitent une alimentation abordable à long terme, il est temps de cesser de se demander comment maintenir les prix bas et de se demander comment garantir la sécurité des approvisionnements alimentaires. Cela implique un traitement plus équitable des agriculteurs, une utilisation plus judicieuse des ressources et des consommateurs prêts à accepter une certaine volatilité des prix à court terme. Sinon, la prochaine mauvaise année ne sera pas l’exception, mais la règle.
Manoj Dora
Professeur en production et consommation durables, Université Anglia Ruskin