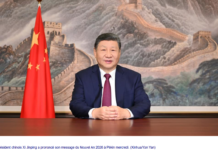Obtenir, à force de supplications, la convocation du Conseil de sécurité de l’ONU sans avoir, en coulisses, scellé un deal garantissant que tous « les maîtres du monde », la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, voteraient à l’unanimité des sanctions contre le Rwanda relevait davantage du numéro de cabaret populiste que de la diplomatie. En clair, des shows émotives mais ratés pour les Congolais. En plus, la RDC n’a pas à collectionner des amitiés en toc ni mendier la pitié ; elle devrait plutôt chercher à forger une alliance solide ou disons de signer un pacte costaud avec une puissance qui a de vrais muscles.
Cependant, il est inexact d’affirmer que je soutiens la fameuse lettre de Félix Tshisekedi adressée à Donald Trump, un « veux‑tu m’épouser ? » au lieu de « veux-tu être mon parrain ? ». On frôle là le grand écart idéologique. Une telle démarche s’écarte radicalement de mes positions et illustre, une fois de plus, la tendance à externaliser les leviers de développement économique de la RDC. À vouloir se hisser au rang de favorite maitresse favoris de l’Oncle Sam et brader nos propres leviers de souveraineté, on confond attraction et dépendance. Il ne s’agit, en réalité, que d’une proposition qui initierait une nouvelle phase de « DE-CONGOLISATION » de l’avenir économique du pays.
Au premier roulement de tambour orchestré par Washington, la réponse de l’administration Trump à la lettre de Tshisekedi, on a d’abord cru voir se profiler l’intention d’esquisser un élégant « ménage à trois ». L’idylle a pourtant viré très vite au feuilleton façon Will Smith‑Jada Pinkett, un « entanglement » si confus qu’on ne sait plus qui nous enlace ni qui finit par gifler l’autre. Au fil du temps, une véritable orgie géopolitique se dessine et prend forme. L’Oncle Sam semble prêt à ouvrir grand les portes pour convier ses potes tels que la France et le Qatar à se joindre aux réjouissances, tandis que Kigali, à domicile, fournirait le décor et réglerait la playlist. Au centre de la piste, la RDC va tourbillonner sous les projecteurs, un partenaire officiellement consentant, mais qui en réalité sera malmené dans cette danse où les coups de coude pleuvent bien plus que les pas de valse.
Mais au‑delà de cette image agaçante pour certains Congolais, acceptable pour d’autres qui y voient le prix d’une paix illusoire, il faut examiner de plus près pourquoi Washington emprunte une trajectoire différente de celle des autres arbitres, alors même que cette démarche semble vouée, in fine, à mener au même dénouement humiliant pour Felix Tshisekedi.
Deux langues, deux systèmes d’écriture !
À première vue, la différence la plus visible entre les Congolais et les Rwandais tient à la langue. La RDC reste farouchement francophone, tandis que le Rwanda est anglophone tout en gardant un vernis de français. Pourtant, le vrai fossé relève moins des mots que des motivations profondes des deux régimes. Une différence aussi marquée, pour qui la parcourt, que celle séparant l’amharique du cantonais.
Pour le régime rwandais, l’objectif primordial consiste à générer de la croissance économique, par tous les moyens. Sa priorité est donc fondamentalement de nature politico‑économique. La minorité Tutsi au pouvoir doit maintenir un rythme de croissance suffisant, on une capacité plausible dans ce sens, pour préserver le délicat compromis qui la permet de rester aux commandes sous le regard tolérant de la super majorité Hutu. Faute de capital et de ressources humaines en nombre à la hauteur de cet obligation, Kigali mise sur l’efficacité ses muscles. Sa force militaire est donc structurée comme un levier commercial, celle‑ci s’exporte sous l’étiquette du « maintien de la paix », contingents à la MONUSCO, missions de chien de garde pour les investissements miniers des Européens au Mozambique, et sert de bélier pour imposer l’agenda économique du Rwanda dans la région, notamment en RDC.
À Kinshasa, le pouvoir se dispense de toute feuille de route économique digne de ce nom ; depuis l’indépendance, un tribalisme débridé tient lieu de collectivisme, infiltrant chaque recoin de la sphère publique. Dans un tel écosystème, les dribbles et jongleries politiques se pratiquent dans leur expression la plus brutale pour garantir la simple survie du régime. La gestion quotidienne relève dès lors davantage de l’improvisation à court terme que d’une planification stratégique. Pendant ce temps, la population, prise en otage de ces luttes de clans, voit ses aspirations sociales et économiques reléguées au second plan. Et donc, pour maintenir sous hypnose une population massivement pauvre et sous‑employée, la propagande joue la flûte d’enchanteur. Chaque camp reste irrationnellement et parfois inconsciemment retranché derrière ses clivages tribaux, tandis que le discours officiel recycle, au besoin, un bouc émissaire pour détourner l’attention des démangeaisons socio-économiques.
C’est ainsi qu’après avoir décrypté les besoins et motivations opposés des deux capitales, l’administration Trump leur a donné un devoir à domicile de rédiger des revendications destinées à flatter leurs opinions publiques respectives. Présentée, avec une pointe d’ironie, comme une formule « perdant‑perdant », l’initiative menace désormais de se transformer en véritable marché de dupes. Chacun hesite d’y laisser des plumes faute de concessions réciproques, lestés des revendications qu’ils traînent comme des casseroles et soumise aux pressions des autres nations agissant en arrière‑scène.
La beauté est dans les yeux de celui qui la regarde
Donald Trump vient d’obtenir la libération d’un soldat américano‑israélien détenu par le Hamas, sans même en avertir celui qu’il pensait pourtant être un proche allié, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a découvert la nouvelle en même temps que tout le monde et l’a plutôt mal accueillie. Dans la foulée, il a accepté de recevoir du Qatar un avion d’une valeur d’environ 400 millions de dollars.
Pendant ce temps, la Maison‑Blanche accélère l’asile de riches Sud‑Africains blancs riches, qualifiés sans broncher de « réfugiés », tout en verrouillant la porte aux migrants moins fortunés et expulser les autres se trouvant déjà sur le sol américain vers des pays qui n’étaient pas les leurs. Cette politique, soupçonnent certains, porterait la marque d’Elon Musk, Américain d’origine sud‑africaine, issu d’une famille enrichie sous l’apartheid, et, dit‑on, contributeur de plus de 200 millions de dollars à la campagne de Donald Trump, aujourd’hui l’homme le plus riche du monde.
De manière générale, les priorités d’une administration républicaine, la boussole reste invariablement calée aux pétrodollars et contrats d’armement à plusieurs zéros. Ni la RDC ni le Rwanda ne sont en mesure d’apporter de telles sommes à la table des négociations ; leurs ressources ou leurs commandes militaires potentielles restent trop limitées pour constituer un levier d’influence durable. S’ajoute à cela la sécession économique de l’ancien Katanga, puis la cession des portions les plus rentables de l’ancienne Province Orientale, sous Joseph Kabila, qui a réduit les marges de manœuvre pour toute nouvelle « DE-CONGOLISATION » des richesses naturelles congolaises au profit des entreprises et multinationales entièrement américaines. Quant au reste du territoire à l’Est, c’est un terrain grouillant de serpents, de fourmis rouges, de moustiques, d’abeilles et même de cafards, autant de métaphores pour désigner la multitude de groupes armés qui y prolifèrent.
Ce qui complique encore davantage l’équation, c’est que la RDC excelle dans les feuilletons à rebondissements. Dans les années 1960, le Katanga et le Kasaï ont fait sécession ; au début des années 2000, le pays s’est encore retrouvé morcelé en quatre entités avant d’être recollé à la hâte par l’accord « 1 + 4 ». À chaque crise, les voisins imaginent un divorce définitif, mais quelques jours plus tard ils nous découvrent, verre levé, en train de danser la rumba, main dans la main. Souvent chauffés par des marionnettistes extérieurs avides de profits, les Congolais peuvent aller jusqu’à s’étrangler, parfois tragiquement ; pourtant, tôt ou tard, ils recollent les morceaux et relancent la saga pour une nouvelle saison d’amour.
Dans ces conditions, l’intérêt stratégique pour Washington de s’engager militairement ou politiquement dans le conflit entre Kinshasa et Kigali est jugé insuffisant. Plutôt que de déployer des forces ou d’impliquer des décideurs de premier plan, on délègue à petit ce dossier délicat à quelques amis rétrogradés, condamnés à patauger dans ce bourbier géopolitique des Nègres.
Glaces déformantes
On pourrait se raconter que le déficit de crédibilité de Félix Tshisekedi ou le nombre des collines de scandale financier sous son règne découragent les investisseurs qui ont Donald Trump dans leur poche, mais ce ne serait qu’une illusion. Certes, tant que l’exécutif congolais n’offrira ni visibilité institutionnelle ni garanties contractuelles solides, toute injection massive de capitaux en RDC restera, sur le papier, un pari à haut risque : la prime exigée pour couvrir l’incertitude rendrait la future rente minière difficile à négocier autrement qu’à prix de liquidation. Pourtant, ces « cowboys » ont l’habitude de miser gros ; le risque, fût‑il élevé, ne les effraie pas autant qu’on pourrait le croire.
L’échéance présidentielle américaine de 2028, qu’elle confronte J. D. Vance à Alexandria Ocasio‑Cortez ou tout autre duo, ne devrait pas bouleverser cette équation. La posture africaine de Washington reste structurée par la doctrine du « minimal engagement » : contenir les risques politiques majeurs, sécuriser les flux de minerais critiques et déléguer la conflictualité à des acteurs régionaux. Tant que cette matrice demeure, le jeu congolais reste cantonné aux marges.
Le mandat théorique de Tshisekedi s’achèvera à la même échéance, mais la distribution pressentie, qu’il s’agisse de Katumbi, Fayulu, d’un éventuel retour de Kabila ou même un de ses disciples comme Corneille Nangaa, ne bouleversera pas l’équation. Ces ténors du courant conservateur proprement congolais, entretiennent idéologiquement la « DE-CONGOLISATION » structurelle des fibres vitaux l’économie congolaise ; la matrice politique reste fondamentalement rentière, imperméable à toute dynamique réformatrice.
Viva la revolución ?
La véritable angoisse, à Washington comme à Kigali, n’est donc pas le départ du président Tshisekedi, mais l’irruption de la franche libéral au sens congolais du terme qui canaliserait la soif de dignité autour d’une stratégie de « RE-CONGOLISATION » de l’économie nationale, et donc rapatrier les marges, imposer un contenu local élevé et renégocier les clauses de stabilisation. Autrement dit, appliquer la grammaire trumpienne du « America First », mais dans une version « Congo d’abord » qui mettrait au défi les conventions internationales et de rebattre toutes les cartes régionales à la manière de Donald Trump qui bouscule l’ordre établi sans excuse.
En claire, tous traités, protocoles et feuilles de route court le risque de devenir des lettres mortes si les Congolais osait de façonner et s’imposer un nouveau langage, un lexique de souveraineté économique, en plus d’un nouveau système d’écrire de son développement qui prioritiserait de faire du Congolais « L’ETRE SOLUTION » plutôt que de vendre la RDC comme simple « PAYS SOLUTION », au lieu de recycler à l’infini les dialectes clientélistes et les slogans identitaires ou tribaux.
Dans ce contexte, et au regard de toutes les manœuvres en cours, l’enjeu du scrutin de 2028 devient brûlant. Il appartiendra aux Congolais de choisir entre rompre définitivement avec le schéma économique politique actuel ou le reconduire une fois de plus. La suite dépend moins des maitres du monde que du degré d’audace réformatrice ou d’adhésion au statu quo que la société congolaise choisira d’adopter et d’assumer.
Wait and see…
Jo M. Sekimonyo
Économiste politique, théoricien, militant des droits des humains et écrivain