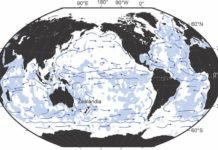L’accord de paix présenté à Washington le 4 décembre 2025 installe d’emblée un malaise silencieux au sein de l’opinion congolaise. Beaucoup s’interrogent, presque à voix basse, sur la nature réelle de ce moment qui oscille entre réédition historique, obstination politique et retour mécanique des mêmes erreurs structurelles. Au lieu d’un acte souverain mûri par une réflexion nationale, la scène qui se déroule apparaît comme un rituel diplomatique entièrement scénarisé. La délégation congolaise, si volumineuse qu’elle finit par se dissoudre dans le décor, se comporte moins comme une équipe négociatrice que comme une troupe chargée d’alimenter en continu le spectacle numérique destiné aux réseaux sociaux.
Les gestes, les déclarations, les cadres vidéo, le président apparaît, entouré d’une foule mais étrangement isolé, comme s’il posait un acte dont il pressent lui-même la fragilité. Son visage ne renvoie ni triomphe ni assurance, mais la lourde hésitation d’un pouvoir qui sait que la nation est fatiguée des signatures qui promettent la fin d’un cycle sans jamais en interrompre la mécanique. Tout dans l’atmosphère respire une volonté de maîtriser l’image plutôt que la substance.
Ce prétendu tournant n’est en réalité que la répétition d’un épisode que l’on feint d’oublier. En 2002, Kabila et Kagame signent déjà un accord sous l’œil de George W. Bush, et dès le lendemain la guerre se recompose. Le RCD-Goma reste en place, le CNDP surgit, puis le M23 renaît en 2012 sous le même prétexte sécuritaire fabriqué à Kigali. Autour gravitent les FDLR, les RUD-Urunana, le P5 et une galaxie de Mai-Mai qui entretiennent un système de conflits par procuration où le Rwanda endosse simultanément les rôles d’arbitre et de bénéficiaire. La seule accalmie porte la marque de la défaite imposée au M23 avec l’appui décisif de la brigade tanzanienne, qui le repousse vers l’Ouganda. Mais la matrice de la violence, elle, a demeuré intacte, toujours prête à se réactiver à la moindre fissure d’excuse ou à la mutation de l’appétit géopolitique des parrains régionaux.
La région ne cesse jamais d’être le terrain d’interventions indirectes et de stratégies de nuisance économique, mais la véritable question est de comprendre comment nous en sommes revenus à l’audace insensée de transformer, une fois encore, la RDC en champ d’abattage. Aujourd’hui, la guerre se réduit à une querelle personnelle opposant Tshisekedi à Kagame ou, selon les saisons politiques, à Kabila, tandis que les enjeux nationaux s’effacent derrière des rivalités d’hommes qui se disputent le pouvoir comme une propriété privée. Naanga, Katumbi et Fayulu, en décrivant désormais la crise comme une simple vendetta interne, ne font que mettre à nu ce dérèglement profond. Et pendant que ces egos s’affrontent, se réconcilient, puis replongent dans les mêmes antagonismes, ce sont les Congolais qui meurent, toujours au même rythme, toujours sous les mêmes couteaux.
La Boîte de Pandore
L’un des angles morts les plus déterminants de cette crise réside dans la manière dont Tshisekedi conçoit simultanément la nation et l’usage du parti politique comme instrument de pouvoir. En refusant de rompre avec les logiques identitaires qui rongent l’État depuis des décennies, il gouverne comme si la RDC n’était qu’un empilement de communautés à apaiser, équilibrer ou instrumentaliser, transformant chaque acte de gouvernement en arbitrage tribal plutôt qu’en décision d’État. Dans le même mouvement, il réduit sa formation politique à une mécanique élémentaire de conquête et de préservation du pouvoir, où l’allocation des faveurs, la récompense des loyautés et le contrôle des allégeances deviennent la matrice quotidienne de la gouvernance. Cette double approche, ethnocratique dans la vision du pays et patrimoniale dans la pratique politique, dissout toute idée de corps collectif. La nation cesse d’être une entité dotée d’une volonté commune ; elle se morcelle en une mosaïque de susceptibilités que l’on gère au lieu de diriger, ce qui érode lentement sa capacité de projection, de cohésion et de stabilité durable.
À cette lecture identitaire et politique s’ajoute une erreur idéologique tout aussi corrosive. Dès le premier jour, Fortunat Biselele, alors tout-puissant conseiller privé, affirmait que pour Tshisekedi la priorité absolue du pays devait être l’attraction du « capital financier », comme si ce seul afflux pouvait constituer à lui seul la fondation de la reconstruction nationale. Cette vision réductrice de l’économie politique a rapidement pris valeur de doctrine, au point de légitimer l’idée d’un rapprochement tacite avec Kagame, dans l’espoir que cette proximité rassurerait les bailleurs internationaux et offrirait la stabilité que le Congo ne parvient pas à produire. La réalité s’est révélée implacable. Aucun capital n’est venu, aucune confiance n’a été gagnée, et cette orientation stratégique a fini par coûter des milliers d’âmes congolaises, jeunes et vieilles, tout en décourageant durablement tout investissement sérieux. Elle a aussi englouti nos maigres ressources financières dans un effort de guerre qui ne produit ni sécurité ni avenir. La RDC n’a pas attiré les investisseurs qu’elle imaginait ; elle a payé en sang et en ruine le prix de cette illusion économique.
Dans ce parcours, Tshisekedi a surtout cherché à se démarquer de son prédécesseur, Joseph Kabila, mais son obsession d’apparaître comme « meilleur » s’est rapidement réduite à vouloir être simplement « moins pire », ce qui l’a enfermé dans une gouvernance de réaction et d’effacement. Chaque faute devait être perçue comme passagère, chaque crise devait être oubliée plutôt que corrigée, comme si l’amnésie constituait une méthode de gouvernement. La politique nationale s’est ainsi transformée en une compétition implicite pour être « un peu moins détesté » que Kabila, plutôt qu’en un projet sérieux de transformation de l’État. Cette logique du moindre mal a engendré une gouvernance pâle, hésitante, et structurellement incapable de rompre avec le socle pathologique du pouvoir qu’elle prétendait dépasser.
Le non-dit qui menace tout l’édifice
Du côté congolais, la question de la légalité de l’accord plane comme une ombre que l’on s’efforce d’ignorer. Un président peut négocier, mais il ne peut ni engager la nation dans un traité international ni en exécuter les clauses sans l’aval du Parlement. Ce principe, élémentaire dans toute démocratie digne de ce nom, semble pourtant avoir été traité à Washington comme une formalité désuète. L’opacité qui entoure les clauses économiques et sécuritaires, l’absence de communication institutionnelle et le silence obstiné autour des implications réelles de l’accord donnent l’impression d’un acte posé en marge du cadre constitutionnel, dans un espace politique où la légalité se tord dès qu’elle contrarie l’agenda du pouvoir.
Plus inquiétante encore est la dynamique profonde qui affleure derrière la surface juridique, faite d’humiliations économiques accumulées et de désirs de revanche qui finissent par orienter les choix politiques. L’histoire offre de nombreux exemples où des nations forcées d’accepter des accords déséquilibrés ont entretenu une rancœur qui, tôt ou tard, s’est transformée en conflit ouvert. Le Japon, contraint d’ouvrir ses ports sous pression américaine avant de frapper Pearl Harbor plusieurs décennies plus tard, illustre cette mécanique où l’humiliation initiale se mue en retour de flammes. La France et l’Allemagne ont connu le même engrenage pendant plus d’un siècle, chacune astreinte à des punitions économiques qui, loin d’apaiser les tensions, ont nourri un désir persistant de revanche. Avec Washington et Doha comme théâtres de nos arrangements actuels, tout arrangement économique vendu comme clé de la fin de la guerre porte déjà les germes de futurs ressentiments. La RDC ne peut prétendre s’extraire de cette logique. Tout accord imposé ou accepté sous contrainte crée un besoin latent de revanche, et ceux qui signent aujourd’hui ne mesurent pas toujours les passions profondes qu’ils réveillent.
Comparer 2002 et 2025 révèle combien ce retour cyclique est désormais plus dangereux qu’il ne l’était il y a vingt ans. En 2002, le pays sortait d’une guerre continentale et tentait encore de redevenir un État. L’espoir, même fragile, ouvrait un espace pour des compromis encore possibles. En 2025, l’État existe, mal structuré mais réel, et la fatigue sociale est immense. Imposer un accord dont les implications économiques restent floues revient à fabriquer du ressentiment durable, et donc un conflit en gestation. Une population qui a tout perdu et n’a rien reçu en retour n’avale plus les promesses ; elle les transforme en colère.
Le plus alarmant demeure toutefois l’installation progressive de la paranoïa comme méthode de gouvernance. La méfiance généralisée, les obsessions sécuritaires, la personnalisation extrême de l’État et la confusion permanente entre critique et menace ont transformé chaque désaccord en affrontement. Au lieu d’apaiser, le deal de Washington risque d’alimenter une spirale d’auto-défense politique où chaque camp instrumentalise la peur pour consolider son emprise. Dans un tel environnement, l’accord de paix devient paradoxalement un accélérateur de tension. Il n’apaise rien ; il arme les soupçons. Et une sous-région enfermée dans la suspicion finit toujours par produire le conflit qu’elle prétend conjurer.
Le choix de l’inertie nationale
Le Plan Sekimonyo, ce plan Marshall pour l’Est de la RDC pour ceux qui voulaient un titre aux accents américains, était une proposition formulée il y a plus d’une décennie pour traiter cette région comme un territoire prioritaire, à stabiliser et à transformer en véritable laboratoire national. Ce projet, né d’une simple lucidité, rappelait qu’aucune paix durable n’est possible tant que les causes profondes de la violence demeurent intactes, en particulier la pauvreté endémique et le sous-développement structurel. Ceux qui souffrent aujourd’hui sont les mêmes qui, hier, ont ignoré ou méprisé cette voie. J’imagine encore Vital Kamerhe, alors directeur de cabinet, jetant mes lettres de mise en garde comme si l’inertie suffisait à gouverner. La même inertie est réapparue lors de la bataille sur l’inconstitutionnalité de la loi électorale, construite sur la marginalisation socioéconomique et la consolidation d’un pouvoir oligarchique. Les plus vulnérables, jeunes et femmes en tête, ne se sont pas mobilisés, persuadés que l’injustice ne viserait que d’autres qu’eux. Nous en payons aujourd’hui le prix, avec une démocratie affaiblie et des institutions qui reproduisent la même élite au lieu de se renouveler.
La République Démocratique du Congo porte la démocratie dans son nom mais rarement dans son fonctionnement. La solution ne s’est jamais trouvée dans un partage des postes arrangé entre l’élite politique et les groupes armés autour d’une table ronde, ni dans des négociations discrètes entre la RDC, les voisins et les multinationales dans un salon feutré à Washington, Luanda ou Doha. La sortie du cycle ne peut émerger qu’à travers une refonte de notre ADN de l’économie politique, une réécriture de notre contrat social et de notre pacte national, menée non par les mêmes acteurs qui se repassent l’État depuis vingt ans, mais avec la population qui en porte encore les cicatrices. Le cœur du problème se situe ailleurs. Le pays continue de croire qu’il affronte une crise sécuritaire ou politique, alors que la racine est profondément socioéconomique. La pauvreté endémique et le sous-développement constituent la matière inflammable du conflit. Tant que ces réalités sont dissimulées derrière des récits sécuritaires, la science et la raison publique demeurent des décors plutôt que des boussoles, et chaque crise se rejoue de la même manière, avec une poignée de puissants qui négocient entre eux pendant que l’ensemble du pays s’enfonce.
Le véritable problème dans ces négociations, aujourd’hui comme hier, est que l’on court derrière une paix durable sans jamais chercher à rendre la guerre impossible, avec la dignité et la souveraineté que d’autres nations de la région, comme le Burundi ou encore l’Ouganda et la Tanzanie, ont su imposer au Rwanda. Cette confusion entretient une mécanique bien connue, celle où la répétition finit par tenir lieu de gouvernance. À chaque secousse nationale, on se contente de poser un pansement sur une plaie béante, en espérant que le temps accomplira ce que le courage politique refuse d’assumer. Rien n’évolue tant que l’on évite d’assainir le terreau politique qui permet à des entrepreneurs de crise de dresser Congolais contre Congolais sans remords ni sanction. Dans ces conditions, l’accord de Washington n’est pas le véritable enjeu ; le problème réel réside dans l’écosystème qui l’absorbe, un environnement saturé de manipulation, de peur et d’impunité, et dans notre ethnocratie, un système où même les intentions les plus sincères se dégradent avant d’avoir produit le moindre effet.
Dans un sol ainsi empoisonné, la paix n’est qu’une trêve, une illusion temporaire, une parenthèse qui se fissure dès qu’on la regarde de près. Sans assainissement profond, toute paix se réduit à un sparadrap posé sur une gangrène que l’on refuse de traiter. La question n’est donc plus de savoir si cet accord échouera, mais combien de temps il mettra avant de se décomposer entre les mains de ceux qui prétendent l’avoir signé au nom de la nation.
Jo M. Sekimonyo, PhD
Économiste politique, théoricien, militant des droits humains et écrivain. Chancelier de l’Université Lumumba.