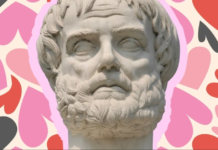Lorsque l’Éthiopie annonça en 2011 la construction du « Grand Ethiopian Renaissance Dam », le pays comprit immédiatement qu’il devrait avancer seul. Les institutions comme le FMI, la Banque mondiale ou les banques régionales refusèrent de soutenir le projet. Cette décision ne reposait pas sur une analyse technique mais sur l’intense pression diplomatique exercée par l’Égypte, qui percevait le barrage comme une menace stratégique pour ses intérêts hydriques. L’Éthiopie se retrouva isolée, sans accès aux financements internationaux traditionnels. Au lieu d’abandonner, elle choisit de transformer cet isolement en acte de souveraineté. Elle décida que le plus grand barrage d’Afrique serait financé et contrôlé par les Éthiopiens eux-mêmes.
Cette posture donna naissance à l’un des montages d’autofinancement les plus audacieux du continent, un système qui rappel la manière dont plusieurs pays européens avaient financé leurs armées pendant la Première Guerre mondiale. Le barrage, évalué à 233 milliards de birrs, soit environ 4,2 milliards de dollars, aurait pu rester un mirage dans un pays privé de bailleurs et cerné par les pressions internationales. Pourtant, l’Éthiopie choisit de le financer elle-même et parvint à mobiliser 213 milliards de birrs, près de 4 milliards de dollars, uniquement grâce à ses ressources internes, ce qui représentait 91 % du financement total. Les banques commerciales furent contraintes d’acheter des obligations, les salariés acceptèrent une retenue sur salaire, l’épargne populaire fut mobilisée, et une vaste participation nationale porta le chantier. Les 9 % restants, un peu plus de 20 milliards de birrs, environ 450 millions de dollars, provenaient de la diaspora éthiopienne, des ventes d’obligations dédiées au barrage. Cette répartition démontre que le barrage n’était pas seulement une infrastructure stratégique, mais aussi un acte collectif financé presque entièrement en monnaie locale.
L’architecture financière reposait sur un principe simple qui expliquait sa résilience. Tout ce qui pouvait être payé localement l’était en birrs éthiopiens. Plus de 90 % des débours étaient effectués dans la monnaie nationale, ce qui protégeait les réserves officielles en devises. Les paiements en devises se limitaient aux besoins indispensables, dont environ 1 milliard de dollars pour les équipements électromécaniques financés par une ligne de crédit chinoise. Cette stratégie permit à l’Éthiopie de gérer un projet colossal pendant quatorze ans, entre 2011 et 2025, et lui permit aussi de résister aux pressions extérieures et de mener à terme un chantier perturbé par des tensions géopolitiques et par un scandale interne. Le résultat est le plus grand barrage d’Afrique, opérationnel depuis le 9 septembre 2025, financé principalement par l’effort national, sans dépendance toxique vis-à-vis des bailleurs internationaux.
Un pays qui manque de ce qu’il possède
La RDC occupe une place singulière dans le paysage énergétique mondial. Aucun autre pays ne détient un potentiel hydroélectrique capable, en un seul site, de générer autant de puissance que plusieurs nations réunies. Pourtant, cette richesse colossale cohabite avec une pauvreté énergétique presque totale. À peine 19% des Congolais accèdent à l’électricité, tandis que les autres oscillent entre obscurité et générateurs bruyants. La scène surréaliste de l’aéroport plongé dans le noir au moment où le président devait atterrir, suivie de sanctions précipitées contre quelques responsables, tient moins de la solution que de la mise en scène, un moyen commode de remplacer les exécutants sans jamais toucher aux structures qui produisent la panne. Ainsi, un pays potentiellement géant de l’énergie continue de vivre comme s’il en était dépourvu.
Cette contradiction prend racine dans l’état désolant d’Inga I et d’Inga II, deux barrages censés être l’épine dorsale du système électrique mais réduits à des vestiges d’un potentiel jamais réalisé. Conçus pour délivrer 1 775 mégawatts, ils peinent à dépasser 800 mégawatts tant les turbines hors service, les équipements rongés par le temps et les lignes abandonnées grignotent la production. Jusqu’à 40% de l’énergie disparaît dans les pertes techniques, un niveau qui relève davantage du gaspillage institutionnalisé que d’un simple problème technique. La SNEL, chargée de maintenir ce réseau, oscille entre faillite et paralysie. Le pays manque tragiquement de la capacité de produire ce qu’il possède déjà.
Cette situation exige un choix stratégique. Le Grand Inga, avec ses 40 000 mégawatts, relève aujourd’hui du mirage. Il exigerait un réseau national inexistant, une gouvernance stable et des investissements que le pays ne peut absorber. À l’inverse, Inga III, avec 4 800 à 11 000 mégawatts selon la version retenue, est une ambition réaliste, surtout si l’on mène en parallèle la réhabilitation d’Inga I et II, dont la remise en état permettrait déjà de générer des devises capables de couvrir les importations indispensables pour les équipements que le pays ne peut pas fabriquer. Inga III et la rénovation des installations existantes suffiraient à combler le manque actuel d’énergie et à lancer une modernisation crédible. La priorité n’est pas la démesure, mais l’efficacité.
Il faut aussi rappeler que la RDC ne dispose pas d’un réseau capable d’acheminer l’électricité qu’elle produit. La plupart du pays n’est pas connectée au système national, aucune ligne à haute tension ne relie l’Ouest au centre ni à l’Est, et chaque province fonctionne en circuit isolé. Le peu qui circule se perd massivement, avec des pertes techniques énormes. Tant que le réseau restera fragmenté, mal entretenu et sans réforme profonde de l’opérateur public, les Congolais vivront dans l’obscurité, même avec un barrage flambant neuf.
Réparer et construire Inga sans s’agenouiller
La remise en état d’Inga I et II représente un investissement relativement modeste à l’échelle nationale, entre 700 et 900 millions de dollars selon l’ampleur des travaux, somme suffisante pour restaurer plus de la moitié de la capacité perdue et relancer les exportations. La construction d’Inga III, selon la version retenue, nécessite 16 à 20 milliards de dollars, ce qui en fait le cœur du projet énergétique du pays. Mais sans un réseau capable d’acheminer cette électricité, même un barrage flambant neuf resterait une promesse vide. Il faudrait donc investir simultanément dans la modernisation et l’extension du réseau national, avec un coût estimé entre 2 et 5 milliards de dollars pour créer une véritable dorsale nationale, multiplier les postes de transformation et réduire les énormes pertes techniques. Au total, redonner vie au système électrique congolais exigerait entre 19 et 26 milliards de dollars, un montant élevé mais cohérent.
La RDC peut bâtir un modèle d’autofinancement crédible en profitant de sa dollarisation. Il suffit de créer des instruments financiers où le principal entre en devises, mais où les intérêts sont versés en francs congolais, ce qui protège les réserves tout en attirant l’épargne. Les banques publiques et commerciales peuvent être tenues d’acheter ces obligations, et une option de conversion des cotisations salariales en titres énergétiques élargirait encore la base de financement. Les citoyens et la diaspora peuvent également y souscrire. Les rémittences, une fois captées par un mécanisme national de payer en FC les transferts mais conserve les devises dans un fonds stratégique, peuvent générer 1 à 2 milliards de dollars par an. Avec la réhabilitation d’Inga I et II, capable de rapporter 400 à 600 millions de dollars en exportations d’électricité, la RDC peut sécuriser jusqu’à 2,6 milliards de dollars annuels avant même d’entamer Inga III. Ceci est un socle financier capable de réduire considérablement la dépendance extérieure et de sécuriser l’achat des équipements que le pays ne peut pas produire lui-même.
La capacité réelle de financement apparaît clairement lorsqu’on met les chiffres en perspective. Sur le plan idéologique, la Théorie monétaire moderne rappelle qu’un État peut toujours créer sa propre monnaie et régler en francs congolais la majeure partie d’un projet national. Mais la réalité technique impose une limite, car une partie des équipements doit être importée et certaines expertises ne peuvent être obtenues qu’en devises. En appliquant le schéma décrit plus haut, la RDC peut générer entre 2 et 4 milliards de dollars par an en devises. Un tel flux permet de financer entièrement Inga III en dix ans, tout en rénovant simultanément les deux premiers barrages, sans pression sur le franc congolais. Le reste, notamment la modernisation du réseau national, peut être couvert progressivement en monnaie locale ou en devises limitées, sans replonger dans l’endettement extérieur ni se mettre à la merci des caprices d’institutions belliqueuses comme la Banque mondiale et le FMI.
Le calendrier devient réaliste dès lors que les trois chantiers avancent ensemble. La réhabilitation d’Inga I et II peut être terminée en trois ans, avec des exportations d’électricité en hausse dès la deuxième année. Inga III peut démarrer à mi-parcours, créant un chevauchement qui accélère la mobilisation des ressources. Avec un financement progressif, le barrage peut être livré en huit à douze ans, sans sacrifier la souveraineté financière du pays.
Le risque éthiopien, la leçon congolaise
Ce scénario d’autofinancement exige une discipline totale dans la coordination financière, notamment dans la gestion de l’émission monétaire, ainsi qu’une gouvernance rigoureuse et une transparence absolue. S’il est respecté, le Congo peut réhabiliter Inga I et II et construire Inga III en parallèle, essentiellement avec ses propres moyens. L’exemple éthiopien montre exactement ce qu’il faut éviter. Le chantier du GERD a perdu 5 ans après que les travaux électromécaniques ont été confiés à une entreprise militaro-industrielle incapable de respecter les standards techniques, un choix qui a déclenché un vaste scandale. L’enquête a révélé un réseau de corruption impliquant des officiers supérieurs, des cadres de l’armée et des civils complices, dont plusieurs ont été arrêtés et emprisonnés. Cette dérive a englouti du temps et de l’argent sans aucun progrès réel, rappelant qu’un projet stratégique s’effondre dès qu’il devient l’otage d’intérêts politiques.
Le succès congolais dépendra également de sa capacité à s’approprier les technologies. Tous les contrats étrangers doivent exiger un transfert réel de compétences, avec au moins 20 % d’ingénieurs congolais intégrés aux travaux et formés en continu, y compris par des stages de longue durée à l’étranger. La création d’un centre technologique Inga–Matadi permettrait d’entraîner une nouvelle génération d’ingénieurs spécialisés en turbines, en systèmes de contrôle et en maintenance de haut niveau. Avec ce socle, la RDC pourra non seulement entretenir et moderniser ses propres infrastructures, mais aussi acquérir le savoir-faire nécessaire pour construire ses futurs barrages. Et lorsqu’elle disposera enfin de cette expertise, rien n’empêchera le pays d’envisager sérieusement ce qui semblait jadis hors de portée, y compris le Grand Inga.
L’avenir se joue dans la consommation intérieure
Je dois confesser que je suis un libéral congolais. Par ce fait, je considère l’électricité et l’eau comme des secteurs de sécurité nationale au même titre que l’armée ou la police. Ce ne sont pas des marchandises ordinaires mais des infrastructures vitales qui déterminent la souveraineté, la stabilité et la dignité d’un pays. Elles doivent donc rester sous contrôle stratégique de l’État et non être livrées aux aléas du privé. Cela ne signifie pas qu’elles doivent être gratuites ou subventionnées à perte. Une ressource essentielle peut être publique tout en étant gérée avec rigueur et facturée de manière responsable. Ce que je défends, c’est un service public efficace et professionnel, capable de garantir l’accès et la continuité tout en assurant sa viabilité grâce à une tarification juste et une gestion moderne.
La production électrique n’a de sens que si les citoyens peuvent la convertir en capital dans une économie moderne. La Banque mondiale et le FMI répètent que l’électricité améliore l’éducation et la santé, en confondant corrélation et causalité. Ils ne disent jamais que sans qualité préalable des politiques et services publics l’énergie ne produit aucun effet structurant. Sans pouvoir d’achat, la lumière ne devient jamais développement et, comme en RDC, le réseau finit même par s’effondrer. Une politique énergétique ambitieuse doit donc avancer avec une politique économique moderne qui permette aux citoyens d’utiliser pleinement leur capital humain pour augmenter leurs revenus réels et élever leur niveau de vie. Il faut s’attaquer d’abord aux structures et aux politiques qui maintiennent la RDC au rang de pays comptant le plus de pauvreté extrême, sinon l’énergie ne fera que nourrir un nouveau gâchis générationnel.
Il faut rompre avec le schéma de 50 ans qui réduit Inga à une source d’énergie pour les mines et l’exportation. Cette vision étroite a bloqué la diversification et écarté les ménages, les PME et les commerces du rôle moteur qu’ils devraient jouer. Et surtout, il faut cesser de confondre industrialisation et modernisation. Rome ou l’Égypte furent des centres du monde sans électricité, et au 21ᵉ siècle, l’industrialisation n’est plus la seule voie vers la modernité. L’électricité doit devenir un vecteur de transformation sociale, pas un privilège industriel. L’enjeu est de bâtir un écosystème où l’énergie alimente la digitalisation, l’agro-transformation, les transports modernes, les services et l’essor des petites entreprises. L’électricité doit être la lanterne de l’économie, et non un simple moyen de remplacer les lanternes dans les huttes, d’éclairer des hôpitaux délabrés ou d’assurer l’atterrissage sécurisé du président.
Cette transformation exige un leadership capable de mobiliser la population et la diaspora en articulant un plan directeur et une feuille de route couvrant le financement, la gouvernance, la technologie, la distribution et l’impact social. Elle exige aussi que les citoyens exercent leur droit de contrôle en examinant le plan avant son lancement, en surveillant sa mise en œuvre et en évaluant ses résultats longtemps après son achèvement. Inga, comme toute autre source d’énergie, doit devenir un projet national au-delà des clans politiques et des cycles électoraux, à l’image du GERD en Éthiopie. Le pays a besoin d’une vision assez ambitieuse pour susciter un effort patriotique et assez cohérente pour utiliser l’expertise internationale sans s’y soumettre. Un barrage n’est pas seulement une infrastructure, c’est un acte de renaissance lorsque la nation entière, à travers le contrat social, en devient l’architecte et le gardien.
Jo M. Sekimonyo, PhD
Économiste politique, théoricien, militant des droits humains, écrivain et chancelier de l’Université Lumumba