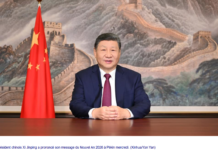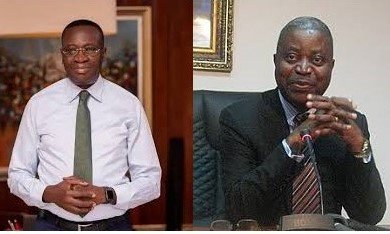J’aimais Tintin, jusqu’au jour où j’ai compris qu’Hergé, son créateur, trempait ses pinceaux dans un racisme soigneusement blanchi à l’aquarelle. En feuilletant à nouveau ses albums, une chose me frappe toujours, les Dupond et Dupont. Deux inspecteurs au béret vissé, maîtres dans l’art de la bourde en série, qui, malgré un palmarès de gaffes à faire pâlir un cirque entier, restaient invariablement en fonction. Jamais sanctionnés, jamais mutés, et, par une étrange magie, toujours de retour sur la scène, fidèles au poste, comme si le désastre était leur véritable mission.
L’un, évincé jadis pour incompétence notoire par un voleur en col blanc, Matata Ponyo, et l’autre, réputé pour avoir amassé une fortune douteuse en abusant du pouvoir tout au long de sa carrière, le duo Mukoko–Muzito se retrouve aujourd’hui à nouveau aux commandes, tenant entre leurs mains le rythme même du cœur de la nation.
Le vrai danger ne se limite pas à leur passé déjà chargé de soupçons et d’échecs ; il se trouve surtout dans l’idéologie qu’ils portent, figée dans des réflexes économiques obsolètes et nocifs, incapables de répondre aux impératifs d’un pays qui aspire à la souveraineté économique et à une modernisation structurelle.
Gouvernement-centré
Il ne fait plus aucun doute que Daniel Mukoko Samba reste enfermé dans une logique primitive de l’économie politique, celle d’un État hypertrophié qui prétend tout contrôler, tout décider et tout financer, reléguant la société et le marché au rang de simples accessoires de sa mécanique budgétaire. Un professeur d’économie qui se préoccupe de tout, sauf du taux de chômage, incapable de réorienter les subventions vers les secteurs moteurs de la croissance, mais qui garde les yeux rivés sur le prix du fufu.
Chez Adolphe Muzito, cette inclination est moins médiatisée mais tout aussi flagrante. Elle saute aux yeux dans ses écrits, ses discours et, plus encore, dans son parcours. Voir un ancien Premier ministre, en d’autres termes, un ex-co-président du pays, s’abaisser devant Tshisekedi pour quémander un portefeuille ministériel relève moins de la stratégie que de l’humiliation politique. Il aurait pu peser, influencer les orientations majeures et défendre l’intérêt national sans se laisser engluer dans les compromissions de l’appareil. Mais il a choisi la servitude de couloir plutôt que la liberté d’influence.
À peine revenu aux affaires, il clame vouloir doubler le budget de l’État. Mais dans la mécanique d’un État, un tel bond ne se fait jamais par magie. On peut le faire en creusant le déficit. Dans les économies développées les déficits publics servent souvent à amortir les crises ou à stimuler la demande. Les États-Unis, avec 291 milliards de dollars de déficit rien qu’en juillet ; la Chine, 733 milliards au premier semestre 2025 ; ou encore la petite Belgique, avec 28 milliards en décembre 2023. Chez eux, le déficit est devenu une drogue économique assumée pour stimuler la croissance. Mais ces pays disposent d’un accès privilégié aux marchés financiers internationaux, de monnaies fortes et d’institutions crédibles, ce qui leur permet d’émettre massivement de la dette à faible coût.
La RDC n’a pas cette latitude, et, elle, évolue dans un contexte radicalement différent. Sa notation de crédit est médiocre, les marchés internationaux exigent des taux élevés et nous prêtent au compte-gouttes et le marché domestique est trop restreint et notre population est trop appauvrie pour acheter et absorber de la dette souveraine à grande échelle.
Du coup, pour doubler le budget national, en vrai, et non les jeux des chiffres sur papier, la seule option est resserrée l’étau sur l’économie nationale, ponctionner davantage le secteur productif et asphyxier encore plus le privé. Croire que la taille du budget suffit à mesurer le progrès relève d’une vision dangereuse, car c’est en réalité une voie directe vers l’étranglement économique du pays. Mais ce qui traduit véritablement son sens primitif, c’est qu’en réalité la question essentielle n’est pas combien dépenser, mais pourquoi chercher à doubler un budget dont tout le monde sait qu’il a un impact quasi nul sur l’économie réelle et sur le quotidien des Congolais.
Croissance budgétaire ≠ politique fiscale
L’augmentation du budget d’un État n’est pas, en soi, un signe de bonne santé économique. Ce n’est qu’un outil comptable dont l’effet dépend entièrement de la manière dont les ressources sont mobilisées, allouées et multipliées dans l’économie réelle.
La RDC est dans le piège de la centralisation excessive, héritée des réflexes de l’ère post-indépendance, où l’État se pense comme unique locomotive de l’économie. Dans ce modèle, l’exécution reste concentrée dans l’appareil administratif, tandis que le secteur privé et les collectivités locales sont cantonnés à un rôle secondaire, ce qui freine l’innovation et la création de valeur. À l’inverse, les pays émergents qui ont connu une véritable transformation, du Vietnam à l’Éthiopie dans une certaine mesure, ont orienté la stratégie depuis l’État tout en déléguant largement l’exécution au secteur privé ou à des partenariats public-privé, dans un cadre fiscal clair et stable.
Muzito parle de construction des routes. L’histoire récente montre que multiplier les chantiers publics sans politique d’entretien, sans cohérence avec les flux économiques, c’est bâtir sur du sable. Le mythe des grands travaux dits « vitrine » illustre parfaitement cette erreur. Construire des routes, des bâtiments administratifs ou des infrastructures spectaculaires donne l’illusion d’un dynamisme économique, mais, sans maintenance, sans intégration logistique et sans lien avec les pôles productifs, ces ouvrages se dégradent rapidement et génèrent peu de valeur ajoutée.
La confusion entre croissance budgétaire et politique fiscale est au cœur du problème. La première se résume à augmenter les dépenses publiques, financées par plus de recettes, plus de dette ou par une ponction accrue sur l’économie. La seconde consiste à structurer la fiscalité, les incitations et la répartition des ressources pour stimuler l’investissement, élargir la base fiscale, encourager la formalisation et assurer la soutenabilité à long terme. Sans cette vision fiscale et productive, la croissance du budget n’est qu’un château de cartes, reposant sur des ressources volatiles, générant une dette coûteuse et incapable de produire une croissance durable.
C’est précisément là que l’approche montre ses limites : gonfler la taille du budget n’a rien à voir avec conduire une politique fiscale intelligente. La première n’est qu’un chiffre couché sur du papier ; la seconde est un levier pour libérer le potentiel productif, attirer l’investissement et générer un véritable effet multiplicateur dans l’économie. Agir sans stratégie fiscale claire ni vision de transformation productive, c’est reproduire un schéma déjà testé et déjà échoué. Et c’est justement cette nuance capitale que des esprits figés dans une pensée économique primitive, comme Mukoko et Muzito, semblent incapables, ou peu disposés, à comprendre.
Homologué dans l’art de faire bien… ce qu’il ne faut pas faire
Adolphe Muzito est souvent salué pour avoir « stabilisé l’économie » lorsqu’il était aux commandes. Mais il faut être clair : la RDC n’avait pas, et n’a toujours pas, besoin de cette stabilité telle qu’il la conçoit, une stabilité figée, rassurante pour les indicateurs macroéconomiques, mais stérile pour l’économie réelle. Ce dont le pays a urgemment besoin, c’est de croissance, de transformation structurelle et de création massive de valeur ajoutée.
Stabiliser une économie déjà fragile, c’est comme maintenir immobile un patient en état critique et prétendre que l’absence de mouvement est un signe de guérison. Cette approche donne l’illusion d’une bonne gestion, mais elle fige la pauvreté, retarde l’investissement productif et étouffe l’initiative privée. En économie politique, on connaît bien ces « stabilités toxiques » qui pérennisent les inégalités et verrouillent les blocages structurels.
Le véritable problème avec Muzito, c’est qu’il revendique, à juste titre, si l’on accepte de fermer les yeux et de mettre notre esprit critique en veille, une maîtrise parfaite de la mécanique d’un budget équilibré, mais cette compétence est mise au service d’un modèle économique atone, incapable de provoquer une expansion réelle de l’activité, de diversifier la base productive ou d’élever le niveau de sophistication des secteurs stratégiques. Au lieu d’être un levier de transformation et de prospérité, cette rigueur budgétaire devient un carcan qui conforte un statu quo stérile, figé dans une vision étroite de la gestion publique. En somme, Muzito incarne l’art d’exécuter avec précision et constance ce qu’il ne faudrait, en réalité, jamais entreprendre si l’on veut faire progresser une économie.
Cris d’assaut à la maison direction
Le développement ou l’effondrement d’une nation n’est jamais le fruit du hasard. C’est toujours le résultat d’une accumulation, sur des années, de politiques cohérentes ou désastreuses, d’initiatives lucides ou irréfléchies. Autrement dit, tout commence par l’écriture du scénario puis vient le choix des acteurs.
La Chine illustre parfaitement cette logique. À un moment charnière, ses dirigeants et ses élites se sont dit qu’il n’existait aucune raison objective pour que leur niveau de vie reste inférieur à celui des économies avancées. La question est devenue : comment y parvenir ? La réponse trouvée et adoptée au sommet fut claire : investir massivement dans le capital humain, ou, pour le dire dans le style propre à l’éthosisme, dans la qualité individuelle des moyens de participation à une entreprise moderne, sophistiquée et génératrice de hauts revenus. Aujourd’hui, lorsque les États-Unis créent ChatGPT, la Chine répond avec DeepSeek, en mobilisant des coûts moindres tout en atteignant un niveau technologique compétitif. Même face aux accusations de « triche », il faut reconnaître qu’« imiter » ou produire exige déjà un savoir-faire technique et organisationnel de haut niveau.
C’est précisément ce type de vision stratégique qui manque cruellement à la RDC. Dans ce contexte, entendre Félix Tshisekedi promettre que la RDC deviendrait « l’Allemagne de l’Afrique » relevait moins d’un projet économique solide que d’un slogan empoisonné qui, pour des raisons diverses, a suscité les applaudissements de certains et les rires d’autres, sans que l’on mesure pleinement le danger qu’il recèle. L’enjeu ne devrait pas être de singer l’Allemagne en tant qu’État, mais que les Congolais puissent se payer, ici et maintenant, le même confort matériel et social que les citoyens allemands s’offrent chez eux ou partout où ils se trouvent dans le monde.
Et j’ose croire peut-être naïvement, ou simplement par besoin de croire au bon sens congolais, que nos concitoyens en prendront note d’ici 2028. Qui, parmi ceux qui brigueront nos suffrages, viendra nous présenter une véritable formule, et non ces grotesques projets de société, capable de nous placer réellement sur cette trajectoire ?
Jo M. Sekimonyo
Économiste politique, théoricien, militant des droits humains et écrivain. Actuellement chancelier de l’Université Lumumba.
Site officiel : universitelumumba.com