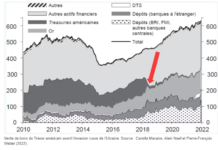Le week-end dernier, j’ai été mis au défi par l’un de ces pilleurs d’idées et de projets, plus enclins à parader dans la « république de la Gombe » en hurlant « pouvoir ya biso » qu’à produire une réflexion structurée, de détailler une proposition formulée lors de ma croisade pré-présidentielle de 2023, ultérieurement neutralisée par le Conseil d’État, et dans laquelle la toile d’araignée territoriale figurait parmi les six axes structurants de mon programme. Ceci tombe d’autant mieux que la centralité accordée aux embouteillages de Kinshasa masque une crise bien plus profonde d’intégration territoriale et appelle des réponses aussi visibles qu’inefficaces.
Kinshasa constitue moins une cause qu’un révélateur. La RDC demeure un espace économiquement fragmenté, marqué par une faible connectivité interrégionale et l’absence de continuité logistique. Cette désarticulation entrave l’intégration des marchés, limite la mobilité des facteurs de production et enferme de vastes territoires dans des équilibres durables de sous-développement. La pression démographique exercée sur la capitale est la conséquence directe de cette architecture territoriale défaillante, ce qui rend toute politique strictement urbaine structurellement insuffisante.
L’avantage comparatif du rail apparaît clairement lorsqu’on examine les contraintes structurelles des autres modes de transport. La route, souvent présentée comme flexible, impose dans un pays au relief complexe et au climat exigeant des coûts élevés de construction et d’entretien, tout en générant une dépendance chronique à l’importation de véhicules, de pièces détachées et de carburant, pour une capacité limitée de transport de masse. Le transport fluvial, malgré l’étendue du réseau hydrographique, demeure entravé par la non-navigabilité intégrale du fleuve Congo et par des discontinuités géographiques qui en limitent la fonction d’ossature nationale. Le transport aérien pousse ces contraintes à leur paroxysme, combinant dépendance industrielle, coûts prohibitifs pour la majorité de la population et inadéquation au déplacement de volumes importants de marchandises.
Ce diagnostic est ancien et solidement établi. Dès la période coloniale, le rail avait été identifié comme la colonne vertébrale indispensable à l’organisation d’un territoire de dimension continentale, et cette intuition demeure pleinement valide. Là où les autres modes restent structurellement limités, le rail offre une capacité d’intégration spatiale et productive sans équivalent. Il ne relève pas d’un arbitrage technique sectoriel, mais d’un instrument stratégique de cohésion territoriale, de souveraineté économique et de transformation structurelle à long terme.
Le coup d’échecs du dragon
Mes séjours en Chine m’offrent à chaque fois une démonstration empirique de la puissance intégratrice du rail à grande vitesse. Les trajets entre Shenzhen et Guangzhou compressent radicalement le temps et la distance, 136 km parcourus en trente minutes, pour un coût généralement inférieur à 25 dollars en classe affaires, avec des billets pouvant descendre jusqu’à l’équivalent de 3,95 dollars et une fréquence de plusieurs centaines de trains quotidiens, réservables en quelques clics sur téléphone. Cette compression abolit de fait la distinction entre mobilité interurbaine et mobilité quotidienne.
Par sa fiabilité et sa prévisibilité, le ferroviaire chinois dépasse fréquemment l’aviation en efficacité sociale et économique, devenant un vecteur central d’intégration régionale des marchés du travail, des biens et des services. L’axe Shanghai–Guangzhou en offre une illustration à grande échelle. Sur une distance d’environ 1 770 à 1 800 km, le train à grande vitesse relie les deux métropoles en près de 6,5 heures un coût avoisinant 100 dollars. À titre de comparaison, le vol direct dure environ 2,5 heures et demie un coût avoisinant aussi 100 dollars, mais avec des prix fortement variables et des coûts sociaux et logistiques plus élevés. Dans cet arbitrage, le rail s’impose non par la seule vitesse maximale, mais par la continuité, la capacité et la fiabilité du service.
Cette transformation résulte d’une stratégie contractuelle délibérément pilotée par l’État. Au début des années 2000, la Chine ouvre son marché ferroviaire à quatre acteurs technologiques majeurs, Alstom, Siemens, Bombardier et Kawasaki Heavy Industries, à travers des contrats de plusieurs milliards de dollars, à un niveau rendant toute abstention économiquement irrationnelle. L’un des accords fondateurs, conclu avec la coentreprise Bombardier Sifang, portait sur près de 4 milliards USD pour des trains à grande vitesse, dont environ la moitié revenait au partenaire canadien. L’accès à ces marchés était strictement conditionné à des transferts de compétences, à la formation d’ingénieurs chinois et à la localisation industrielle, imposant aux entreprises étrangères des coentreprises avec des groupes nationaux comme CNR Changchun et CSR Sifang. Le marché chinois fut ainsi conçu non comme un simple espace d’importation, mais comme un dispositif d’apprentissage industriel dirigé, fondé sur l’échange asymétrique entre commandes massives et appropriation accélérée du savoir-faire.
Ce dispositif institutionnel permet une absorption technologique d’une rapidité exceptionnelle. Dans une première phase, les entreprises étrangères assurent la conception et la mise en service des systèmes à grande vitesse, mais la montée en compétence rapide des ingénieurs chinois, appuyée par une coordination étatique étroite et un appareil industriel intégré, réduit rapidement cette dépendance. Dès 2010, la mise en service de la série CRH380 signale l’émergence d’une capacité de développement indigène, pleinement affirmée en 2017 avec les rames Fuxing CR400, conçues selon un standard national unifié et entièrement industrialisable.
Sur le plan infrastructurel, la trajectoire est tout aussi révélatrice. Partie de quelques centaines de kilomètres à la fin des années 2000, la Chine exploite aujourd’hui près de 48 000 km de lignes à grande vitesse, soit environ 66 % du réseau mondial. À un coût moyen compris entre 17 et 21 millions USD par kilomètre, ce ferroviaire constitue désormais un système intégré associant production, financement et exportation, et s’impose comme un instrument central de puissance économique, industrielle et géopolitique.
Pourquoi la RDC ne peut pas copier la Chine telle quelle, aujourd’hui !
La limite fondamentale à une transposition mécanique de la trajectoire chinoise par la RDC n’est pas d’abord financière. Les ressources peuvent être mobilisées. Ce qui fait défaut est la densité d’acteurs capables de participer effectivement à des projets de très grande échelle. La Chine ne disposait pas seulement du capital requis, mais d’un écosystème d’entreprises, d’ingénieurs et d’institutions en mesure de coexécuter, d’absorber et de prolonger des investissements massifs dans le temps. C’est cette capacité de participation qui rendait crédibles les engagements contractuels et soutenait une dynamique d’apprentissage industriel accéléré.
Cette différence renvoie à un déficit structurel de capital humain organisé et de capacités productives intermédiaires. Avant l’essor du ferroviaire à grande vitesse, la Chine avait accumulé pendant plusieurs décennies un réservoir dense de compétences techniques et managériales, adossé à un système éducatif orienté vers l’industrie et les sciences appliquées. En RDC, le défi n’est pas l’absence de talents individuels, mais l’insuffisance de structures permettant à des compétences de qualité d’opérer collectivement à l’échelle requise.
Le modèle chinois repose enfin sur une architecture institutionnelle hybride, capable d’intégrer financement, infrastructure et production dans un dispositif coordonné. Si cette configuration est aujourd’hui partiellement exportable sous forme d’ensembles intégrés modulaires, elle ne peut produire d’effets durables sans une base nationale capable d’y prendre part. L’enjeu pour la RDC n’est donc pas de copier la Chine, mais de reconstruire les conditions humaines, institutionnelles et productives de la participation, sans lesquelles l’investissement, aussi abondant soit-il, demeure stérile.
Notre propre voie : la toile d’araignée congolaise
La stratégie congolaise ne peut suivre un séquençage lent et linéaire des réformes. Compte tenu des retards accumulés et des déséquilibres territoriaux profonds, le désenclavement ferroviaire doit être pensé comme un processus simultané visant à la fois l’accumulation d’infrastructures et la construction de capacités de participation. Électricité, capital et savoir-faire doivent être mobilisés conjointement dès l’origine, leur dissociation ayant historiquement produit des réseaux sous-utilisés et une dépendance durable à l’expertise extérieure.
Cette approche implique un renversement des priorités. Avant le béton, l’investissement doit porter sur le capital humain organisé, à travers des bourses ciblées et une recherche appliquée ancrée dans les instituts techniques nationaux, afin de constituer un noyau d’acteurs capables d’opérer, d’adapter et de maintenir les technologies importées. Sans cette base cognitive et institutionnelle, toute infrastructure importée demeure vulnérable, coûteuse et politiquement instable.
La mise en œuvre doit s’appuyer sur des projets pilotes clairement délimités, conçus comme des dispositifs d’apprentissage institutionnel. Kinshasa s’impose comme laboratoire urbain, où les effets sur la productivité et la mobilité sont immédiatement observables, tandis que le Kongo Central offre un corridor stratégique pour tester l’intégration logistique entre ports, zones productives et centres de consommation. Ces expériences doivent permettre d’ajuster et de consolider les mécanismes de coordination avant leur généralisation progressive à l’ensemble du territoire national.
Inga : la lanterne
Le complexe d’Inga occupe une position centrale dans toute stratégie crédible de désenclavement ferroviaire en République démocratique du Congo. Bien que son potentiel hydroélectrique théorique dépasse 40 000 MW, les installations existantes demeurent largement sous-exploitées. Inga I et Inga II, mis en service respectivement en 1972 et 1982 avec des capacités installées de 351 MW et 1 424 MW, fonctionnent aujourd’hui bien en deçà de leurs niveaux nominaux en raison d’un déficit chronique de maintenance, de pertes techniques élevées et d’une gouvernance fragmentée. Cette sous-performance limite l’accès national à l’électricité et constitue un verrou majeur pour toute ambition ferroviaire et industrielle à grande échelle, le rail électrifié exigeant une alimentation stable et prévisible.
La modernisation d’Inga doit suivre une logique phasée orientée vers des gains rapides de capacité. La réhabilitation complète d’Inga I et II permettrait de restaurer entre 800 et 1 000 MW supplémentaires, pour un coût estimé entre 1 et 1,5 milliard USD et des délais de mise en œuvre de 3 à 5 ans. Ce segment représente le levier énergétique le plus rentable à court terme et constitue une condition immédiate pour l’électrification progressive des corridors ferroviaires prioritaires.
À moyen et long terme, Inga III relève d’une autre échelle stratégique. Le projet Inga III Basse Chute, avec une capacité projetée d’environ 4 800 MW et un investissement estimé entre 13 et 15 milliards USD sur un horizon de 7 à 10 ans, peut être conçu comme une extension ciblée, alignée sur les besoins ferroviaires et industriels nationaux plutôt que sur une logique exclusivement exportatrice. L’enjeu n’est pas la maximisation abstraite de la production, mais l’articulation fonctionnelle entre énergie et transport. Pensé ainsi, Inga devient non un projet énergétique isolé, mais le socle productif de la toile d’araignée ferroviaire et une condition de cohérence économique, territoriale et souveraine de l’ensemble du dispositif.
Kinshasa : système ferroviaire urbain
La crise de mobilité à Kinshasa résulte d’une croissance urbaine rapide adossée à un système de transport dominé par la route, désormais structurellement saturé. Cette dépendance engendre des coûts économiques élevés sous forme de congestion chronique, de pertes de temps, de pollution et d’inefficacités logistiques, tout en réduisant la productivité du travail et en accentuant les inégalités d’accès à l’emploi et aux services. Dans ce contexte, les réponses fondées sur l’élargissement routier ou la régulation ponctuelle du trafic présentent des rendements décroissants et une soutenabilité limitée. Surtout, elles enferment la ville dans une géographie contrainte où les lieux d’habitation et les lieux de travail restent artificiellement comprimés.
La colonne vertébrale du dispositif proposé repose sur un train urbain et périurbain de type RER, fondé sur la réhabilitation et l’électrification des emprises ferroviaires existantes. En comprimant le temps de déplacement à l’échelle métropolitaine, le rail ne se contente pas d’améliorer la mobilité. Il élargit concrètement l’espace dans lequel les ménages peuvent vivre et accéder à l’emploi, et permet une redistribution plus équilibrée des activités économiques. Une première ligne structurante relierait la Gare Centrale à l’aéroport de N’djili sur environ 25 km, avec des stations desservant les principaux pôles résidentiels et d’activité. Déployable sur 4 à 6 ans, cette phase représente le segment à plus fort impact immédiat, pour un coût estimé entre 0,6 et 1,2 milliard USD. Dans une seconde phase, l’extension vers Kintambo à l’ouest et N’sele à l’est élargirait durablement le bassin d’emploi accessible et créerait de nouvelles centralités urbaines, contribuant à contenir l’étalement informel.
En complément, trois corridors urbains à très forte densité justifient l’implantation de tramways ou de rail léger en site propre, avec une fonction de distribution fine et de structuration de l’espace urbain. Les axes Ngaliema–Gombe, Lingwala–Barumbu–Kasa-Vubu et Lemba–Université de Kinshasa–zones hospitalières permettraient de rapprocher logement, emploi, services et équipements collectifs, en réduisant les coûts de déplacement quotidiens et en soutenant l’émergence de pôles économiques de proximité. Ces lignes représenteraient un investissement cumulé compris entre 1,2 et 2,0 milliards USD sur 3 à 5 ans.
À maturité, l’ensemble du système ferroviaire urbain et périurbain de Kinshasa représenterait un investissement total compris entre 4,5 et 6,5 milliards USD sur un horizon de 10 à 12 ans. Alimenté par une électricité stabilisée issue d’Inga, ce dispositif ne transformerait pas seulement la mobilité, mais la géographie économique de la ville, en élargissant durablement les espaces où l’on peut habiter, travailler et entreprendre. Inséré dans la toile d’araignée ferroviaire nationale, le rail urbain de Kinshasa devient ainsi un levier central de productivité, d’inclusion et de transformation territoriale.
Pilote régional par déploiement territorial simultané
Le Kongo Central constitue un terrain pilote privilégié pour la toile d’araignée ferroviaire, car il permet un déploiement territorial fractionné mais stratégiquement coordonné. Le projet n’est pas conçu comme un axe linéaire unique reliant les ports à Kinshasa, mais comme un ensemble de sous-projets lancés simultanément depuis Muanda et Boma sur la façade maritime, Kisantu au cœur du bassin agricole et Kasangulu comme nœud logistique intermédiaire, convergeant progressivement vers la capitale. Cette architecture vise à produire dès les premières phases des effets d’intégration économique, d’apprentissage institutionnel et de mobilisation productive à l’échelle locale.
Ce choix impose une option technologique réaliste. Un train à grande vitesse, exigeant des infrastructures dédiées, des tracés rectilignes et des systèmes de signalisation lourds, représenterait sur l’axe Kinshasa–Matadi un coût compris entre 40 et 60 millions USD par km, soit 15 à 20 milliards USD sur 8 à 12 ans. Une telle option ne devient rationnelle qu’à partir de volumes très élevés de trafic et d’une maturité institutionnelle avancée, conditions qui ne sont pas réunies à ce stade.
L’option retenue est donc celle d’un train régional rapide, opéré entre 120 et 160 km/h, fondé sur la réhabilitation lourde et la modernisation progressive des emprises existantes. Ce modèle permet le transport conjoint de passagers et de fret léger, tout en réduisant fortement les exigences techniques et financières. Le projet serait décliné en tronçons autonomes mais interopérables sur les axes Muanda–Boma, Boma–Kisantu, Kisantu–Kasangulu et Kasangulu–Kinshasa. Chaque tronçon, long de 80 à 120 km, pourrait être livré en 5 à 7 ans pour un coût de 8 à 12 millions USD par km, soit 0,8 à 1,2 milliard USD par territoire. L’ensemble du pilote représenterait ainsi un investissement total compris entre 4 et 6 milliards USD, nettement inférieur à celui d’une ligne à grande vitesse, pour des effets économiques plus rapides.
Les retombées attendues sont structurelles. Le démarrage simultané depuis Muanda et Boma sécurise l’accès portuaire et améliore la compétitivité des exportations. À Kisantu, la baisse des coûts logistiques soutient la production agricole et favorise la transformation locale. À Kasangulu, le rail consolide une fonction de plateforme logistique reliant les flux régionaux à la métropole kinoise. Le Kongo Central devient ainsi un laboratoire opérationnel de gouvernance ferroviaire territorialisée, où le rail agit non comme un simple corridor de transit, mais comme un instrument actif de restructuration productive et d’intégration des marchés, préfigurant le déploiement national de la toile d’araignée ferroviaire.
Gouverner, c’est savoir commencer
Toute transformation structurelle implique une prime initiale d’apprentissage. Accepter un coût plus élevé au départ ne relève pas de l’inefficacité, mais constitue la condition de l’appropriation des technologies, des standards d’exploitation et des capacités institutionnelles qui garantissent la durabilité du système ferroviaire. Le savoir ne doit pas être traité comme une dépense à comprimer, mais comme un actif productif stratégique, dont les rendements se manifestent dans le temps par une autonomie technique accrue, une réduction des dépendances et des gains d’efficacité cumulés.
Cette trajectoire exige un investissement massif et structuré dans le capital humain. Universités, écoles d’ingénierie et instituts techniques doivent être intégrés au cœur du projet de désenclavement comme infrastructures productives à part entière. La formation d’ingénieurs, de techniciens et de chercheurs conditionne la capacité à absorber le savoir-faire importé, à l’adapter aux contraintes locales et, à terme, à le produire. Sans cette base scientifique et technique, l’infrastructure demeure exogène, fragile et politiquement coûteuse.
Les projets pilotes de Kinshasa et du Kongo Central ont vocation à accélérer cet apprentissage. Leur succès permettrait un déploiement coordonné à l’échelle des territoires, selon une logique de réseau où chaque nouveau tronçon renforce la valeur de l’ensemble. Le désenclavement cesserait alors d’être une juxtaposition de projets pour devenir une architecture nationale intégrée, génératrice d’externalités positives et de compétences cumulatives.
Le financement de cette transformation ne doit pas miser sur des ressources extérieures. Il doit s’appuyer sur un mécanisme d’autofinancement national, combinant obligations souveraines et mobilisation de la diaspora, mais aussi sur un secteur privé congolais appelé à jouer un rôle moteur. La souscription en devises, assortie de rendements libellés en franc congolais, permettrait d’ancrer l’investissement dans l’économie nationale tout en élargissant la base de participation. Ce qui apparaît comme un effort colossal à l’échelle macroéconomique devient, une fois mutualisé, un engagement individuel soutenable à fort impact collectif. Le secteur privé local ne doit pas être un simple sous-traitant, mais un co-investisseur et un co-constructeur de la capacité nationale.
En dernière analyse, le désenclavement ferroviaire ne relève pas uniquement de la gouvernance étatique, mais d’une responsabilité politique partagée entre les dirigeants et la société qui les mandate. Gouverner ne consiste pas à improviser après l’élection, mais à présenter en amont une trajectoire cohérente, une méthode intelligible et la capacité avérée de mobiliser des acteurs crédibles pour initier des transformations durables. Lorsque le souverain primaire renonce à examiner ces éléments avec rigueur, l’élection devient un pari et la gouvernance un exercice de tâtonnement. Toute transformation structurelle exige l’acceptation de projets dont les bénéfices dépassent le cycle électoral et parfois la carrière de ceux qui les engagent. Rompre avec la succession de mandats improductifs et d’occasions manquées suppose ainsi une élévation collective des critères de sélection politique, au profit d’un leadership évalué sur sa capacité à structurer l’action publique dans la durée et à en assurer la transmission.
Jo M. Sekimonyo, PhD
Économiste politique, théoricien, militant des droits humains et écrivain. Chancelier de l’Université Lumumba.