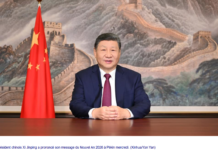À la lecture de la liste du gouvernement Suminwa II, on a l’impression d’assister à un morcellement digne d’un terrain de Kinshasa, où chaque lopin est découpé et redécoupé jusqu’à ce qu’on ne sache plus où commence la parcelle voisine. La RDC, elle, semble avoir replongé ses jetons de Scrabble dans le sac, l’avoir agité comme pour brasser l’avenir, pour en ressortir exactement les mêmes voyelles et consonnes. Et l’on se prend à se demander, avec une ingénuité presque touchante, si le hasard pourrait, par un coup de baguette magique, composer un mot neuf à partir de lettres déjà usées.
À en croire certaines rumeurs, les ministres sortants auraient multiplié les visites chez les féticheurs et veillé, nuits entières, sur des tombes anonymes, cherchant dans l’ombre la grâce de leur maintien. À voir le résultat, on pourrait croire que la vieille spiritualité bokoko conserve, décidément, tout son pouvoir d’influence.
Mais derrière cette image presque folklorique se profile une autre lecture. Le remaniement, annoncé avec fracas, promettait un gouvernement resserré et un souffle neuf. Au final, il révèle surtout une opération où la continuité l’emporte sur le changement. Plus qu’un virage stratégique, la mise en scène relève d’un art consommé du recyclage des mêmes pièces sur un échiquier trop familier. Il faut maintenant pousser l’analyse pour en décrypter la mécanique réelle.
Coefficient de stabilisation : les cohortes de hyènes ?
À peine la rumeur du remaniement confirmée que la scène politique congolaise s’est transformée en savane au crépuscule, secouée par une agitation inhabituelle. Partis politiques, factions internes et entrepreneurs politiques se sont mis en branle comme une meute de hyènes flairant l’odeur d’une carcasse fraîche. Les réseaux sociaux, eux, se sont couverts de ricanements et de cris numériques, chacun cherchant à mordre un morceau de l’attention publique et à marquer son territoire politique.
Dans cette meute, il y avait de tout. Les hyènes maigres, affamées, prêtes à déchiqueter la moindre parcelle de pouvoir. Les hyènes au ventre plein, déjà rassasiées mais refusant de lâcher la moindre once de ce qu’elles possèdent.
Parmi elles, une figure presque caricaturale, qui avait tapissé tout son bastion d’images présentant Tshisekedi comme futur prix Nobel de la paix, comme si un comité chargé de décerner ce prix siégeait discrètement dans un bureau poussiéreux de Lingwala. Une loyauté surjouée, presque théâtrale, couronnée par un fauteuil de vice-ministre. Faut-il y voir la prime à la flatterie ou la crainte d’un rugissement public mal placé ?
Ce choix révèle une vérité politique implacable que même auréolé d’un mandat renouvelé, un président reste prisonnier d’alliances fragiles, de pactes tacites et de dettes anciennes. Dans cette savane politique, chaque coup de griffe peut déclencher une riposte collective. Réduire la taille du gouvernement ou y injecter un « souffle nouveau » devient alors un exercice d’équilibriste, où la survie dépend moins de la force que de la capacité à négocier avec les charognards.
Ce remaniement ressemble moins à une chasse maîtrisée qu’à un partage silencieux autour d’une carcasse déjà à moitié consommée. Félix Tshisekedi, encerclé par des ricanements qui ne s’éteignent jamais, a peut-être compris qu’en politique congolaise, il faut parfois nourrir les hyènes, juste assez pour qu’elles ne vous dévorent pas vivant. On imagine déjà, lors du prochain conseil des ministres, combien riront de la panique que le Président avait semée en leur annonçant que, pour beaucoup, c’était un au revoir, c’était la fin avant que les mêmes ne lui disent à nouveau bonjour.
Les brebis resteront toujours des brebis. L’oncle Scar festoie. Mais alors, qu’en est-il des fauves ? Tous casés comme mandataires publics pour les apaiser ?
En cherchant à analyser de manière rigoureuse les rares évictions du gouvernement, le triage, qui a été remplacé, comment certains profils ont été déplacés, et selon quelle logique apparente, on se heurte à un mur. Rien ne justifie clairement ces choix, rien ne leur donne un sens mesurable ou une cohérence, même politique. Tout se déroule comme si le remaniement relevait moins d’une stratégie réfléchie que d’un exercice arbitraire, où la rationalité cède la place aux calculs opaques et aux compromis de coulisse. Et surtout, que les hyènes du gouvernement avaient resserré les rangs, chassant en meute plutôt que de laisser la moindre ouverture pour être abattues.
V-index ?
Dans les rangs de l’opposition, certains exultent. Fayulu et Kabund, figures de proue de la contestation, brandissent un « V », persuadés d’avoir réussi à pousser Tshisekedi dans ses retranchements. Selon eux, pris dans un contexte de tensions politiques croissantes et confronté à une hostilité palpable, le chef de l’État n’aurait pas réussi à attirer de nouvelles forces vives dans son gouvernement. Il aurait été contraint de reconduire les mêmes personnalités déjà dénoncées par l’opinion publique, non par choix stratégique ou conviction, mais parce que ceux qu’il courtisait ont décliné ses propositions.
Parmi ces refus, un épisode retient particulièrement l’attention est celui d’un proche collaborateur de Joseph Kabila, actuellement poursuivi par la justice. Selon plusieurs sources, cet acteur politique aurait été approché pour rejoindre l’équipe gouvernementale, mais aurait catégoriquement refusé. Ce geste, venant d’une figure déjà controversée, a été immédiatement exploité par l’opposition comme un symbole fort, la preuve que même parmi les profils les plus inattendus, certains préfèrent rester à distance plutôt que de s’asseoir à la table de Tshisekedi.
Pour l’opposition, qu’elle soit non armée ou armée, chaque refus devient une pièce à conviction de plus dans le dossier d’un président affaibli, obligé de négocier en position défensive. Dans leur récit, Tshisekedi n’est plus l’architecte de son gouvernement, mais un invité forcé d’accepter les conditions imposées par ceux dont il a besoin. C’est un partage du gâteau politique où il ne définit plus ni la taille des parts, ni la liste des convives.
Cette interprétation, évidemment à charge, ne tient pas seulement à l’idée de faiblesse personnelle. Elle sert à ancrer l’image d’un président obligé de plier face aux exigences de ses interlocuteurs, de céder le contrôle symbolique du banquet politique et, par là même, d’admettre que le menu comme les parts sont désormais dictés par d’autres. Pour Tshisekedi, ce récit est dangereux, non pas parce qu’il est entièrement exact, mais parce qu’il alimente l’idée que le véritable pouvoir de décision s’est déjà déplacé ailleurs.
Co-variable ?
Tshisekedi cherche-t-il à envoyer le signal qu’il se prépare à lancer les assises nationales que ses opposants et le clergé appellent de leurs vœux, un dialogue national qui, selon eux, devrait s’ouvrir au plus vite, et que certains, via Kigali et ses pions M23-AFC, tentent carrément d’imposer ? Si ce calcul existe, il n’est pas anodin car céder habilement à cette pression permettrait d’éviter de reconnaître implicitement qu’aucune solution militaire ou sécuritaire n’est envisageable à court terme pour le Nord-Est du pays.
Tout le monde savait qu’un remaniement, aussi spectaculaire soit-il, ne mettrait pas fin à l’occupation du Nord-Est. Les Congolais avaient placé ce dossier comme priorité absolue, tout comme l’amélioration de l’image du pays à l’étranger. La plupart des membres reconduits dans ce gouvernement traînent des accusations persistantes, détournement de fonds, mauvaise gestion, népotisme ou autres pratiques douteuses. Reconduire un tel casting envoie un signal désastreux, tant aux citoyens qu’aux partenaires étrangers de celui d’une tolérance, voire d’une indifférence, face à la mauvaise gouvernance.
Sur le plan intérieur, ce recyclage assumé fragilise davantage le lien de confiance entre les institutions et la population. Chaque scandale passé non sanctionné devient un rappel que l’impunité reste la règle, et que les promesses de rupture ne sont que des slogans de circonstance. Sur le plan extérieur, il mine la crédibilité du pays auprès des partenaires bilatéraux et des investisseurs, qui voient là la confirmation que la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion n’est pas une priorité réelle.
Dès lors, deux lectures sont possibles. La première : Tshisekedi prépare un repli stratégique, acceptant de figer la situation actuelle pour ménager le temps nécessaire à des négociations internes et à une recomposition des alliances. Une sorte de « pause » dans l’action frontale, destinée à repositionner ses pions avant le coup suivant. La seconde : il a décidé de miser tout son capital politique sur un pari externe, qu’un changement dans la donne régionale ou internationale viendra soudainement rééquilibrer la partie.
Dans cette seconde hypothèse, il parie sur l’effet d’un « trump » dans le jeu à travers un événement inattendu qui renverserait les dynamiques actuelles en sa faveur. Ce pourrait être un basculement diplomatique, par exemple, un affaiblissement des soutiens régionaux du M23-AFC, ou une recomposition des alliances à l’échelle continentale, modifiant le rapport de force sur le terrain. Mais c’est un pari risqué car attendre que les circonstances extérieures dictent l’issue de la partie, c’est accepter une posture plus réactive que proactive, tout en assumant la présence prolongée de ministres dont la réputation ternie pourrait miner sa crédibilité.
Reste à savoir si cette « pause pour mieux jouer » relève d’une stratégie patiente et calculée ou d’un rapport de force défavorable qui le contraint à temporiser. Dans l’arène congolaise, chaque temps mort offre aux adversaires l’occasion d’avancer leurs propres pièces, tandis que les humiliations, militaires, diplomatiques et surtout socio-économiques, se profilent à l’horizon. Il n’est pas certain que le président, même entouré de toutes les hyènes, jeunes et vieilles, locales et importées, puisse encore conserver la maîtrise du tempo.
Jo M. Sekimonyo
Économiste politique, théoricien, militant des droits des humains et écrivain