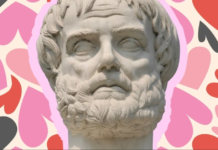La mine de cuivre-cobalt de Kalando, située dans la province riche en minerais du Lualaba, a été le théâtre d’une catastrophe qui révèle, une fois de plus, les ombres profondes du secteur minier artisanal congolais. L’effondrement d’un pont de fortune emprunté par des dizaines de creuseurs a entraîné la mort d’au moins 32 personnes, selon les autorités provinciales. D’autres sources, notamment un rapport du SAEMAPE, évoquent un bilan pouvant atteindre 40 morts.
Les premières images qui ont circulé montrent des corps repêchés dans des eaux stagnantes et boueuses. Les gestes des sauveteurs, lents, désemparés, témoignent d’une réalité trop familière : on ne retrouve pas seulement des victimes, on retrouve des Congolais emportés par un système qui ne leur laisse d’autre choix que de défier la mort pour espérer manger.
La mine de Kalando n’était pas ouverte au public. Les fortes pluies de la saison avaient rendu le sol instable, les parois fragiles, et les galeries dangereuses. Pourtant, chaque jour, des dizaines d’hommes tentaient d’y pénétrer. Dans cette partie du pays, perdre l’accès à un site artisanal, même temporairement, revient pour beaucoup à perdre la seule source immédiate de revenus. La fermeture administrative n’annule ni la faim, ni les nécessités familiales, ni les dettes quotidiennes. Les creuseurs y allaient donc malgré les risques, par nécessité plus que par défi.
Les tensions entre creuseurs, coopératives locales et l’entreprise détentrice de la concession minière avaient atteint un niveau critique. La présence d’hommes en uniforme autour de la mine ajoutait un climat de suspicion et de peur latente, devenu presque banal dans plusieurs zones minières du pays.
La panique, puis la chute
Les circonstances exactes restent à clarifier, mais ce qui est établi, c’est que quelque chose a provoqué une panique brutale parmi les creuseurs. Certains parlent de cris, d’autres de mouvements brusques d’hommes armés autour du site. Toujours est-il que les mineurs, paniqués, se sont rués vers une passerelle de fortune construite au-dessus d’un bassin rempli d’eau de pluie.
Cette passerelle, faite de planches récupérées et d’un assemblage sommaire de cordages, n’avait jamais été conçue pour supporter une foule affolée. Sous la pression, elle s’est rompue. Ceux qui étaient déjà engagés sur le pont ont été précipités dans l’eau. Beaucoup n’ont pas eu le temps ou la force de remonter à la surface. Les survivants racontent la même scène : des cris étouffés, des mains qui s’accrochent à des planches, des silhouettes qui disparaissent dans la turbidité.
Le pont n’a pas simplement cédé sous le poids des hommes. Il a cédé sous le poids d’un paradoxe national : celui d’un pays immensément riche, mais où des citoyens meurent pour quelques kilos de minerais non transformés.
Le triangle explosif des mines artisanales
Autour de Kalando, trois acteurs se croisent et s’opposent sans véritable harmonie : les creuseurs artisanaux qui cherchent à extraire clandestinement les minerais pour survivre, la coopérative qui détient un rôle officiel mais peine à imposer son autorité et des règles claires, et l’opérateur industriel qui exploite légalement la concession mais n’arrive pas à contrôler les intrusions massives sur le site.
Dans ce chaos administratif, économique et humain, la présence des forces de sécurité accentue les tensions. Les uniformes dans les mines symbolisent en même temps l’autorité, le danger et parfois l’arbitraire. Dans certaines zones minières, la militarisation n’apporte ni sérénité ni discipline — elle impose une peur permanente. C’est dans ce contexte que survient une catastrophe comme celle de Kalando.
Au niveau mondial, le cobalt extrait de cette région est indispensable à la révolution technologique contemporaine. Il entre dans les batteries des véhicules électriques, dans les smartphones, et dans les systèmes de stockage énergétique. Sans cobalt congolais, une partie du monde moderne s’arrêterait net.
Pourtant, dans les villages environnants, la richesse du sol ne se traduit ni en infrastructures, ni en écoles, ni en hôpitaux, ni même en passerelles solides pour sauver des vies. Le contraste est violent : les mêmes minerais qui alimentent l’innovation mondiale entraînent ici l’effondrement de ponts de fortune.
Chaque fois que l’on parle du cobalt comme d’un « or bleu », il faudrait aussi rappeler l’existence de ces réalités brutes : les vies perdues, les conditions de travail dangereuses, les tensions sociales, la pauvreté persistante et la présence de plus en plus visible d’enfants dans certaines zones minières artisanales.
Pourquoi ces drames se répètent
La catastrophe de Kalando n’est pas un événement isolé, mais le symptôme d’un mal profond.
Les textes de loi existent, mais leur application demeure lente, inégale, parfois inexistante. Les coopératives censées encadrer les creuseurs souffrent d’un manque criant de transparence et de moyens. Les entreprises minières, souvent étrangères, sécurisent leurs sites mais sans s’attaquer aux racines socio-économiques qui poussent les creuseurs à risquer leur vie.
Les communautés locales, quant à elles, voient les minerais quitter la terre sans que leur quotidien ne change. Elles constatent que les routes vers les mines sont plus praticables que les routes vers les écoles. La logique du cobalt ne suit pas les circuits des besoins humains.
Dans cet écosystème, un simple pont en bois devient l’emblème d’un déséquilibre national. Il s’effondre parce que tout le système repose déjà sur des fondations fragiles.
Ce que la RDC doit affronter maintenant
À Kalando, les corps ont été sortis de l’eau. Les cris se sont tus. Mais ce silence est un appel. Il appelle à une réforme profonde du secteur artisanal, à une clarification des responsabilités entre coopératives, entreprises et autorités, à une démilitarisation progressive des sites miniers, à une amélioration urgente des infrastructures de sécurité.
Il appelle aussi à une refonte du modèle de développement minier congolais. Tant que les communautés locales ne bénéficieront pas réellement des richesses extraites sous leurs pieds, tant que l’économie de survie prévaudra, tant que la justice ne s’appliquera pas de manière égale à tous les acteurs, les drames comme celui de Kalando continueront.
Le pont de Kalando était fragile. Le secteur minier artisanal l’est tout autant. Et la confiance entre population, autorités et entreprises minières l’est encore davantage.
Rebâtir un simple pont ne suffira pas. Il faudra rebâtir des politiques publiques. Rebâtir une gouvernance minière. Rebâtir la dignité des travailleurs. Rebâtir une économie qui protège ceux qui risquent leur vie pour extraire des minerais dont ils ne verront jamais les bénéfices.
Kalando n’est pas seulement le lieu d’un drame. C’est un miroir. Il reflète un pays à un carrefour : celui d’une transformation attendue depuis trop longtemps, celui d’une prise de conscience que les morts dans les mines ne peuvent plus être un fait divers, mais un scandale national.
Tant que ces vies continueront de s’éteindre dans l’indifférence, le cobalt congolais portera le poids de ses propres martyrs.
NBSInfos.com