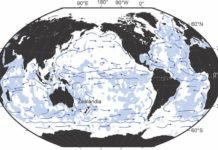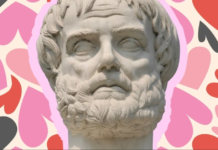Dans cette lettre ouverte que j’adresse à mes compatriotes congolais, je ne prétends révéler aucun secret. Sous le règne de Félix Tshisekedi, plus encore que durant les décennies précédentes, nos dirigeants sillonnent les capitales étrangères comme des pèlerins essoufflés, cherchant leur salut dans des promesses de capitaux venus d’ailleurs. Ils accumulent voyages, forums, panels et signatures à grand spectacle qui s’évaporent dès que les projecteurs s’éteignent. Cette incapacité actuelle est aggravée par l’héritage toxique laissé sous Joseph Kabila. On a vendu à l’opinion l’idée que privatiser équivalait à moderniser, alors qu’il ne s’agissait que de brader nos biens stratégiques au profit d’intérêts étrangers. Dans tous ces schémas, la nation se retrouve toujours dépossédée de ses leviers économiques, affaiblie dans sa souveraineté et amputée de son propre pouvoir de projection économique.
Ce qui manque à la RDC, ce sont les mécanismes modernes capables de les transformer en puissance économique. Si notre pays concentre l’extrême pauvreté, c’est parce que les Congolais demeurent enfermés dans un pays à revenu médiocre acceptent de voir malmené par une élite incapable d’imaginer l’architecture financière qui permettrait à notre propre valeur de circuler, de se multiplier et de produire enfin la prospérité attendue. On présente la privatisation comme une réforme et seule voie de trouver les moyens de se développer, alors qu’en réalité elle n’a été qu’un bradage déguisé des ressources nationales. Chaque actif cédé est un levier perdu, un futur sacrifié, une souveraineté amputée. On a besoin d’une approche qui suit une logique inverse. Elle devra partir de ce que nous possédons déjà, qu’il s’agisse de foncier, de redevances minières ou de recettes fiscales futures, et en fait des instruments financiers capables de générer plusieurs fois plus que leur simple vente. Elle doit multiplier la valeur au lieu de l’éteindre. La privatisation réduit la nation. Mais comment la propulser ?
Le malentendu central réside dans notre vision même du développement. Nous imaginons qu’il dépend de la quantité d’argent disponible, comme si l’économie n’était qu’un vide à remplir. Dans cette logique, le capital n’est qu’un stock de terrains, de machines ou de minerais. Pourtant, la force d’une économie moderne ne tient pas à ce qu’elle possède, mais à ce qu’elle sait activer. La véritable réponse est donc la capitalisation de l’économie, c’est-à-dire la création et l’usage d’instruments financiers modernes capables de transformer nos actifs en leviers. Une telle transformation exige un savoir précis, mais surtout un écosystème adéquat pour porter ces outils et en démultiplier les effets.
Mauvaises théories = mauvaises politiques
Lorsque The General Theory paraît en 1936, l’économie mondiale est à terre. L’Amérique compte des millions de chômeurs, l’Europe glisse vers la guerre et la monnaie reste enchaînée à l’or. À cette époque, les néoclassiques affirmaient que l’État ne peut presque rien faire et que toute dette ou tout déficit relève d’une faute morale. Keynes brise cette orthodoxie en soutenant que l’État doit intervenir massivement pour éviter l’effondrement, même au prix de déficits élevés. Mais il demeure un homme de son époque. Son obsession était l’inflation, et donc la monnaie elle-même, car dans un système indexé sur l’or, toute perte de valeur menaçait la stabilité de l’État. Il rappelait que dépenser comporte un risque, que la dette doit être remboursée vite, que le déficit n’est acceptable que dans des situations d’urgence extrême. Cette vision correspondait parfaitement à son temps, un monde sans monnaie fiduciaire et sans liberté monétaire, jusqu’à ce que les années soixante-dix brisent définitivement le lien entre monnaie et or. Pourtant, grand nombre des économistes continuent à répéter les réflexes keynésiens comme des prières, alors que les fondations mêmes de ce cadre historique ont disparu.
À partir des années quatre-vingt-dix, une autre réalité s’impose et un autre courant d’idées émerge, le MMT. Il rappelle qu’un État souverain dans sa propre monnaie n’est pas limité comme un ménage ou une entreprise. Il peut créer autant de liquidité que son économie peut absorber. La seule véritable frontière est la capacité du pays à produire des biens et des services. L’inflation n’apparaît que lorsque la création monétaire dépasse cette capacité réelle. Tant que la production suit, la monnaie injectée peut financer le développement sans déstabiliser l’économie. Les nations avancées l’ont compris depuis longtemps. Elles utilisent leur monnaie comme un instrument, jamais comme une source de peur. Leur vigilance ne porte plus sur l’inflation, mais sur la santé de l’économie, l’emploi, l’accès aux soins et la confiance des consommateurs.
La RDC, elle, reste enfermée dans des réflexes d’un autre siècle. Nous sommes obsédés par le taux de change comme si sa stabilité suffisait à bâtir une économie. Nous redoutons l’inflation comme si notre monnaie était encore liée à un métal. Nous considérons toute dette comme un péché. La confusion qui continue de guider nos politiques vient d’un attachement aveugle, ancré dans la nation et entretenu par nos institutions académiques, à un Keynes cité machinalement, sans jamais rappeler le monde qui a façonné ses idées. Avec ce logiciel mental, nous menons des politiques élémentaires, nous gouvernons un pays du 21e siècle avec des idées du 20e , dans une économie qui continue de fonctionner comme au 19e pendant la colonisation.
Nous sprintons dans la mauvaise direction
Le gouvernement nous présente des maquettes de villes nouvelles sous les applaudissements, comme s’il suffisait de couler du béton pour créer du développement. Les Congolais ont-ils besoin de logements ? Oui. Existe-t-il une demande solvable capable de les acheter ? Absolument pas. Construire des maisons simplement parce que la population en a besoin est une erreur keynésienne et néo-MMT mal comprise. Une ville sans acheteurs n’est pas une vision économique. C’est un futur cimetière de béton. Les nations avancées ont depuis longtemps abandonné cette logique qui, partout où elle a été appliquée, a produit des centres de pauvreté, des ghettos et des HLM sans horizon.
Mis à part ma position idéologique sur le rôle de l’État, il faut reconnaître que cette même confusion fondamentale a condamné des projets comme Bukanga Lonzo avant même que les premiers plants ne sortent de terre. Le problème n’était pas l’ambition. Le problème était une pensée économique archaïque qui confond besoins et demande. C’est cette erreur qui fait surgir des aéroports où presque personne ne peut voyager et où aucune compagnie aérienne privée viable ne peut réellement opérer, des universités que les étudiants n’ont pas les moyens de fréquenter, érigées dans des villes où les professeurs n’ont ni les moyens ni l’envie de vivre. Et même l’idée d’un Inga géant présenté comme une solution miracle alors qu’un projet de cette ampleur ne doit jamais répondre à un besoin, mais à une demande solvable capable d’en garantir la viabilité. On bâtit pour combler un manque, sans jamais se demander qui pourra réellement acheter, utiliser ou soutenir ce que l’on construit. Sans consommateurs solvables, il n’y a pas de marché. Sans marché, tout projet s’étouffe, la qualité des services s’effondre, les produits meurent et les infrastructures se vident peu à peu. En RDC, les projets ne s’écroulent pas parce qu’ils sont trop ambitieux. Ils s’écroulent ou s’ajoutent sur les gâchis parce qu’ils s’adressent à un public qui n’existe pas, un public sans pouvoir d’achat et sans capacité d’utiliser ce que l’on érige pour lui. Ce n’est pas le pays qui manque d’idées. C’est la demande qui manque d’oxygène.
La différence entre besoin et demande est la pierre angulaire de toute économie moderne. Le communisme s’est effondré précisément parce qu’il voulait satisfaire les besoins plutôt que stimuler une demande solvable. Une économie ne survit pas avec des besoins. Elle vit d’acheteurs. Elle prospère lorsque les citoyens peuvent consommer, investir, emprunter, produire et vendre. Construire une économie, ce n’est donc pas distribuer des biens. C’est fabriquer des acheteurs.
Peut-on créer des acheteurs en imprimant de la monnaie ? Oui, mais intelligemment
La plus décisive des actions est de rompre avec notre dépendance maladive aux billets. La monnaie scripturale, celle qui circule électroniquement, est le seul rempart contre les fuites, les détournements, les circuits opaques et les paniers percés qui engloutissent nos finances, mais elle facilite aussi d’irriguer toute l’économie des stéroïdes financiers et de renforcer chacune de ses veines. Les économies avancées ont compris depuis longtemps qu’une nation moderne ne peut plus fonctionner avec du papier. La monnaie scripturale n’est pas un gadget technologique. Elle représente la colonne vertébrale d’une économie contemporaine. Encore faut-il que la monnaie créée trouve sa contrepartie dans la richesse produite. Elle ne doit pas flotter dans le vide. Elle doit se matérialiser dans l’économie réelle, là où la valeur se construit réellement.
Imaginons que l’on crée de la monnaie scripturale pour construire une route. Pour que cette création monétaire reste saine, toutes les dépenses du chantier doivent être locales, payées en francs congolais et dirigées vers des ouvriers, des matériaux et des entreprises du pays. Tant que l’argent circule dans ce circuit national, il ne crée aucune pression sur le dollar et ne fait pas monter les prix. La route avance, l’activité augmente et la monnaie injectée se transforme en richesse réelle. Le problème apparaît uniquement si l’on crée des francs pour acheter des biens importés. Dans ce cas, le chantier devient une machine à réclamer des dollars et affaiblit notre propre monnaie. D’où la nécessité d’un véritable écosystème national, où les projets publics s’appuient d’abord sur l’expertise locale et sur les matériaux produits au pays. Une politique monétaire responsable finance la route et l’économie congolaise. Elle ne doit jamais financer les économies étrangères.
La méthode compte autant que le principe. Cette dynamique ne peut prendre forme que si l’on construit un environnement financier moderne, entièrement congolais, capable de porter et de multiplier ces instruments. Cela exige une discrimination positive assumée en faveur des Congolais, afin de permettre l’émergence de banques locales, de coopératives de crédit communautaires, d’institutions financières de proximité et de plateformes nationales de paiement. Sans ces structures, le crédit reste étranger, les profits s’exilent et la monnaie s’évapore hors du pays. Avec elles, la création monétaire devient un moteur de croissance, un générateur d’emplois et un incubateur d’institutions durables.
Et donc la dédollarisation ne devrait jamais être une affaire de souveraineté blessée ou d’ego national. Elle devrait être perçue comme une stratégie simple et lucide qui consiste à retirer les menottes qui nous entravent et à poser enfin le pied sur la pédale de l’accélérateur. En somme, il s’agit simplement de jouer le même jeu que les économies avancées, qui trichent à ciel ouvert depuis des décennies.
La magie
Le développement est une mécanique, pas une charité, même lorsqu’il prend la forme de payement directs, de programmes sociaux ou de repas scolaires. C’est une science structurée, non une succession d’intuitions. En refusant de le comprendre, nous avons produit un imaginaire appauvri où l’incapacité économique se change en frustration collective. Et cette frustration, faute d’être transformée en projets, se déverse dans un populisme tribal qui fabrique des excuses primitives et irrationnelles pour tuer. Ce glissement installe des logiques de mort, transforme des territoires entiers en clairières de violence et nourrit l’émergence de groupes armés ethnocentriques qui prospèrent sur la fragmentation nationale et excitent les appétits de nos voisins.
La capitalisation représente cette capacité à transformer des revenus futurs, des actifs dormants ou des ressources inutilisées en financement immédiat. La RDC continue de courir derrière le capital extérieur, alors que son véritable handicap est l’absence de mécanismes capables d’activer ce qu’elle détient déjà. La valeur est là. Elle attend. Elle sommeille.
Les États-Unis offrent l’exemple le plus emblématique. Ils n’ont pas créé un boom immobilier en accumulant de l’argent, mais en inventant des instruments. En regroupant les hypothèques, en les transformant en titres financiers et en transférant le risque sur de nouveaux marchés, ils ont multiplié la capacité de crédit par dix ou vingt. Les ménages n’avaient pas soudainement plus d’argent. Le pays avait simplement créé les mécanismes permettant de convertir des paiements futurs en financement immédiat. C’est ainsi que l’accession à la propriété a explosé. Le moteur du marché américain n’a jamais été la richesse disponible, mais la sophistication des instruments capables de la mobiliser.
La Chine a suivi une logique différente mais tout aussi audacieuse. Elle a financé des villes entières en capitalisant le futur. Les gouvernements locaux ont empaqueté les recettes foncières à venir dans des obligations, puis se sont endettés massivement en pariant sur la croissance. Ils ont construit avant que les revenus n’existent, convaincus que les infrastructures finiraient par les créer. La Chine n’a pas couru après le capital. Elle a transformé ses perspectives de croissance en actifs financiers. Ce sont ces instruments, et non une pluie d’argent étranger, qui lui ont permis de bâtir en vingt ans ce que d’autres pays tentent encore de réaliser depuis leur naissance.
La Corée du Sud, elle, a industrialisé son économie par le design financier. Le gouvernement a garanti les prêts, orienté le crédit et mobilisé les banques pour atteindre des objectifs industriels précis. Chaque secteur stratégique a reçu son mécanisme financier, son levier sur mesure. Le pays n’a pas attendu d’être riche pour agir. Il a fabriqué la liquidité dont il avait besoin, exactement là où elle était nécessaire.
La leçon est universelle. Les nations puissantes ne mendient jamais l’argent. Elles le fabriquent. Pendant qu’ailleurs on construisait des marchés du crédit robustes, des mécanismes de titrisation sophistiqués et des outils financiers capables de transformer n’importe quel actif en levier, nous étions occupés à brader nos richesses sous la tutelle d’institutions qui nous apprenaient à liquider plutôt qu’à multiplier. Le résultat est brutal. Nous courons après des capitaux que nous pourrions créer nous-mêmes, si seulement nous savions organiser et amplifier ce que nous possédons. Ce pays n’est pas condamné à l’aumône. Il est simplement prisonnier d’une élite et d’une population enfermées dans un imaginaire médiocre qui nourrit le populisme tribal et empêche toute vision économique sérieuse. La RDC n’a pas besoin de courtisans obsédés par les voyages officiels, ni de keynésiens attardés qui confondent encore l’inflation de 1936 avec la réalité de 2025, ni des émotionnels politiques et nains intellectuels qui transforment sans cesse la nation en champ de barbarie médiévale. Elle a besoin de magiciens, des stratèges qui savent transformer la démographie et les ressources naturelles en instruments financiers, en flots de liquidité, en leviers de puissance. Au bout du compte, tout dépend du ratio du contrat social.
Jo M. Sekimonyo, PhD
Économiste politique, théoricien, militant des droits humains, écrivain et chancelier de l’Université Lumumba