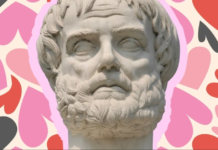La Banque centrale du Congo naît dans un contexte où l’État cherche à affirmer sa souveraineté monétaire tout en héritant d’une économie ouverte et vulnérable aux pressions extérieures. Conçue comme le garant de la monnaie nationale et de la stabilité financière, la BCC est officiellement définie par la Constitution comme l’autorité émettrice du franc congolais. Elle détient les fonds publics, assure la sécurité du système financier, exécute la politique monétaire et conseille le gouvernement en matière économique. La Constitution précise aussi que la Banque centrale est indépendante et bénéficie d’une autonomie de gestion. Cette indépendance n’est pas une marge de manœuvre discrétionnaire. Elle constitue une protection institutionnelle destinée à empêcher que la monnaie et les réserves nationales deviennent des outils politiques entre les mains du pouvoir exécutif.
La même Constitution rappelle un principe fondamental. Le budget de l’État, qu’il s’agisse des recettes ou des dépenses, doit être adopté chaque année par une loi votée par le Parlement. Ce principe d’autorité budgétaire signifie que l’usage des ressources nationales ne peut s’effectuer sans validation des représentants du peuple. Les réserves internationales que la Banque centrale gère ne sont donc pas des actifs techniques détachés du contrôle démocratique. Elles font partie du patrimoine public. Même si la BCC peut les utiliser pour maintenir la stabilité du marché monétaire ou prévenir des tensions financières, elle ne peut engager ces fonds de manière extraordinaire ni les orienter vers des objectifs économiques majeurs sans un fondement légal précis. La frontière entre action monétaire et décision budgétaire est ici capitale.
Le cadre légal opérationnel de la BCC précise ces limites. L’Ordonnance-loi de juin 1967 ainsi que la loi organique de décembre 2018 définissent l’organisation interne de la Banque centrale ainsi que ses pouvoirs en matière de change. Ces textes l’autorisent à intervenir sur le marché des devises afin d’en assurer la stabilité. Toutefois, cette mission s’exerce dans un pays profondément dollarisé où près de 90 pour cent des transactions importantes se réalisent en dollars et où l’épargne, les loyers et les importations sont structurés autour de la devise américaine. Dans cette réalité hybride, chaque intervention de la BCC sur le marché de change ne relève pas uniquement d’un geste technique. Elle touche directement l’économie quotidienne et transforme les prix, les revenus et la confiance du public. C’est précisément cette interaction complexe entre dollarisation, souveraineté monétaire et gestion des réserves qui rend d’autant plus sensible toute intervention exceptionnelle.
Le fait rapporté
Lorsque la Banque centrale du Congo annonce en août 2025 avoir injecté cinquante millions de dollars dans les banques commerciales afin de « stabiliser le franc congolais », la nouvelle fait rapidement la une de la presse économique. D’après les informations relayées par plusieurs médias, l’opération provient d’un communiqué officiel de la BCC, présenté comme une intervention technique destinée à calmer les tensions sur le marché de change. Pourtant, dans un pays où l’économie est profondément dollarisée et où le taux de change guide le prix du pain, du carburant, des loyers et même des frais scolaires, une injection de cette ampleur ne peut être considérée comme une simple routine monétaire. La rapidité avec laquelle le marché a réagi, propulsant le franc de 2900 à environ 2100 pour un dollar, montre que l’opération a eu un impact bien plus profond qu’une stabilisation ponctuelle. Elle a modifié les équilibres économiques sensibles du pays, ce qui oblige à examiner attentivement sa base légale.
Il existe des circonstances dans lesquelles une telle intervention ne poserait aucune difficulté constitutionnelle. Si les cinquante millions injectés proviennent strictement des réserves internationales de la BCC, et si l’opération s’inscrit dans le cadre normal de la politique monétaire autorisée par les textes fondateurs, alors la Banque centrale agit dans ses prérogatives. Les lois congolaises en matière de change lui donnent la latitude nécessaire pour acheter ou vendre des devises afin de lisser la volatilité et maintenir un fonctionnement ordonné du marché. Dans une économie où les variations de change peuvent rapidement provoquer des paniques, ces actes relèvent de l’indépendance opérationnelle reconnue à la Banque centrale. Ils n’exigent pas, en principe, une autorisation préalable du Parlement.
Toutefois, la question devient beaucoup plus sensible dès lors que les fonds utilisés ne proviennent pas uniquement des réserves autonomes de la BCC mais qu’ils empruntent, de manière directe ou indirecte, des ressources relevant du budget général de l’État. Si l’opération a mobilisé des dépôts du Trésor public, ou si elle a entraîné une perte financière assimilable à une dépense publique non autorisée, elle aurait dû être encadrée par une loi de finances votée par le Parlement. Dans ce cas, l’intervention constituerait un empiétement manifeste sur le domaine réservé à l’autorité budgétaire. Le principe constitutionnel voulant que toute dépense ou mobilisation de fonds publics soit validée par les représentants du peuple aurait été contourné. C’est précisément ce flou entre l’usage normal des réserves et un possible prélèvement sur les ressources nationales qui alimente aujourd’hui les interrogations sur une éventuelle violation de la Constitution.
Là où Wameso a clairement franchi la ligne
Lorsque Wameso présente l’injection de cinquante millions de dollars comme une opération de stabilisation, il tente de donner à son geste l’apparence d’une action technique ordinaire. Pourtant, l’évolution du marché démontre l’inverse. Le taux de change, propulsé brutalement de 2900 à environ de 2100 francs congolais pour un dollar, une chute de 30 %, traduit une volonté manifeste de réévaluer la monnaie nationale. Une stabilisation véritable se contente de réduire la volatilité, elle n’impose pas un choc de trente pour cent en quelques jours. Un tel mouvement, rare et risqué, bouleverse les prix, les revenus et les anticipations de toute l’économie. Il reflète donc une intention politique plutôt qu’un ajustement monétaire. L’intervention de Wameso n’a rien d’une mesure technique. Elle révèle un choix stratégique qui dépasse le cadre réglementaire normal d’une banque centrale.
Cette intention apparaît encore plus clairement lorsque l’on rappelle les déclarations publiques du gouverneur de la BCC, qui a affirmé vouloir “contraindre les Congolais à abandonner le dollar et à revenir au franc congolais”. Dans une économie où la dollarisation structure les salaires, les loyers, l’épargne et les importations, une telle ambition représente un changement profond de politique économique. Elle ne relève absolument pas des pouvoirs d’un gouverneur de banque centrale. La dédollarisation est une orientation nationale qui engage le gouvernement, le Parlement et les acteurs économiques, car elle touche directement à la structure monétaire, fiscale, sociale et commerciale du pays. Ce projet dépasse totalement le mandat constitutionnel de la BCC, qui n’a pas pour rôle de dicter les choix monétaires des ménages ou de remodeler les comportements économiques par la contrainte. En cherchant à utiliser les réserves internationales pour appuyer son appel à une dédollarisation forcée, Wameso a détourné des ressources publiques pour servir une vision politique personnelle et non une obligation institutionnelle.
La violation devient manifeste lorsque l’on examine la frontière constitutionnelle entre indépendance monétaire et empiètement sur la politique économique. L’autonomie de la Banque centrale vise à protéger la stabilité des prix, non à permettre à son gouverneur de mener des réformes structurelles qui appartiennent au domaine réservé du gouvernement. En agissant pour “forcer” un abandon du dollar, Wameso s’est substitué aux autorités compétentes et a transformé son rôle technique en mission politique. Il a utilisé une opération de change pour modifier la structure monétaire du pays, ce qui relève d’une décision nationale et collective, et non d’une initiative personnelle exécutée sans débat. La BCC n’a aucune prérogative pour imposer la dédollarisation, et encore moins pour engager les réserves internationales à cette fin. En franchissant cette limite, Wameso n’a pas seulement commis un excès de pouvoir. Il a posé un acte qui soulève une question constitutionnelle majeure : un gouverneur de banque centrale peut-il redessiner la politique économique du pays sans mandat démocratique ? Dans ce cas précis, les faits montrent qu’il l’a fait, et qu’il l’a fait en dehors de la loi.
Le Parlement face à ses responsabilités démocratiques
L’utilisation des réserves nationales pour manipuler fortement le taux de change amène une question fondamentale qui dépasse largement la technicité financière. Qui, en République démocratique du Congo, décide réellement de l’usage du patrimoine national ? Dans toute démocratie fonctionnelle, les décisions susceptibles de transformer l’équilibre macroéconomique doivent être débattues et autorisées par les représentants du peuple. Rien de tel n’a eu lieu ici. Cependant, certains avancent déjà un argument séduisant mais dangereux : puisque l’appréciation du franc a fait immédiatement reculer certains prix, pourquoi critiquer une mesure qui allège le quotidien de millions de Congolais ? Cette logique populiste revient à applaudir une baisse des prix obtenue par la contrainte, qui n’a rien à voir ni avec l’inflation ni avec la croissance économique, mais simplement avec un réajustement artificiel des prix affichés en francs congolais. C’est l’équivalent d’applaudir une baisse de la criminalité obtenue en suspendant l’état de droit et en pendant des innocents sur la place publique. Un tel raisonnement confond soulagement immédiat et légitimité institutionnelle, et masque les risques profonds qu’une telle dérive fait peser sur la Nation.
Cette satisfaction immédiate dissimule pourtant un problème bien plus profond. Dans un pays où la dollarisation organise l’économie et où l’extrême pauvreté oriente les comportements, la baisse apparente des prix est un mirage plus qu’un progrès durable. En provoquant une intervention brutale sur le taux de change, Wameso n’a fait qu’agir sur un symptôme visible en laissant intacte la véritable maladie économique. La pauvreté congolaise ne provient pas d’un franc faible, mais d’un chômage massif, d’un emploi précaire, d’un accès quasi inexistant au crédit, d’un tissu productif fragile et d’un marché financier resté à l’état primitif. Une appréciation forcée du franc peut donner l’illusion d’un répit, mais elle érode la confiance des commerçants, affaiblit exportateurs et importateurs, décourage l’investissement local et, surtout, comprime davantage les salaires en francs. Une telle opération, menée sans débat ni cadre institutionnel, ne fait qu’approfondir les vulnérabilités structurelles du pays. En réalité, cette baisse des prix sur le menu en franc congolais agit comme un simple anesthésiant économique : elle soulage un instant, mais elle ne soigne aucune des causes profondes de la crise.
C’est précisément pour prévenir ce genre de dérive que la Constitution protège la séparation des pouvoirs économiques. Le Parlement n’a pas seulement été contourné ; il a été dépouillé d’un acte majeur de souveraineté budgétaire. En déclarant publiquement vouloir forcer les Congolais à abandonner le dollar, Wameso a confirmé qu’il poursuivait un objectif politique et non une mission monétaire. Ses propres déclarations devant les députés ont établi qu’il cherchait à remodeler la structure monétaire du pays, une prérogative qui appartient au gouvernement, aussi plein de canards boiteux soit-il, au Parlement, même lorsqu’il peine à exercer pleinement son rôle, et au débat national, même lorsqu’il est étouffé ou marginalisé. En aucun cas une telle décision ne peut relever de l’initiative solitaire d’un gouverneur.
La violation du principe d’autorité budgétaire, combinée à l’usage d’une contrainte monétaire destinée à produire un résultat politiquement valorisable, suffit pour qu’un élu comme Gode Mpoyi, non pas en tant que professeur ou pasteur mais en tant que représentant du peuple, exige sa démission. Il ne s’agirait pas de punir un individu, mais de sauver le principe même de la gouvernance démocratique, de protéger les réserves nationales et d’empêcher que des décisions lourdes de conséquences économiques échappent une nouvelle fois au contrôle de la Nation. Et puisque monsieur André Wameso Nkualoloki aurait sans doute déjà eu le temps d’accumuler des moyens suffisants, sa démission lui offrirait l’occasion de retourner sur les bancs universitaires, d’approfondir ses études, de saisir enfin la différence entre politique monétaire et politique économique, et peut-être même d’obtenir un PhD, d’écrire et de financer la publication d’un article scientifique pour aider à dissiper durablement cette confusion qui hante aujourd’hui des esprits comme le sien et son entourage.
Jo M. Sekimonyo, PhD
Économiste politique, théoricien, militant des droits humains, écrivain et chancelier de l’Université Lumumba. Prix Nobel d’économie 2026 ?