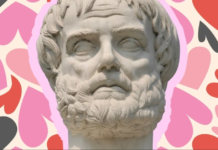Depuis des décennies, les économistes croient que l’être humain agit pour maximiser son bonheur. Or, la plupart du temps, les gens ne font rien. Entre inertie, émotion et nécessité, c’est une autre logique qui gouverne nos comportements. Jo M. Sekimonyo propose une révolution tranquille de la pensée économique : la théorie de l’indifférence.
Depuis près d’un siècle, l’économie repose sur une fiction : celle d’un individu parfaitement rationnel, calculateur, éternellement à la recherche de son propre intérêt.
Inspirée des travaux de von Neumann, Savage et Samuelson, la théorie du choix rationnel prétend que chaque être humain passe sa vie à classer, comparer et sélectionner les options qui maximisent son « utilité ».
Ce paradigme, érigé en vérité scientifique, a façonné les politiques publiques, les stratégies d’entreprise et même la vision que les citoyens ont d’eux-mêmes.
Mais cette élégante construction mathématique se heurte à une évidence : la plupart du temps, les gens n’agissent pas.
Ils reportent, s’abstiennent, s’habituent. Ils tolèrent l’insupportable jusqu’à ce que la vie les force à bouger. L’économie dominante s’est trompée : l’inertie n’est pas une exception, c’est la norme.
Quand l’inaction devient la règle
Les travaux de Herbert Simon sur la rationalité limitée ont reconnu que les individus disposent d’informations et de capacités mentales restreintes. Kahneman et Tversky, avec la théorie des perspectives, ont ajouté que nous évaluons gains et pertes en fonction de repères émotionnels. Puis, l’économie comportementale a empilé les biais : biais du statu quo, aversion à la perte, hyperbolicité du temps, effets de cadrage, vision tunnel liée à la rareté…
Malgré ces raffinements, tous ces modèles conservent la même idée centrale : les individus cherchent à maximiser quelque chose. C’est cette hypothèse même qu’il faut renverser. L’humain n’est pas un optimisateur ; il est un conservateur d’équilibre. Il reste indifférent tant que rien ne l’oblige à agir. Et lorsque l’indifférence s’effondre, l’action surgit brutalement.
La théorie de l’indifférence : une révolution du regard
La Théorie de l’Indifférence propose de comprendre les comportements humains non plus à travers la recherche du « mieux », mais à travers la fin du supportable.
L’individu n’agit pas pour obtenir le maximum, mais pour minimiser la tension entre le désir et la contrainte.
Trois forces déterminent ce basculement :
- La nécessité (Vs) : tout ce qui touche à la survie, au revenu, à la sécurité ;
- Le sentiment (Vse) : l’émotion, la dignité, la colère, l’amour ;
- La faisabilité (Vp) : la possibilité concrète d’agir, la proximité ou l’accessibilité.
Lorsque la somme de ces trois forces dépasse le seuil d’indifférence (T), l’action devient inévitable.
En langage simple :
On ne bouge pas parce qu’on veut plus, mais parce qu’on ne peut plus rester immobile.
Un modèle du passage à l’acte
Cette logique peut se formaliser :
Pa = T − (αVs + βVse + γVp)
La propension à agir (Pa) diminue à mesure que s’accumulent les pressions matérielles, émotionnelles et contextuelles. Quand Pa devient négative, l’indifférence s’effondre.
L’action n’est pas continue, elle est discrète, brutale, souvent inattendue.
Ainsi comprise, la rationalité n’est plus une maximisation des préférences, mais une activation de seuil. L’économie cesse d’être la science du calcul ; elle devient la science du déclenchement.
Trois lois de l’indifférence humaine
- L’engagement plat puis explosif.
De longues périodes d’inaction précèdent des basculements soudains : adoption d’une innovation, révolte politique, conversion, grève, fuite en avant. - L’activation discontinue.
Une émotion, un symbole ou un événement mineur peut suffire à déclencher l’action, même sans changement matériel. - L’hystérésis.
Une fois engagé, l’individu ou le groupe tend à rester actif, même si les conditions initiales s’atténuent ; d’où la persistance des mouvements sociaux ou des vagues d’adhésion.
Ces régularités, observables dans la consommation, la politique ou la santé publique, confirment que la vie sociale n’obéit pas à des courbes lisses mais à des ruptures de seuil.
De l’économie à la société
Cette théorie change aussi notre manière de concevoir les institutions.
Les États, les entreprises et les ONG sont, en réalité, des gestionnaires d’indifférence.
Leur survie dépend de leur capacité à abaisser les seuils : par la persuasion, la publicité, les subventions, les émotions ou la contrainte.
Là où la microéconomie demande : que veulent les gens ? la théorie de l’indifférence demande : qu’est-ce qui finit par les faire agir ?
C’est une différence fondamentale : l’économie cesse de traiter la société comme une somme d’individus rationnels pour la penser comme un ensemble de seuils en tension.
Le cœur politique de l’indifférence
Une société où les seuils d’indifférence sont faibles est une société vivante : les citoyens y participent, s’adaptent, innovent. À l’inverse, des seuils élevés traduisent une inertie structurelle. Même avec des opportunités, rien ne bouge.
C’est là qu’intervient la dimension politique.
Pourquoi certains peuples se soulèvent pour une hausse du prix du pain, tandis que d’autres endurent la misère en silence ? Parce que les seuils d’indifférence diffèrent : culture, institutions, histoire collective façonnent le moment où l’on dit assez.
En Afrique, beaucoup de régimes survivent non par la prospérité, mais par la gestion habile de l’indifférence : entretenir la résignation, distraire, décourager.
Mais cette stabilité est trompeuse.
Lorsque la somme de la nécessité et du sentiment dépasse le seuil, le système se fissure. Les révolutions, les boycotts, les fuites massives ne sont pas des anomalies ; ce sont des effondrements d’indifférence.
Vers une science de l’activation
La théorie ouvre une voie nouvelle : celle d’une science de l’activation.
Plutôt que de mesurer des préférences, il s’agit d’identifier les seuils, les poids et les signaux qui précèdent le mouvement.
Les outils existent : les modèles logit et probit, longtemps réservés aux économistes, peuvent désormais servir à mesurer la propension à agir.
Mais au-delà des chiffres, l’enjeu est moral et social : comment bâtir des sociétés où l’on n’attend pas d’être acculé pour bouger ? Comment transformer l’indifférence en participation ?
Une société prospère n’est pas celle où tout le monde est satisfait, mais celle où les seuils d’indifférence sont bas, où l’on agit sans contrainte, par conscience, par solidarité, par dignité.
Le renversement final
En dernière analyse, la Théorie de l’Indifférence renverse la question centrale de l’économie. Là où la théorie du choix rationnel demande : que veulent les gens ? elle demande : qu’est-ce qui les fait enfin bouger ?
La rationalité n’est plus la poursuite infinie du bonheur, mais la capacité d’agir lorsque l’équilibre de l’indifférence se rompt. C’est une révolution tranquille : comprendre non pas ce qui devrait arriver, mais quand et pourquoi quelque chose arrive enfin.
Dans un monde saturé d’opportunités mais paralysé par l’apathie, comprendre les seuils d’indifférence devient un impératif politique. Car c’est là, dans cette frontière invisible entre la résignation et le sursaut, que se joue le destin des peuples.
Va-t-on assister, en 2026, à l’entrée du deuxième lauréat noir dans l’histoire du prix Nobel d’économie et, fait inédit, à un Congolais ? L’histoire hésite encore… tic tac.
Jo M. Sekimonyo est économiste et philosophe congolais.
Fondateur du concept d’Ethosisme, il consacre ses travaux à la refondation de la pensée économique autour de la justice sociale, de la participation et du sens.
Ses essais et tribunes explorent les intersections entre économie politique, comportement humain et gouvernance mondiale.