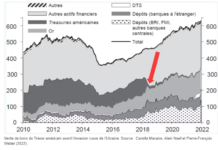Emmanuel Ndjoke Dibango croyait au pouvoir du destin qui lui avait permis de vivre tant d’aventures. Pour commencer, celui de quitter Douala, au Cameroun, où il est né en 1933, et où il avait connu ses premiers émois musicaux à l’église. Son père était trésorier et sa mère chef de chœur. Pourtant, une carrière musicale était hors de question dans une famille qui décidait d’envoyer son enfant étudier en France pour qu’il revienne inévitablement, pensaient-ils, comme avocat ou médecin.
Pendant les vacances d’été, il se rendait dans des colonies organisées pour les jeunes camerounais. C’est là que son aîné Francis Bebey l’initie à la musique jazz. Bientôt, Manu choisit le saxophone, et tout en poursuivant ses études, il commence à jouer au Monaco, un club de jazz à Reims, en France. Là, vêtu d’un costume et d’un chapeau de style Lester Young, il a rapidement oublié ses devoirs et a raté son diplôme d’études secondaires. Quand son père l’a su, il a complètement coupé son fils avec un mois de retard
Un de ses amis ivoiriens l’a présenté à son cousin Fax Clark, qui tenait un club à Bruxelles, Le Tabou. Un bon compromis, pensait-il, pour pouvoir se produire le soir et continuer l’école le jour. Mais la vie nocturne l’a vite emporté sur les études diurnes. Il devient le chef d’orchestre du club Les Anges Noirs, oubliant ses études, sans savoir que l’histoire avec un grand H, lui avait réservé une voie et le ramènera en Afrique.
De Bruxelles à Léopoldville (Kinshasa)
En janvier 1960, alors que le Cameroun français vient d’acquérir son indépendance, les Congolais négocient la leur à Bruxelles, lors de la « Table ronde belgo-congolaise ».
Manu : « Quand Lumumba (et les autres) sont arrivés au moment des Tables Rondes, ils ont voyagé avec Kabasele (et son orchestre, l’African Jazz qui enregistrait à l’époque le fameux « Independence cha-cha »). Chaque soir, quand ils avaient fini de parler politique, les Tshombés, les Kalonjis, les Lumumbas… ils se dirigeaient vers le club. Mobutu aussi… il était encore journaliste à l’époque. Je n’ai pas parlé avec Lumumba, mais j’ai beaucoup discuté avec Bomboko, qui était l’un des rares étudiants congolais à avoir été autorisé à aller à l’Université de Louvain [en Belgique]. Vous rendez-vous compte qu’en 1960, le Congo n’avait pas d’intellectuels ? L’élève abandonnait généralement après le certificat scolaire [un diplôme que les élèves de 13 ans devaient passer avant d’entrer dans l’enseignement secondaire, car les Belges ne voulaient pas qu’ils aillent plus loin. Les seuls congolais que l’on voyait à Bruxelles étaient des garçons de maison que des familles belges avaient ramenés pour montrer qu’ils avaient réussi… donc parmi ces rares élèves (il y en avait quatre quand j’y étais), il y avait Bomboko qui venait au club. Comme il n’avait pas d’argent, je lui ai payé des Coca-Colas – vous savez comment font les grands frères… et un jour j’ai allumé ma télé et je vois Bomboko avec le Roi Baudouin [Roi des Belges] . Ils m’ont dit qu’il était ministre et je me suis dit : que diable ! C’est à ce moment-là que je me suis réveillé, et que je me suis aussi réveillé à la politique.
Kabasele venait aussi souvent rendre visite à Manu, et lui proposa finalement de remplacer son saxophoniste malade resté à Léopoldville (plus tard rebaptisé Kinshasa) pour enregistrer une série d’albums lors de son séjour à Bruxelles avec l’African Jazz. « Alors je suis allé en studio avec lui pour jouer du saxo et du piano. C’était un grand succès là-bas à Kinshasa, et je suis devenu célèbre grâce aux enregistrements de Kabasele alors que je n’avais jamais mis les pieds en Afrique. C’était la première fois qu’un orchestre africain enregistrait dans les mêmes conditions que les artistes ici [en Europe] . »
Fort du succès des disques qu’il réalise avec Kabasele, le patron d’African Jazz lui propose de le rejoindre pour une série de concerts en Afrique. Manu Dibango est alors parti un mois avec Coco, son épouse Blanche. Ils y resteront deux ans.
« Je ne connaissais pas l’Afrique. Là, j’ai appris l’Afrique et comment jouer de la musique africaine avec des Africains, en Afrique. Et si la rumba africaine a adopté le musicien, il n’en a pas oublié le jazz, qui était plutôt à la mode à l’Afro-Négro, un club de Léopoldville qu’il a fini par reprendre en offrant à sa femme le poste de caissière. C’est à cette époque qu’il enregistre quelques morceaux pour le studio Ngoma, dont « Ekedy » et « Twist à Léopoldville ». Il y a également amené ses parents, à qui il a finalement présenté Coco. Son père le convainc de retourner au Cameroun, où il ouvre un club, le Tam-Tam, en 1963, amenant avec lui des musiciens congolais. Mais l’expérience n’a pas duré longtemps, car les obstacles se sont multipliés, et les fréquentes descentes de police inattendues ont gâché l’ambiance et finalement ruiné l’entreprise. Il retourne en Europe, et choisit de s’installer à Paris.
De New-York à Kinshasa
La chanson de la face B « Soul Makossa » atteint le sommet des charts américains, et du jour au lendemain, en 1974, Manu quitte les salles de bal pour l’Apollo Theater, la mythique salle de concert Black de Harlem où tous les plus grands s’étaient produits. Pendant dix soirées d’affilée, l’élite des artistes afro-américains (d’Isaac Hayes à Barry White) s’est empressée de le voir se produire, mais aussi le patron du Fania All Stars, puisqu’à l’époque, rappelle Manu, « le Harlem espagnol , revendiquait aussi ses racines africaines. Il s’est retrouvé embarqué pour une tournée folle avec les All Stars du label : à travers les Etats-Unis, mais aussi le Venezuela, le Panama et Porto Rico où le concert a été enregistré et publié sur le célèbre label new-yorkais : « Johnny Pacheco, Ray Barretto, Cheo Feliciano… ce sont des gens que je n’aurais même jamais espéré rencontrer, et encore moins jouer avec eux ».
La folle année 1974 s’achève avec le fameux festival Zaïre 74 qui devait servir de prélude au combat de boxe Ali vs Foreman. Manu s’y est rendu avec le crew Fania (dont Celia Cruz), BB King, James Brown, et bien sûr Franco et Rochereau, pour n’en citer que quelques-uns, sans oublier Miriam Makeba , la seule artiste d’Afrique qui avait rencontré le succès aux Etats-Unis, avant Dibango.
Le lion indomptable
Puis sa fameuse face B oubliée de 1972 refait surface de manière inattendue en 1982 lorsque Michael Jackson utilise le refrain de « Soul Makossa » sur son album Thriller, pour la chanson « Wanna Be Startin’ Somethin’ » sans en avertir l’auteur-compositeur. L’affaire serait finalement réglée à l’amiable, avec une concession (financière) entre les deux parties. Et encore jackpot vingt ans plus tard, avec l’affaire Jennifer Lopez. Et une autre fois… quand Rihanna a décidé de reprendre le fameux refrain, et a par erreur crédité Michael Jackson (une telle méconnaissance laisse parfois perplexe).
On savait déjà que le coronavirus l’avait attrapé, ses fans s’étaient dit que le vieux lion indomptable allait pouvoir clore ce dossier, une fois de plus. Mais pas cette fois , à 86 ans, le 24 mars 2020, notre oncle africain est parti pour de bon. Il est parti pour « une nuit au village » (« Soir au village », chanson qu’il enregistre en 1974), rejoindre les ancêtres qui l’attendent : Le Grand Kallé, Rochereau, Nino Ferrer, Ray Barretto, Alain Bashung et Jacques Higelin. … et tant d’autres musiciens avec qui il a partagé les scènes et écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de la musique, et de notre Histoire, congolaise.
NBSInfos