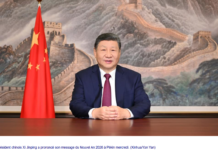Les manifestations menées par des jeunes qui ont finalement renversé le président malgache Andry Rajoelina ont été déclenchées, en partie, par sa tentative d’utiliser des projets d’infrastructures urbaines à grande échelle comme moyen de consolider son pouvoir.
Le gouvernement Rajoelina a placé les grands projets urbains au cœur de sa stratégie d’affirmation de pouvoir et de légitimité. Ces projets lui ont permis de générer et de canaliser des rentes vers des alliés clés, tout en ancrant son pouvoir dans l’histoire et le territoire malgaches. Ils visaient également à transformer les imaginaires spatiaux et politiques de l’État par des visions monumentales de modernité et de développement. Par imaginaires spatiaux et politiques, j’entends les manières controversées dont les dirigeants et les citoyens imaginent l’espace et le pouvoir, ainsi que ce à quoi devraient ressembler une ville moderne et un gouvernement légitime.
Pourtant, ces projets n’ont guère répondu aux besoins de la plupart des Malgaches. Ceux qui auraient pu y parvenir, comme les programmes de logements sociaux, sont restés inachevés ou mal réalisés.
Lorsque Rajoelina, arrivé au pouvoir par un coup d’État en 2009, a été réélu pour un troisième mandat fin 2023, sa légitimité était déjà profondément contestée. Des mois de coupures quotidiennes d’électricité et d’eau dans la capitale, Antananarivo, conjugués à l’inauguration d’un téléphérique très énergivore , ont déclenché des manifestations qui ont finalement conduit à son renversement.
Après trois semaines de manifestations intenses dans les grandes villes, Rajoelina a fui le pays. L’armée a pris le pouvoir , suspendu la Constitution et dissous les principales institutions politiques et judiciaires. Elle a annoncé une période de transition.
Ce n’est pas la première fois depuis l’indépendance en 1960 que l’armée intervient. Rajoelina a été renversé par la même unité d’élite, le CAPSAT , qui l’avait aidé à prendre le pouvoir en 2009.
Depuis quatre ans, je mène une thèse de doctorat sur les politiques d’urbanisme et de développement urbain à Antananarivo. À partir de ces travaux, cet article montre comment les stratégies urbaines mêmes par lesquelles Rajoelina cherchait à consolider son pouvoir ont contribué à sa chute. Lorsqu’il est devenu évident que les projets d’infrastructures urbaines ne répondraient pas aux besoins sociaux urgents, ils ont rapidement suscité désillusions et colère.
Mes recherches et l’effondrement du régime mettent en lumière les pièges que présente le recours à des projets d’infrastructures à grande échelle pour acquérir une autorité politique dans un système politique extrêmement instable et compétitif.
Construire le pouvoir et la légitimité grâce au capital
S’appuyant sur la jeunesse désillusionnée par l’approche de son prédécesseur, le président Marc Ravalomanana, Rajoelina est arrivé au pouvoir en 2009 grâce à un coup d’État .
À seulement 35 ans, Rajoelina, ancien DJ et dirigeant d’entreprises de presse écrite et médiatique, incarnait le renouveau et les espoirs de la jeunesse malgache. Il a dirigé un gouvernement de transition jusqu’en 2013, puis a été élu en 2018. Face à un mécontentement populaire croissant, l’opposition a boycotté les élections de 2023 .
Dès le début, Rajoelina a placé la construction d’infrastructures à grande échelle au centre de son agenda politique.
À Antananarivo, de nombreux « projets présidentiels » ont été lancés. Parmi ceux-ci figuraient un téléphérique, un train urbain, une ville nouvelle, des colisées, des stades et des logements sociaux. La plupart d’entre eux étaient peints aux couleurs orange du régime. Ils étaient stratégiquement situés dans des zones très visibles de la capitale et de sa périphérie. Parallèlement, Rajoelina a remanié l’histoire nationale et le territoire en renommant des sites clés de la ville .
Comme je l’ai déjà expliqué , ces initiatives ont joué un rôle crucial dans les tentatives de Rajoelina de consolider son autorité politique. Le développement des infrastructures a constitué une source importante de rentes qu’il a exploitées pour s’assurer la loyauté de ses principaux alliés et centraliser davantage le pouvoir présidentiel.
Ces projets étaient également symboliques, alliant tradition et modernité. Ils offraient l’occasion de mettre en scène des spectacles d’État visant à légitimer un régime de plus en plus autoritaire.
Quand les symboles du pouvoir se retournent contre eux
Mais le spectacle s’est retourné contre son orchestrateur. Si certains projets étaient depuis longtemps contestés , la désillusion a atteint son paroxysme en 2025. Les projets présidentiels ont cristallisé la colère populaire grandissante face à la corruption du régime et à la dégradation des conditions de vie.
En février 2025, dans la municipalité d’Imerintsiatosika, à 30 km à l’ouest de la capitale, des manifestations ont éclaté en réaction à la menace de confiscation de terres et d’expulsion. C’est là que la nouvelle ville de Tanamasoandro devait devenir une potentielle nouvelle capitale.
Fin août 2025, le téléphérique, enfin mis en service quelques heures par jour, plus d’un an après son achèvement, a ravivé la controverse sur les priorités budgétaires du gouvernement. La grande majorité de la population ne peut se permettre le téléphérique ; 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Le coût mensuel de la télécabine est estimé à 162 000 € (188 725 $ US). Dans une ville où les coupures de courant sont devenues monnaie courante, les factures d’électricité sont estimées à 1 000 € (1 000 $ US).
Loin de servir de symbole de progrès et de modernité, le « plus long téléphérique d’Afrique » est devenu l’incarnation de la déconnexion de Rajoelina avec les besoins de la population et de la corruption d’un régime perçu comme au service uniquement de ses élites.
La bataille pour l’espace urbain
L’étincelle qui a déclenché la crise actuelle a été l’ arrestation violente de conseillers municipaux de l’opposition, le 19 septembre. Ces derniers avaient exigé du Sénat qu’il s’attaque aux pénuries d’eau et d’électricité et à leurs graves conséquences pour la population.
Plus de 50 % des entreprises ont signalé des pannes d’électricité, avec 6,3 pannes par mois typiques, d’une durée moyenne de 3,9 heures chacune, coûtant aux entreprises en moyenne 24 % de leur chiffre d’affaires annuel, selon une étude de la Banque mondiale sur l’économie du pays de février 2025. Environ 20,5 % des entreprises ont connu en moyenne deux pénuries d’eau par mois. Les coupures de courant ont duré jusqu’à 12 heures par jour au cours des semaines précédant le coup d’État. Les étudiants, les familles pauvres et les vendeurs ambulants ont été durement touchés, car ils n’avaient pas les moyens de s’acheter des générateurs.
Inspirés par les soulèvements de la génération Z à travers le monde, les jeunes Malgaches sont descendus dans la rue le 25 septembre. Ce qui avait commencé comme des manifestations pour les services publics de base s’est rapidement transformé en une contestation plus large du régime de Rajoelina. Artistes, syndicats, organisations de la société civile et responsables politiques ont rejoint le mouvement.
Au cœur des manifestations se trouvaient deux des places les plus symboliques d’Antananarivo sur le plan politique . Le jardin d’Ambohijatovo, rebaptisé Place de la Démocratie (Kianjan’ny demokrasia) par Rajoelina lui-même en 2009, avait auparavant accueilli 35 000 de ses partisans opposés à Ravalomanana. Le 1er octobre, les manifestants ont réussi à y accéder après avoir affronté la police, marquant une victoire symbolique importante pour le mouvement.
Dix jours plus tard, le 11 octobre, des manifestants, rejoints désormais par des éléments de l’armée, ont pris le contrôle de la place du 13 mai (Kianjan’ny 13 mai), centre symbolique des protestations politiques malgaches depuis les années 1970.
Rajoelina a tenté de contrer le mouvement. Il a appelé ses partisans à se rassembler au Colisée d’Antsonjombe, construit pendant la transition (2009-2013). Il était alors présenté comme le « plus grand espace socioculturel de l’océan Indien et d’Afrique ».
Mais le Colisée, qui était plein lors de son inauguration en 2012, est désormais vide , illustrant l’isolement du président.
Les manifestants ont également pris pour cible des symboles clés de la présidence. Le siège de l’imprimerie de Rajoelina a été incendié, tout comme le téléphérique et les gares du train urbain . Les trains urbains n’avaient jamais été mis en service.
Ce que Rajoelina avait voulu être des symboles de puissance et de modernité est ainsi devenu des symboles d’échec. Ils ont mis en lumière la légitimité disparue de Rajoelina et les fondements fragiles d’un pouvoir largement fondé sur la représentation.
La vie après la mort des infrastructures urbaines
Le cas de Rajoelina illustre que la construction d’infrastructures peut être une stratégie à double tranchant. Elle peut servir à affirmer son pouvoir dans des contextes autoritaires, mais elle risque de se retourner contre lui lorsqu’un régime n’a pas les moyens de réaliser ses ambitions. Les projets urbains de Rajoelina ont d’abord captivé l’imagination des jeunes et de la population en général. Mais, faute de répondre aux besoins sociaux pressants, ils ont rapidement suscité désillusions et colère.
Un responsable de la municipalité d’Antananarivo m’a confié fin 2022 que le téléphérique, imposé unilatéralement par la présidence, était une « épine dans le pied » des autorités municipales et « risquait de devenir un éléphant blanc ». On pourrait en dire autant de tous les projets d’infrastructures présidentielles, indissociables d’un régime tombé en disgrâce.
Le cas de Madagascar soulève des questions plus vastes sur la pérennité des projets d’infrastructures urbaines étroitement associés aux dirigeants déchus. Comment seront-ils entretenus, réaffectés ou abandonnés ? Quelles conséquences auront-ils sur la gouvernance urbaine et nationale, la vie et les espoirs des habitants, et sur l’imaginaire du pouvoir dans les années à venir ?
Fanny Voélin
Doctorant en géographie, Université de Berne