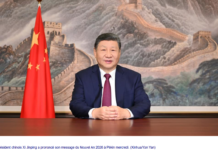Ceux qui accèdent au pouvoir par un coup d’État tombent souvent par les mêmes moyens . C’est l’un des enseignements à tirer des événements de Madagascar, où le 14 octobre 2025, l’ armée a pris le pouvoir après des semaines de manifestations largement menées par la génération Z.
Ironiquement, c’est la même unité militaire d’élite qui a contribué à porter au pouvoir Andry Rajoelina , ancien maire de la capitale Antananarivo, lors d’un coup d’État en mars 2009 qui a désormais soutenu les manifestants anti-gouvernementaux et a finalement forcé le président à fuir.
Je dirige une équipe de recherche qui compile l’ ensemble de données Colpus sur les types et les caractéristiques des coups d’État et j’ai écrit sur l’histoire des coups d’État de 1946 à 2025.
Nos données suggèrent que, même si les coups d’État ont globalement diminué à l’échelle mondiale, le risque de coup d’État demeure relativement élevé en Afrique. Depuis 2020, le continent a connu dix coups d’État réussis dans huit pays.
Mais le coup d’État militaire à Madagascar n’est que le deuxième coup d’État de cette période à avoir lieu en dehors de la région du Sahel , qui s’étend de l’Atlantique à la Corne de l’Afrique – un signal que le problème des coups d’État en Afrique devient un problème continental.
Mais pourquoi certains coups d’État réussissent-ils et d’autres échouent-ils ? Et pourquoi Madagascar et plusieurs États africains peinent-ils à échapper aux pièges du coup d’État ?
Nos données apportent quelques réponses. Mais il convient d’abord d’explorer ce que nous entendons par « coup d’État ».
Qu’est-ce qu’un coup d’État ?
Un coup d’État est une prise du pouvoir exécutif impliquant une ou plusieurs actions concrètes, observables et illégales de la part de personnels de sécurité ou de fonctionnaires civils.
Ici, la prise de pouvoir militaire à Madagascar semble justifiée. Malgré les affirmations du nouveau chef militaire du pays, le colonel Michael Randrianirina, selon lesquelles il avait reçu une ordonnance de la Haute Cour constitutionnelle légitimant sa prise de pouvoir, ces déclarations semblent contredites par les déclarations de la veille selon lesquelles le conseil militaire de Randrianirina avait suspendu les pouvoirs de la Haute Cour.
Cela ne veut pas dire que tout événement politique qui ressemble à un coup d’État est, en fait, un coup d’État.
De nombreux complots de coup d’État ne se concrétisent jamais. Un complot de bonne foi peut être déjoué et ses auteurs arrêtés, ou bien ces derniers peuvent abandonner leur plan avant même d’avoir pris des mesures concrètes. De plus, il arrive qu’un dirigeant invoque à tort un complot pour purger des membres du gouvernement soupçonnés de déloyauté.
Un complot sans tentative de renverser le dirigeant ne constitue pas, à nos yeux, un coup d’État.
À l’inverse, les tentatives visant à cibler un dirigeant sans plan de prise de pouvoir ne constituent pas des coups d’État. Cela inclut les tentatives d’assassinat d’un dirigeant par des opposants politiques ou des loups solitaires, ou les mutineries de soldats mécontents qui pourraient même marcher sur le palais présidentiel pour exiger des augmentations de salaire, des promotions ou d’autres concessions politiques.
La plupart des soulèvements de masse menés par des civils n’entraînent pas de coup d’État, même s’ils parviennent à renverser le gouvernement. Prenons l’exemple du Népal, où, en septembre, une manifestation menée par la génération Z a dégénéré en violence et renversé le gouvernement. Mais il n’y a pas eu de coup d’État dans la mesure où l’ armée est restée cantonnée au lieu de participer activement aux manifestations ou de menacer le Premier ministre de démissionner.
Cependant, certaines révolutions et certains coups d’État se produisent simultanément, ce qui donne lieu à une « coup-révolution » ou à un « coup d’État de fin de partie ».
Déterminer si un coup d’État s’accompagne de manifestations antigouvernementales dépend du comportement des élites et de l’armée, et non du degré de violence des manifestants.
À Madagascar, des manifestations civiles, majoritairement pacifiques, ont tourné à la tentative de coup d’État lorsque des troupes ont activement participé aux manifestations. Cette tentative a réussi lorsque Randrianirina , commandant de la force d’élite CAPSAT, a revendiqué la présidence par intérim et a insisté sur le fait qu’un conseil militaire gouvernerait temporairement.
Pourquoi les coups d’État réussissent-ils ?
Selon notre base de données, 601 tentatives de coup d’État ont eu lieu depuis 1946 , dont 299 ont réussi, soit environ 50 %. En Afrique, durant cette période, 111 des 225 tentatives de coup d’État ont réussi.
Les coups d’État se présentent sous diverses formes, avec des causes et des conséquences différentes , et leurs chances de réussite ne sont pas toutes égales. Les événements de Madagascar, cependant, remplissent de nombreuses conditions pour déterminer la réussite d’un coup d’État.
Les coups d’État reposent sur la coordination de nombreuses personnes, tout en empêchant le dirigeant d’en découvrir l’existence. Les manifestations de masse comme celles qui ont secoué Madagascar ces dernières semaines offrent une couverture – ainsi qu’un mobile et une opportunité – aux putschistes.
Paradoxalement, la force militaire est rarement décisive. Lors d’une tentative de coup d’État classique, une grande partie de l’armée reste neutre, attendant le moment opportun pour voir qui, du chef ou des putschistes, l’emportera. Par conséquent, la perception de la dynamique des événements influence la réaction des militaires de base : s’ils pensent que les putschistes réussiront, ils adhèrent généralement ; s’ils pensent que le coup d’État échouera, ils s’y opposent généralement.
La dynamique d’un coup d’État dépend de divers facteurs, notamment de l’identité, de la localisation et de la stratégie des dirigeants du coup d’État , ainsi que des réactions nationales et internationales au coup d’État.
Les coups d’État non violents, lancés par des membres du gouvernement et des officiers supérieurs dans la capitale, qui suscitent une mobilisation massive en faveur du coup d’État, sont ceux qui ont le plus de chances de réussir. À l’inverse, les coups d’État sanglants, lancés par des personnes extérieures au gouvernement et des officiers subalternes hors de la capitale, qui suscitent une mobilisation massive et féroce contre le coup d’État, sont ceux qui ont le plus de chances d’échouer.
La violence des coups d’État est inversement proportionnelle à leur succès. Lorsqu’aucune force n’est menacée – généralement parce que les forces de sécurité restent unies sous un commandement supérieur –, les coups d’État réussissent dans 85 % des cas.
En revanche, moins de 40 % des coups d’État qui dégénèrent en violences dignes d’une guerre civile – c’est-à-dire entraînant plus de 1 000 morts – réussissent.
À Madagascar, nous avons constaté l’implication des élites gouvernementales et des officiers supérieurs de la capitale, une mobilisation massive en faveur du coup d’État, de faibles niveaux de violence et un historique de coups d’État réussis – autant d’éléments qui rendent le succès du coup d’État probable.
Madagascar n’est pas seul
Depuis 2020, des acteurs militaires ont également pris le pouvoir lors de coups d’État au Burkina Faso, au Tchad, au Gabon, en Guinée, au Mali, au Niger et au Soudan.
Alors pourquoi tant de pays africains sont-ils enclins à tomber dans le piège d’un coup d’État ?
Les chercheurs se posent cette question depuis des décennies. L’économiste du développement Paul Collier suggère que l’Afrique est la région la plus exposée aux coups d’État car c’est la plus pauvre du monde, et que c’est la pauvreté et la faible croissance – et la violence politique qui en découle – qui sont à l’origine des coups d’État.
D’autres ont souligné les niveaux élevés de diversité ethnique et une histoire d’ exclusion ethnique et de forces armées ethniques comme facteurs de longue date des coups d’État sur le continent.
Mais depuis 2020, plusieurs autres facteurs semblent également accroître le risque structurel de coup d’État sur le continent. De nombreux pays africains ont constaté une baisse de confiance dans les institutions publiques et les dirigeants, ainsi qu’une montée de la violence terroriste , ce qui a stimulé la popularité massive des récents coups d’État sur le continent.
Les normes anti-coup d’État se sont également affaiblies ces dernières années . La pression internationale pour rétablir un régime civil a été très forte dans les années 1990 et 2000, contribuant au déclin des coups d’État militaires en Afrique . Mais les nouveaux gouvernements africains post-coup d’État semblent plus résilients aux sanctions, coopèrent davantage entre eux et peuvent compter sur le soutien de « patrons » autoritaires, notamment la Russie et la Chine.
En conséquence, les gouvernements africains post-coup d’État restent au pouvoir plus longtemps, ce qui encourage les putschistes d’ailleurs qui voient un environnement plus permissif.
Même si la « contagion des coups d’État » en Afrique a des limites , Madagascar ne sera probablement pas le dernier domino à tomber, compte tenu des conditions structurelles du continent.
Jean-Joseph Chin
Professeur adjoint d’enseignement en stratégie et technologie, Université Carnegie Mellon