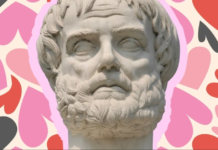Le tourisme de luxe est-il un succès en Afrique ? Que se passe-t-il s’il ne génère pas davantage de recettes touristiques : est-il possible d’inverser la tendance ? Et cela dépend-il du type de gouvernement en place ?
Le tourisme de luxe vise à attirer des touristes fortunés pour séjourner dans des complexes hôteliers haut de gamme ou visiter des sites touristiques exclusifs. Cette stratégie est largement adoptée par les gouvernements du monde entier, y compris dans les pays africains .
Elle a été promue par des agences multilatérales comme la Banque mondiale et les Nations Unies , ainsi que par des organisations environnementales et de conservation .
Le principe du tourisme de luxe repose sur l’idée que moins de touristes, mais dépensiers, fréquentent les destinations, ce qui réduit l’impact environnemental. On le qualifie souvent d’approche « haut de gamme, faible impact ».
Cependant, des études ont démontré que le tourisme de luxe n’entraîne pas de réduction de l’impact environnemental. Les touristes fortunés privilégient les jets privés, dont l’utilisation est plus polluante que celle des vols en classe économique. Les partisans du tourisme de luxe occultent également le fait qu’il renforce les inégalités économiques, commercialise la nature et restreint l’accès aux terres pour les populations autochtones.
À certains égards, les motivations des pays africains semblent compréhensibles. Face à des déficits commerciaux croissants, ils souffrent d’un manque criant de devises étrangères. L’attrait du tourisme de luxe paraît presque irrésistible.
Comment avez-vous procédé pour vos études ?
J’étudie l’économie politique du Rwanda depuis près de 15 ans. Le gouvernement rwandais a fait du tourisme un élément central de sa vision nationale. Au fil des ans, de nombreux responsables gouvernementaux et acteurs du secteur touristique ont souligné les difficultés liées aux stratégies de tourisme de luxe. Malgré cela, la priorité accordée au tourisme de luxe demeure inébranlable.
J’ai constaté qu’au Rwanda, le tourisme de luxe engendrait une dépendance envers les hôtels et les agences de voyages étrangers, révélant des pertes potentielles de recettes touristiques. Surtout, le tourisme ne créait pas suffisamment d’emplois. Le secteur souffrait également d’un déficit de compétences. La formation des employés n’était pas assez rapide pour répondre à l’afflux d’investissements dans l’hôtellerie.
J’ai donc décidé d’ étudier les effets du tourisme de luxe dans d’autres pays africains. Je voulais savoir qui en profite et comment on inverse la tendance dans les pays qui s’en détournent.
J’ai interrogé des représentants gouvernementaux, des hôteliers et d’autres acteurs du secteur privé, des responsables de l’aviation, des consultants et des journalistes dans les trois pays. J’ai également procédé à une analyse approfondie des données économiques, des rapports sectoriels et de la littérature grise.
Quels sont vos principaux enseignements tirés de votre voyage à l’île Maurice ?
L’île Maurice fut le premier des trois pays à adopter explicitement une stratégie de tourisme de luxe. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le gouvernement commença à encourager les touristes européens à profiter des attraits balnéaires de l’île. De grands groupes industriels locaux devinrent les principaux investisseurs, construisant des hôtels de luxe et acquérant des terrains côtiers.
Au fil des ans, le tourisme a généré des revenus considérables pour l’économie mauricienne. En 2019, ce secteur rapportait plus de 2 milliards de dollars américains (avant de chuter pendant la pandémie de COVID-19).
Cependant, le tourisme est aussi devenu le symbole des inégalités qui ont marqué la croissance de l’île Maurice. Le modèle des complexes hôteliers tout compris – où les hôtels de luxe prennent en charge l’intégralité des besoins des visiteurs en matière de restauration et de transport – a pour conséquence que l’argent dépensé par les touristes ne profite pas toujours à l’économie locale. Une part importante des bénéfices reste à l’étranger ou est captée par les grands hôtels.
Après la pandémie, le gouvernement mauricien a assoupli sa politique de tourisme axé sur le luxe. Il a ouvert son espace aérien afin d’attirer une clientèle touristique plus diversifiée et a rétabli les vols directs vers l’Asie . Au sein du gouvernement, un consensus se dessine quant à l’impact positif de cette réouverture sur les recettes et l’emploi dans le secteur touristique, d’autant plus que d’autres secteurs clés, comme la finance offshore, pourraient être confrontés à un avenir incertain .
Et du Botswana ?
Le Botswana a emboîté le pas à l’île Maurice en adoptant officiellement une stratégie de tourisme de luxe en 1990. L’accent était mis sur ses zones sauvages (le delta de l’Okavango) et ses lodges de safari. Pendant des décennies, des chercheurs ont critiqué les inégalités au sein du secteur.
La plupart des lodges et hôtels étaient des propriétés étrangères. La plupart des agences de voyages proposant des séjours tout compris étaient basées hors du Botswana. Les liens avec le marché local étaient très limités. La production agricole et industrielle locale était très peu utilisée dans ce secteur.
J’ai toutefois constaté que l’orientation des politiques touristiques était devenue de plus en plus politisée. Certains hommes politiques, de concert avec des organisations de protection de l’environnement et des investisseurs étrangers, privilégiaient le tourisme de luxe. L’ancien président Ian Khama, par exemple, a interdit la chasse aux trophées pour des raisons éthiques en 2014. Il a encouragé le tourisme photographique, où les voyageurs se rendent dans des destinations principalement pour prendre des photos. Mais ses détracteurs affirment que lui et ses alliés ont tiré profit de cette promotion du tourisme photographique.
Le tourisme photographique est étroitement lié à la promotion problématique de zones sauvages « préservées » qui correspondent à des idées étrangères sur le « mythe de l’Afrique sauvage ».
Dès son arrivée au pouvoir, le président Mokgweetsi Masisi a levé l’interdiction de la chasse. Il a fait valoir que cette interdiction avait des conséquences néfastes sur les communautés rurales et exacerbait les conflits entre l’homme et la faune sauvage. Il était convaincu qu’une chasse réglementée pouvait contribuer à une meilleure gestion de la faune et apporter davantage de bénéfices aux communautés.
Depuis la fin des années 2010, le gouvernement du Botswana a assoupli sa politique de tourisme de luxe et s’efforce de diversifier son offre touristique. Il a notamment simplifié les formalités de visa pour les ressortissants asiatiques afin de faciliter l’accès au pays à un plus grand nombre de touristes.
Et le Rwanda ?
Des trois cas étudiés, le Rwanda est le plus récent à avoir adopté une stratégie de tourisme de luxe. Cependant, il demeure le plus engagé dans cette voie. Son modèle repose sur l’observation des gorilles de montagne et des expériences animalières haut de gamme. Il est complété par la volonté du Rwanda de devenir un pôle d’attraction pour le tourisme d’affaires et sportif grâce à l’organisation de conférences et d’événements prestigieux.
Le Rwanda a attiré des chaînes hôtelières internationales (comme Hyatt et Marriott) pour y construire des hôtels et a investi massivement dans son image de marque nationale, notamment en sponsorisant des équipes sportives. Le côté « luxe » du pays est géré par le prix élevé des visites de son principal attrait touristique : l’observation des gorilles de montagne. Le Rwanda est l’un des rares pays abritant cette espèce.
Après la pandémie, le gouvernement a baissé les prix des visites aux gorilles de montagne, mais a également réaffirmé régulièrement son engagement envers le tourisme de luxe.
Qu’avez-vous appris en comparant les trois ?
Je voulais savoir pourquoi certains pays changent de stratégie en matière de tourisme de luxe après un échec, tandis que d’autres ne le font pas.
Il est évident que les stratégies de tourisme de luxe présentent toujours des inconvénients. Comme le montre cette étude, le tourisme de luxe ne profite que très peu d’acteurs (souvent des investisseurs étrangers ou des entités à capitaux étrangers) et ne crée pas suffisamment d’emplois ni n’apporte de bénéfices plus larges aux populations locales. Mes recherches indiquent que les pressions politiques subies par les gouvernements démocratiques (comme le Botswana et Maurice) les ont contraints à assouplir leurs stratégies en matière de tourisme de luxe. Ce ne fut pas le cas au Rwanda, pays plus autoritaire.
La position du Rwanda va à l’encontre de nombreux travaux récents sur l’économie politique africaine, qui soutiennent que les partis ayant une emprise plus forte sur le pouvoir seraient en mesure d’obtenir de meilleurs résultats en matière de développement.
Bien que cela puisse être le cas dans certains secteurs, les conclusions de cette étude suggèrent que les partis politiques plus faibles sont en réalité plus susceptibles de réagir aux changements de politiques créant des inégalités que les pays où les partis politiques au pouvoir sont plus forts.
Pritish Behuria
Maître de conférences en politique, gouvernance et développement, Institut de développement mondial, Université de Manchester