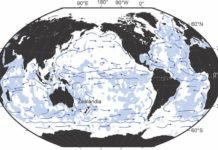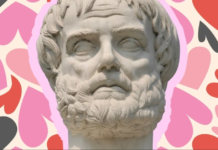Le système commercial mondial qui a favorisé le libre-échange et soutenu la prospérité mondiale pendant 80 ans se trouve désormais à la croisée des chemins. Les récents développements en matière de politique commerciale ont introduit des niveaux d’incertitude sans précédent, notamment les bouleversements causés par le régime tarifaire draconien du président américain Donald Trump.
Cela entraîne des changements fondamentaux dans la manière dont les nations interagissent économiquement et politiquement.
L’idéal du libre-échange
Le libre-échange envisage la circulation des biens et des services à travers les frontières avec un minimum de restrictions. Il s’oppose aux politiques protectionnistes telles que les droits de douane ou les quotas d’importation .
Cependant, le libre-échange n’a jamais existé à l’état pur. Le système commercial mondial fondé sur des règles est né des cendres de la Seconde Guerre mondiale . Il a été conçu pour réduire progressivement les barrières commerciales tout en permettant aux pays de préserver leur souveraineté nationale.
Ce système a débuté avec l’ Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 , signé par 23 pays à Genève, en Suisse.
Au terme de cycles de négociations successifs, ce traité a permis d’obtenir des réductions substantielles des droits de douane sur les marchandises. Il a finalement jeté les bases de la création de l’Organisation mondiale du commerce en 1995.
« Plomberie du système commercial »
L’Organisation mondiale du commerce a instauré des mécanismes contraignants pour régler les différends commerciaux entre les pays. Elle a également étendu le champ d’application du commerce fondé sur des règles aux services, à la propriété intellectuelle et aux mesures d’investissement.
Connu familièrement sous le nom de « plomberie du système commercial », ce cadre a permis au commerce mondial de se développer de manière spectaculaire.
Les exportations de marchandises sont passées de 10,2 billions de dollars américains (15,6 billions de dollars australiens) en 2005 à plus de 25 billions de dollars américains (38,3 billions de dollars australiens) en 2022.
Pourtant, malgré des décennies de libéralisation, le véritable libre-échange reste difficile à atteindre. Le protectionnisme a persisté, non seulement par le biais des droits de douane traditionnels, mais aussi par des mesures non tarifaires telles que les normes techniques. De plus en plus, les restrictions liées à la sécurité nationale ont également joué un rôle.
La nouvelle doctrine commerciale de Trump
L’économiste Richard Baldwin a soutenu que les perturbations commerciales actuelles découlent de la « doctrine des griefs » de l’administration Trump.
Cette doctrine ne considère pas le commerce comme un échange entre pays aux bénéfices mutuels. Elle le perçoit plutôt comme une compétition à somme nulle, ce que Trump décrit comme une « arnaque » des États-Unis par d’autres nations.
Les déficits commerciaux – lorsque la valeur totale des importations d’un pays dépasse celle de ses exportations – ne sont pas considérés comme des conséquences économiques du système commercial. Ils sont plutôt perçus comme un vol.
De même, la doctrine considère les accords internationaux comme des instruments de désavantage plutôt que de bénéfice mutuel.
Les États-Unis se retirent de leur leadership
Trump s’est présenté comme une figure qui réinitialise un système qu’il considère comme truqué contre les États-Unis.
Autrefois, les États-Unis assuraient la défense, la sécurité économique et politique, la stabilité monétaire et un accès prévisible au marché. Aujourd’hui, ils se comportent de plus en plus comme un tyran économique en quête d’un avantage absolu.
Ce changement – d’« assureur mondial à extracteur de profits » – a créé une incertitude qui s’étend bien au-delà de ses relations avec les pays individuels.
Les politiques de Trump ont explicitement remis en cause les principes fondamentaux de l’Organisation mondiale du commerce.
Parmi les exemples, on peut citer son ignorance du principe de la « nation la plus favorisée », selon lequel les pays ne peuvent pas établir des règles différentes pour différents partenaires commerciaux, et des « consolidations tarifaires » – qui limitent les taux de droits de douane mondiaux.
Certains analystes de la politique commerciale ont même suggéré que les États-Unis pourraient se retirer de l’Organisation mondiale du commerce . Ce faisant, ils parachèveraient leur rejet formel de l’ordre commercial mondial fondé sur des règles.
Le défi de la Chine et la réponse des États-Unis
L’émergence de la Chine comme superpuissance industrielle mondiale a profondément modifié la dynamique du commerce mondial. La Chine est en passe de produire 45 % de la production industrielle mondiale d’ici 2030.
Les excédents manufacturiers de la Chine approchent les 1 000 milliards de dollars par an (1 500 milliards de dollars australiens), grâce à d’importantes subventions et à la protection du marché.
Pour l’administration Trump, cela représente un conflit fondamental entre le capitalisme de marché américain et le capitalisme d’État chinois.
Comment les « puissances moyennes » réagissent
De nombreux pays entretiennent des relations étroites avec la Chine et les États-Unis, ce qui les pousse à choisir leur camp dans un environnement de plus en plus polarisé.
L’Australie illustre ces tensions. Elle entretient des liens de défense et de sécurité avec les États-Unis, notamment grâce à l’accord AUKUS. Mais elle a également noué d’importantes relations économiques avec la Chine, malgré de récents différends . La Chine demeure le principal partenaire commercial bilatéral de l’Australie.
Cette fragmentation crée cependant des opportunités de coopération entre « puissances moyennes ». Les pays européens et asiatiques explorent de plus en plus de partenariats , contournant les cadres traditionnels dirigés par les États-Unis.
Toutefois, ces alternatives ne peuvent pas reproduire pleinement l’ampleur et les avantages du système dirigé par les États-Unis.
Les alternatives ne résoudront pas le système
Lors d’un sommet cette semaine, la Chine, la Russie, l’Inde et d’autres membres non occidentaux de l’Organisation de coopération de Shanghai ont exprimé leur soutien au système commercial multilatéral. Une déclaration commune a réaffirmé les principes de l’Organisation mondiale du commerce tout en critiquant les mesures commerciales unilatérales.
Il s’agit d’une tentative de revendiquer un leadership mondial tandis que les États-Unis poursuivent leurs propres politiques avec des pays individuels.
Le bloc plus vaste des « BRICS+ » regroupe le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud et l’Indonésie. Ce groupe a souvent exprimé son opposition aux institutions dominées par l’Occident et appelé à des structures de gouvernance alternatives.
Cependant, les BRICS+ manquent de profondeur institutionnelle pour constituer une véritable alternative au système commercial centré sur l’Organisation mondiale du commerce. Ils manquent de règles commerciales contraignantes, de mécanismes de surveillance systématique et de procédures de résolution des conflits.
Où va le système commercial ?
Le système commercial mondial a contribué à sortir plus d’un milliard de personnes de l’extrême pauvreté depuis 1990. Mais l’ancien système de multilatéralisme mené par les États-Unis a pris fin. Son remplacement reste incertain.
L’une des conséquences possibles serait un affaiblissement progressif des institutions mondiales comme l’Organisation mondiale du commerce, tandis que les accords régionaux gagneraient en importance. Cela préserverait les éléments d’un commerce fondé sur des règles tout en favorisant la concurrence entre grandes puissances.
Les « coalitions de nations partageant les mêmes idées » pourraient établir des normes politiques élevées dans des domaines spécifiques, tout en restant ouvertes à d’autres pays désireux de respecter ces normes.
Ces coalitions pourraient se concentrer sur la libéralisation des échanges, l’harmonisation réglementaire ou les restrictions sécuritaires, selon leurs intérêts. Cela pourrait contribuer à maintenir la stabilité du système commercial mondial.
Nathan Howard Gray
Chercheur principal, Institut du commerce international, Université d’Adélaïde