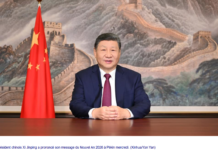Nous avons souvent tendance à penser en reproduisant ce qui a déjà été fait ailleurs, comme si cela allait de soi. Certaines institutions sont ainsi acceptées comme des composantes naturelles de l’État moderne, sans que leur pertinence réelle ne soit remise en question. C’est notamment le cas de la banque centrale et de la monnaie nationale. En RDC, beaucoup les considèrent comme indispensables à la souveraineté économique, au même titre que le drapeau ou l’hymne national. Pourtant, cette conviction mérite d’être examinée de plus près. Trop souvent, nous confondons un héritage institutionnel avec une nécessité structurelle.
Le 30 juin célèbre la souveraineté politique de la RDC. Mais dès les premiers jours de l’indépendance, deux obsessions institutionnelles ont dominé, se doter d’une banque centrale et d’une monnaie nationale, comme s’il s’agissait des conditions absolues de la souveraineté économique. Cette idée, largement héritée des modèles étatiques postcoloniaux, est depuis présentée comme une vérité universelle. Pourtant, rien ne prouve qu’elles soient indispensables à la stabilité ou à la prospérité.
Un simple regard comparatif suffit à relativiser le mythe selon lequel une nation ne peut être souveraine sans banque centrale ni monnaie nationale. Les États-Unis, souvent érigés en modèle, ont déclaré leur indépendance en 1776, mais ce n’est qu’en 1785 qu’ils introduisent leur propre monnaie, le dollar, et en 1913 qu’ils se dotent d’une banque centrale, la Federal Reserve. Autrement dit, la première puissance économique mondiale a fonctionné neuf ans sans monnaie nationale et cent trente-sept ans sans banque centrale.
À l’inverse, la RDC illustre une trajectoire inversée ; sa banque centrale a précédé son indépendance. Dès 1951, la Belgique crée la Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, assortie du franc congolais, pour mieux contrôler économiquement ses colonies. Ce n’est donc pas l’indépendance qui a amené la création de ces institutions, mais bien la logique coloniale elle-même. Le lien que nous continuons de faire entre souveraineté nationale et existence d’une banque centrale ou d’une monnaie nationale relève ainsi davantage d’un héritage colonial que d’un choix économique mûrement réfléchi.
La nomination du gouverneur de la Banque Centrale du Congo, tout comme celle de son directeur de cabinet et de ses adjoints, n’a suscité ni débat public, ni véritable attention médiatique et surtout aucun questionnement sur leurs compétences, ou surtout de leurs expertises, aucune analyse de leur orientation stratégique, comme si cela n’avait aucune incidence. Et c’est peut-être bien le cas. Si une institution censée être centrale peut changer de direction sans provoquer la moindre secousse dans l’économie nationale, c’est qu’elle ne joue sans doute pas le rôle stratégique qu’on lui attribue.
À vrai dire, la Banque centrale du Congo semble s’être réduite à un élément de décor institutionnel, figée dans une posture symbolique héritée de l’indépendance, sans prise réelle sur les dynamiques économiques du pays. Elle incarne davantage une survivance bureaucratique qu’un levier d’action économique.
Parachever le puzzle monétaire
Ce qui choque souvent les étrangers en arrivant en RDC, le dollar ne se contente pas de circuler, il règne. Il est roi dans les grandes entreprises, les loyers, les hôpitaux, les écoles, privées comme publiques, les marchés, les administrations, et même dans ces ruelles poussiéreuses où l’on vend des beignets à l’aube. Dans l’économie informelle, là où l’État est absent, le dollar est souverain. C’est lui qui donne confiance, fixe les prix, inspire la confiance et dicte les règles du jeu. Le franc congolais n’est plus qu’un figurant mal aimé dans une pièce où le dollar tient le premier rôle.
Et pourtant, malgré cette réalité que chacun vit au quotidien, nous refusons d’aller au bout de la logique. Par fierté mal placée, enveloppée dans de grands discours sur la « souveraineté », nous continuons à faire semblant. On imprime des billets que personne n’épargne, on défend une monnaie que personne ne respecte, et on maintient une banque centrale qui coûte cher sans jamais vraiment diriger quoi que ce soit. Toute l’économie congolaise fonctionne déjà au dollar, et elle pourrait très bien fonctionner sans franc congolais du tout. Ce n’est pas une provocation ; c’est une hypothèse réaliste, fondée sur les faits.
Dès lors, pourquoi continuer à entretenir cette fiction institutionnelle ? Pourquoi s’acharner à préserver une monnaie qui se déprécie constamment, qu’on doit produire, protéger, distribuer à grands frais, alors que le dollar fait déjà le travail de confiance, de stabilité et de mesure ? Pourquoi maintenir une banque centrale et une monnaie nationale dont le principal rôle a toujours été de financer artificiellement les déficits publics, d’alimenter une inflation chronique et de servir de guichet politique à court terme ? Alors même que l’expérience de la dollarisation, initiée sous le règne de Kabila et toujours en vigueur, a démontré que la population congolaise sait s’adapter, commercer et innover sans dépendre des caprices d’une politique monétaire qui n’existe que sur papier ?
Supprimer le franc congolais et démanteler la banque centrale, ce n’est pas capituler, c’est se libérer. Ravir à l’État un outil qui, au lieu de servir, permet d’abuser, d’impression monétaire pour combler les déficits, embauches clientélistes, budgets fantômes. Sans cet instrument, le gouvernement serait forcé d’agir avec rigueur, de financer ses promesses avec des ressources réelles, et non de la monnaie sortie du néant.
Faut-il rappeler que des pays comme la France ou l’Allemagne, parmi les plus grandes économies du monde, fonctionnent avec une banque centrale qui n’émet plus sa propre monnaie et ne fixe plus seule ses taux d’intérêt, car ces décisions relèvent désormais de la Banque centrale européenne. D’autres pays, comme le Panama, le Kosovo ou le Monténégro, sont allés encore plus loin. Ils ont renoncé à toute monnaie nationale et n’ont aucun pouvoir sur la politique monétaire de la devise à laquelle ils sont arrimés. Et pourtant, loin d’en être affaiblis, ces États y ont gagné en stabilité macroéconomique, en rigueur budgétaire et en intégration dans les marchés internationaux. De quoi relativiser le fétichisme autour de la souveraineté monétaire.
La dollarisation complète de notre économie impliquerait ni plus ni moins que la mise à mort de la Banque centrale, loin d’être une faiblesse ou une dépendance toxique, pourrait bien être la première étape d’un modèle économique plus sain. Un modèle qui ne repose plus sur des symboles institutionnels, mais sur la discipline, l’efficacité et la vérité des chiffres.
Un pantalon sans poche ?
Lorsqu’on évoque l’idée de supprimer la banque centrale, certains poseront une question légitime : « Si on supprime la banque centrale, où ira l’argent du Trésor public ? ». Or, cette inquiétude ne tient pas. La réalité, c’est que l’État utilise déjà les banques commerciales pour gérer ses finances.
Aujourd’hui, en RDC, les ministères, les entreprises publiques, les provinces et les juridictions administratives disposent tous de comptes dans des banques commerciales. Le paiement des frais de justice, l’enregistrement d’une entreprise, les taxes foncières, les frais de passeport, tout cela se paie dans des agences bancaires privées. Personne ne se rend à la Banque Centrale du Congo pour régler ces opérations. En d’autres termes, l’argent public transite déjà, au quotidien, par le secteur bancaire privé.
Et du point de vue technique, nous n’avons plus besoin d’une banque centrale pour faire circuler l’argent entre les banques. Dans le monde entier, il existe déjà des systèmes de compensation interbancaire « clearinghouses » qui permettent aux banques de se régler entre elles, de manière fluide et transparente. La RDC n’a pas besoin de réinventer la roue, mais simplement de s’intégrer à ce système mondial, déjà opérationnel, efficace, et plus moderne que nos vieilles structures bancaires publiques.
Mais alors, faut-il craindre que l’argent public se retrouve entre les mains de banques privées, souvent à capitaux étrangers ? Pas si l’on agit avec intelligence et volonté politique. Il suffirait d’établir une règle claire : les fonds publics ne peuvent transiter que par des banques dont le capital est majoritairement congolais. C’est une manière concrète d’enrayer la « décongolisation » du secteur financier, sans pour autant tomber dans l’illusion du tout-étatique.
Mieux encore, cette transition pourrait devenir une opportunité d’encourager la création de banques coopératives, de mutuelles de crédit ou de petites banques locales, ancrées dans les territoires et contrôlées par des Congolais. L’objectif n’est pas de tout renationaliser, mais d’éviter que l’argent du peuple ne serve les intérêts exclusifs de groupes financiers étrangers, souvent déconnectés des réalités locales. C’est un équilibre à trouver entre souveraineté économique et modernisation pragmatique du système bancaire.
Et si on garde le cap ?
Si nous avons tant de mal à remettre en question la Banque Centrale du Congo et le franc congolais, ce n’est pas parce qu’ils remplissent efficacement leur mission, mais parce qu’ils sont devenus des symboles sacrés. Des symboles de souveraineté que l’on brandit plus qu’on ne fait fonctionner. Pourtant, dans la réalité, ni la monnaie nationale ni l’institution censée la gérer ne jouent un rôle stratégique dans l’économie congolaise. Le franc congolais est marginalisé dans les échanges, et la banque centrale agit comme une structure d’apparat, bien plus politique que fonctionnelle. Continuer à défendre ces piliers par réflexe ou par fierté revient à confondre souveraineté avec immobilisme.
Alors, si l’on choisit de garder la banque centrale, autant la rendre utile. Elle ne peut plus rester un simple coffre-fort de devises ou une imprimerie d’État silencieuse. Dans un pays comme le nôtre, elle doit devenir un outil actif pour dynamiser l’économie locale, pas simplement un gestionnaire de réserves ou un imprimeur de monnaie silencieux. Elle doit soutenir la création d’un marché du crédit digne de ce nom, stimuler le commerce et l’entrepreneuriat, accompagner la formalisation du secteur informel et renforcer l’accès au logement. Mais cela exige des décisions techniques solides, pas des nominations politiques décoratives. Ce n’est pas de loyalisme ou compétence dont nous avons besoin, mais d’expertise, moderne.
Oui, imprimer de la monnaie peut être un choix économique pertinent, à condition de savoir le faire. L’inflation n’est pas forcément une menace. Quand elle est bien planifiée et incrustée, elle peut soutenir l’investissement, favoriser l’emploi et encourager la circulation monétaire. Encore faut-il avoir une stratégie, et non simplement un réflexe de panique ou une peur irrationnelle du changement.
Le secteur du crédit congolais est encore sous-développé. Sans prêts immobiliers accessibles, il est illusoire d’espérer structurer un véritable marché du logement. Sans système de financement, pas d’urbanisation cohérente, pas de classe moyenne propriétaire, pas de dynamisme territorial. Une banque centrale utile devrait œuvrer à créer ces conditions, comme cela s’est fait ailleurs.
Avant toute chose, il faut cesser de se cacher derrière le dollar, comme le fait depuis trop longtemps l’État lui-même. Un pays qui se dit souverain ne peut continuer à fonctionner avec une monnaie qu’il ne contrôle pas, pendant que l’État collecte, dépense et s’endette massivement en devise étrangère sans même reconnaître cette contradiction flagrante. Loin d’incarner une volonté d’émancipation, l’État organise et entretient cette dépendance. La dédollarisation doit commencer par le secteur public, donc par l’État. Mais ce qu’il appelle « prudence » n’est bien souvent qu’un masque : la peur de décider seul, la peur d’assumer, la peur de gouverner sans le pilotage automatique de l’expertise étrangère ou les directives de la Banque mondiale et du FMI. En renonçant à ses responsabilités les plus élémentaires, l’État montre qu’il ne fait pas confiance à son propre peuple, ni à sa propre capacité à conduire son avenir sans copilote imposé.
La souveraineté véritable ne se résume pas à conserver, par réflexe, des institutions et dogmes hérités du passé, mais à le dépasser avec audace et lucidité. Elle se manifeste dans notre capacité à concevoir et mettre en œuvre des mécanismes alignés sur nos rêves, nos appétits économiques et nos ambitions sociales. Ce n’est pas dans des discours vides sur la macroéconomie que se construit le progrès, mais à travers des politiques bien pensées, des dispositifs concrets, sophistiqués et efficaces, capables de produire des résultats tangibles au service du bien commun, et mettre la prospérité et la dignité, telles qu’elles se vivent dans les pays développés, à la portée du plus grand nombre.
Jo M. Sekimonyo
Économiste politique, théoricien, militant des droits des humains et écrivain