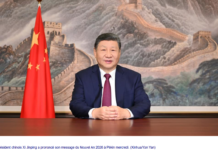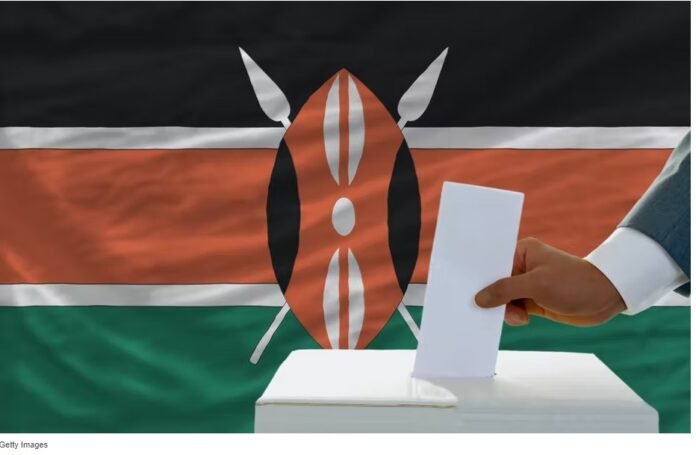Les Kényans se préparent pour une importante élection générale le 9 août 2022, qui mettra fin aux deux mandats tumultueux du président Uhuru Kenyatta.
Il s’agira des septièmes élections générales du pays depuis la reprise de la démocratie électorale multipartite il y a 30 ans. Et c’est le troisième en vertu de la constitution de 2010. La constitution progressiste faisait partie des réformes conçues pour répondre aux animosités politiques qui ont déclenché des violences électorales meurtrières en 2007.
Avec une population de 48 millions d’habitants, le Kenya compte 22 millions d’électeurs inscrits. Près de 40 % d’entre eux sont de jeunes électeurs. Les électeurs sont tenus de voter simultanément pour un président, un sénateur, un membre du parlement, une représentante, un gouverneur de comté et un membre de l’assemblée de comté.
Trois candidats à la présidence, sur les quatre autorisés à se présenter, ont captivé l’imagination du pays. Deux sont clairement en tête du peloton mais il n’y a pas de leader clair. Qu’il n’y ait pas de favori clair à gagner après des mois de campagne fait honneur à la compétitivité et à la liberté relative de l’espace démocratique. Mais cela signifie que ce seront quelques jours tendus jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur qui gouvernera la puissance économique de l’Afrique de l’Est pour les cinq prochaines années.
Les candidats
L’un des deux principaux candidats est Raila Odinga, un ancien Premier ministre qui dirige l’une des deux principales coalitions. Le politicien kényan vétéran de 77 ans se présente aux élections pour la cinquième fois. Il a déjà frôlé la victoire à deux reprises. Le résultat du sondage de 2007 a été vivement contesté, entraînant une violence généralisée au cours de laquelle 1 100 personnes ont été tuées.
Odinga est le fils du premier vice-président du Kenya après l’indépendance, Jaramogi Oginga Odinga. Longtemps considéré comme un candidat anti-establishment, Odinga a une touche commune qui résonne avec les Kenyans qui se sentent exclus de la matrice du pouvoir contrôlée par deux groupes ethniques depuis l’indépendance en 1963 – les Kikuyu et les Kalenjin.
Cette fois, cependant, il est le candidat de l’establishment.
L’autre favori est William Ruto, 55 ans. Le vice-président en exercice est le chef de l’Alliance démocratique unie, le plus grand parti de la coalition Kenya Kwanza (Kenya First). Contre le recul soutenu du titulaire, Uhuru Kenyatta, Ruto est déterminé à lui succéder.
Ruto s’est réinventé en tant qu’agent de la conscience de classe, une question jusque-là absente du discours et de la concurrence politiques du Kenya. En le rebaptisant comme l’antithèse du statu quo et la personnification des espoirs des pauvres, son message a trouvé un écho chez les marginalisés.
Ruto cite fréquemment la Bible. Mais ce penchant apparemment ecclésiastique masque un stratège politique consommé.
Alors que George Wajackoyah du parti Roots a captivé l’imagination du public, lui et David Waihiga du parti Agano sont des aspirants présidentiels marginaux. Les candidats marginaux jouent un rôle important dans le test de maturité des espaces démocratiques. Leurs idéologies et croyances souvent atypiques permettent aux démocraties de rompre avec les thèmes politiques habituels.
L’argent et les élections
Devenir politicien au Kenya est financièrement très attractif. Le salaire versé aux politiciens, ainsi que les avantages sociaux tels que les indemnités de voiture, de logement et de voyage, les bureaux et la pension à vie, sont souvent trop beaux pour être laissés de côté. Il y a un autre facteur qui pourrait stimuler l’intérêt pour le pouvoir politique. Il est probable que l’argent versé aux comtés par le gouvernement national passera de 15 % des recettes totales du pays à 35 %. Pour certains, c’est une raison suffisante pour se lancer en politique – pour suivre l’argent là où il se trouve, apparemment pour servir la société. La vérité est souvent différente.
L’attrait du mandat électif alimente à son tour la concurrence entre les candidats. Certains candidats sont prêts à dépenser plus que d’autres lors des primaires des partis ou coalitions dominants afin d’obtenir un ticket sûr. C’est mauvais pour la démocratie. La nature transactionnelle de la politique réduit les possibilités de débat et de dialogue entre les élus et leurs électeurs.
XN Irakien
Professeur associé, Faculté des sciences commerciales et de gestion, Université de Nairobi