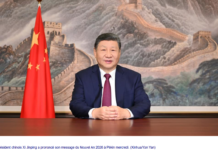Le Jésus historique n’est pas le Christ de la foi. Et il ne faut pas confondre sa recherche avec des études liées à l’histoire de la théologie, ni même à la reconstruction du christianisme primitif.
La recherche qui cherche à établir l’historicité d’un prétendu prophète antique appelé Jésus, qui a vécu en Palestine au 1er siècle, vise également à étudier comment un juif palestinien, avec les caractéristiques physiques et comportementales des hommes de cette région à cette époque, a pu changer le cours de son peuple et d’une grande partie de l’Humanité sans recourir à la violence. Qu’on soit lettré ou analphabète, paysan ou révolutionnaire, opposé ou favorable à Rome, tout est historiquement possible, et aucune réponse définitive n’existe encore et n’existera jamais.
La tentative d’établir l’historicité de Jésus de Nazareth se fait à travers l’étude de son contexte social, culturel, religieux et politique, à partir de concepts historico-philosophiques propres à l’époque. Et, chaque fois que possible, comparées à des sources dites non chrétiennes de la même période, provenant d’autres régions du Moyen-Orient et d’Europe.
Lorsqu’on me demande quel est l’objet historique sur lequel je fais des recherches, je cherche généralement à démontrer la différence entre la recherche du Jésus historique et celle de Jésus-Christ, objet de la foi. En d’autres termes, j’essaie de séparer le physique du métaphysique sur un plan théorique.
La délimitation de l’objet scientifique et de ses diverses caractéristiques est le premier établissement que tout chercheur doit suivre lorsqu’il cherche à dialoguer avec un public moins familier avec les tentatives de conjecturer qui il a pu être dans son humanité.
Étudier Jésus nécessite une perspective interdisciplinaire
Le Jésus historique est un objet d’analyse qui a commencé à recevoir une plus grande attention de la part des sciences sociales à partir des années 1980. Le cadre théorique de ces sciences le situe dans l’espace et dans le temps, et de plus, la recherche de sa connaissance s’appuie sur un cadre théorique littéraire et religieux très riche, et sur une méthodologie consolidée. Étudier Jésus de Nazareth exige avant tout une perspective interdisciplinaire.
Il convient de noter qu’aujourd’hui nous vivons la troisième vague de recherches du Jésus historique, connue sous le nom de Troisième Quête . Nous y cherchons à comprendre la figure d’un Jésus qui s’est comporté dans le contexte de son époque, dans la Palestine du Ier siècle.
Cependant, le cadre organisationnel de la proposition méthodologique centrale de la troisième recherche peut fluctuer en fonction de la perception de l’objet par différents chercheurs et érudits. La grande majorité des chercheurs de ce siècle suivent la division trinitaire (les trois étapes) de la recherche historique sur Jésus.
En « occupant » un lieu social, la recherche du Jésus historique, pour constituer une étude qui aborde l’environnement galiléen précaire de la Palestine du premier siècle, met en lumière des aspects jusqu’alors inexplorés. Selon les mots de l’historien André Chevitarese et de l’archéologue Pedro Paulo Funari, concernant les analyses proposées par le Séminaire de Jésus, et interprétant une lecture analytique de l’œuvre de l’historien John Dominic Crossan, il est soutenu que « il est possible d’observer que la recherche actuelle autour du Jésus historique a considérablement élargi ses bases théoriques et méthodologiques, en insérant de nouvelles perceptions provenant des domaines de la sociologie, de l’anthropologie, de l’histoire et de l’archéologie ».
De cette manière, on peut également souligner les recherches théoriques et empiriques des sciences sociales qui enrichissent grandement la recherche académique et scientifique sur le Jésus historique, qui vise à conjecturer son contexte social, géographique, politique et culturel.
Étudier Jésus, c’est comprendre la Palestine
La perspective de ces sciences permet donc d’avoir un regard raffiné sur le tissu social de la vie juive de l’époque. Cela rend possibles de nouveaux outils d’analyse qui touchent à des aspects caractéristiques du domaine. Par exemple : les relations sociales, la place et la position des femmes dans la société, la hiérarchie sociale, l’espace social et politique, le facteur culturel et symbolique de cette société et, surtout, les facteurs anthropologiques dans l’étude de la famille et de la parenté de Jésus de Nazareth. C’est à ce stade que se concentrent le plus grand nombre d’ouvrages sur le Jésus historique, d’où émergent ces nouveaux axes d’analyse.
Il m’a semblé que le moment actuel de la recherche du Jésus historique ressemble au contexte libéral dans lequel Albert Schweitzer écrivait au XXe siècle. En d’autres termes, « il n’y a pas de tâche historique qui révèle le véritable intérieur d’un homme comme celle de décrire la vie de Jésus ». Si une telle perception prédominait dans l’esprit critique de Schweitzer à cette époque, on peut dire qu’elle continue de se reproduire aujourd’hui.
Quel est le Jésus historique aujourd’hui ? Un objet scientifique subjectivisé qui en dit plus sur « votre » chercheur que la recherche historico-sociale empirique elle-même, ou un Jésus historique relégué aux seules questions religieuses ?
La troisième étape de la recherche, celle actuelle et délimitée par les années 1980, est une étape de plus grande confiance dans la recherche de la connaissance de Jésus de Nazareth. Et de notre point de vue, cette affirmation est justifiable sur deux points importants : le premier en tenant compte des documents découverts dans le Coran , qui ont été le « pieu » enfoncé dans le terrain scientifique qui a en fait délimité l’insertion de Jésus dans son propre contexte juif.
Le deuxième point se résume à la quantité de données qu’il a été possible d’obtenir grâce à la recherche interdisciplinaire, qui s’appuie sur des références jusqu’alors inexplorées, qui ont émergé de plus en plus et qui marquent désormais de manière significative la troisième recherche.
Je me réfère aux contributions des sciences sociales (principalement l’anthropologie culturelle et la sociologie) qui ont reçu une plus grande importance et qui ont mené des études majeures, parmi lesquelles celles de John Dominic Crossan et de John Piper Meier, sur le thème du Jésus historique.
Ces auteurs ont exploré le tissu social de la vie juive dans la Palestine du premier siècle afin de conjecturer et d’observer d’une manière très particulière le « monde » terrestre de Jésus de Nazareth afin d’établir de telles approximations dans le Jésus historique.
Nous affirmons que la troisième étape de la recherche sur le Jésus historique est un moment interdisciplinaire. Si nous devions catégoriser les dispositions méthodologiques de ce projet, nous arriverions à la conclusion que « tout » est critiqué et exploré.
L’attention portée au contexte socio-historique de son époque est un point clé pour réaffirmer la troisième étape ; la question des conditions de vie précaires en Basse Galilée semble également avoir été peu explorée.
En fait, cette insistance sur le contexte historique et social tend à toujours pousser le chercheur du sujet historique à élaborer un discours social et politique, puisque dans ce contexte, Jésus de Nazareth sera dépeint comme un « révolutionnaire », peut-être un prophète social.
La relation directe de Jésus avec son peuple, c’est-à-dire avec le judaïsme, est également une approche qui suscite de nombreuses discussions. En fait, c’est celle qui apparaît le plus explicitement dans les travaux de la troisième étape de la recherche.
Cet enracinement – celui de Jésus de Nazareth et, supposément, celui du Jésus historique dans le judaïsme antique du premier siècle – est largement utilisé comme une rupture drastique avec la deuxième étape de la recherche qui semblait chercher à éloigner Jésus de ce contexte.
Sémitique typique du Moyen-Orient
Cependant, ce qui a été laissé derrière toute cette discussion était une discussion solide sur l’image « réelle » – ou peut-être la plus appropriée – que l’on peut conjecturer de Jésus.
Je me réfère, dans ce cas, à un portrait discursif, qui conjecture des traits phénotypiques, le visage supposé, peut-être le teint, la taille, c’est-à-dire l’apparence d’un Juif typique de la Méditerranée de Palestine au premier siècle.
On comprend la difficulté de trouver une caractérisation phénotypique adéquate du Jésus historique de Nazareth. Cependant, en considérant Jésus comme un archétype de la modernité, comme l’a souligné John Piper Meier, tout est possible à conjecturer.
Et pourquoi ne pas aujourd’hui, à l’époque moderne, avec toute la collection bibliographique interdisciplinaire des sciences sociales, fournir un portrait marginal (discursif) du Jésus historique ?
Cependant, dans cette littérature, nous rencontrons une absence de mention de la question ethnique impliquant l’existence de tout Juif, caractéristique du 1er siècle en Palestine.
Et on se demande : pourquoi pas ? Or, si la troisième quête du Jésus historique a élargi les possibilités de recherche et de reconstruction de cet homme à travers un corpus scientifique, pourquoi la littérature récente sur le sujet n’est-elle pas allée en profondeur au point de tracer un profil de lui comme un homme égal au sens physique d’un homme sémite du Moyen-Orient ?
On soutient que la discussion concernant la couleur de peau de Jésus de Nazareth ne serait pas pertinente. Cela ne signifie pas pour autant que ce sujet ne devrait pas être à l’ordre du jour. Plus encore : apporter des éléments qui suscitent des réflexions concrètes sur l’apparence physique du plus grand symbole de la doctrine chrétienne pourrait stimuler une réflexion plus fondée sur la question. Afin de questionner – et peut-être de réécrire – les récits traditionnels, colonisés et eurocentriques qui dépeignent presque toujours ce Palestinien du 1er siècle qui a provoqué la colère de Rome comme un homme aux traits délicats, aux cheveux raides et clairs et aux yeux bleus.
Hudson Silva Lourenço
Chercheur scientifique, Université fédérale rurale de Rio de Janeiro (UFFRJ)