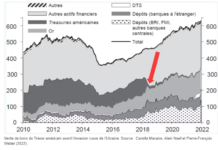Pour bon nombre d’observateurs, et en particulier ceux de la Commission européenne, si l’Italie connaît une stagnation économique depuis le lancement de l’euro en 1999, c’est en raison d’une insuffisante mise en œuvre des réformes structurelles préconisées par l’UE : oui c’est cela libéralisation du marché du travail, ouverture à la concurrence de secteurs traditionnellement réservés à l’État, modernisation de la bureaucratie.
Bref, l’Italie serait responsable des difficultés de son économie, lesquelles ne sauraient être imputées à aucun facteur extérieur. Tel est le discours dominant des institutions européennes à l’égard de nombreux pays dont l’incapacité à se réformer est régulièrement soulignée.
C’est pourquoi, dans l’histoire récente de l’Italie, des gouvernements dits techniques ont vu le jour pour administrer de manière rapide, et parfois brutale, la thérapie recommandée. On peut songer au plan d’austérité du gouvernement Amato pour préparer l’Italie à l’euro en 1993, ou encore à la politique rigoureuse conduite par Mario Monti de 2011 à 2013.
Le présent gouvernement Draghi, en place depuis un an, participe de la même logique au nom du même impératif européen : celui d’imposer des remèdes censés apporter la croissance manquante.
Le remède européen est-il efficace ?
L’Italie est-elle vraiment victime d’elle-même de son système économique sclérosé ? A-t-elle refusé avec force les réformes depuis plusieurs décennies ? En somme, devons-nous valider le récit européen, celui d’un pays immobile, incapable de se mettre à l’heure européenne ?
Une autre lecture peut être privilégiée : celle qui défend l’idée que l’Italie a volontairement fait le choix de se soumettre à une contrainte extérieure dite du « vincolo esterno » au nom de son adhésion européenne. De ce fait, elle s’est engagée dans un vaste programme de réformes qui, loin de se traduire par un surcroît de croissance, a plongé l’économie du pays dans une certaine atonie. Dans cette lecture, l’euro a été un instrument qui a largement joué contre l’Italie et dont l’introduction a surtout profité à l’Allemagne.
Ces vingt dernières années, les Italiens ont connu un tassement de leur niveau de vie, sans compter l’inquiétude liée à la situation démographique. La productivité recule de 1,5 % en rythme annuel depuis 2000. Depuis le début de la crise économique en 2008, l’Italie a perdu 600 000 emplois industriels et un quart de sa production industrielle.
Néanmoins, le pays conserve de réelles capacités industrielles, demeure le 9e exportateur mondial, et nombre de ses entreprises restent des leaders : citons le groupe de construction navale Fincantieri, le fabricant de chaussures Geox ou encore le producteur de montures de lunettes Luxottica.
L’idéologie du vincolo esterno : une camisole de force à l’italienne
Au début de la décennie 1980, l’Italie dispose de trois atouts clés qui ont largement contribué à son succès : un État très largement dirigiste, une main-d’œuvre bon marché dans le sud, et une monnaie faible lui donnant une certaine compétitivité-prix.
À partir de ce moment, une série de réformes va transformer l’économie italienne, au nom de l’intégration européenne. L’Italie est largement victime de ce que l’on nomme l’idéologie du « vincolo esterno ». Ce terme peut être traduit comme la contrainte extérieure. Il est intimement lié à l’histoire des rapports entre l’Italie et la construction européenne.
Conformément aux orientations de l’UE, les élites italiennes ont imposé un ensemble de réformes jugées nécessaires en matière de marché du travail, de protection sociale et de concurrence. L’Union européenne remplit alors une fonction disciplinaire, autorisant des transformations majeures aussi bien en termes de relations sociales et de financement de l’économie que de protection sociale et d’organisation du marché du travail.
Quelques jalons de cette histoire peuvent être rappelés. En 1981, le Trésor italien se sépare de la Banque centrale d’Italie. Désormais, l’État ne pourra plus obtenir les encours nécessaires pour financer ses besoins. Une précieuse source de financement se perd alors. Une autre ère budgétaire et monétaire s’ouvre. C’est un pas vers l’austérité.
La contrainte sera aussi monétaire. L’Italie s’engage dans le Système monétaire européen, dont le fonctionnement est asymétrique. Il oblige les États dits à monnaie faible de faire les efforts d’ajustement, sous forme de modération salariale par exemple.
C’est pourquoi la dévaluation de 1992-1993 décidée à la suite des attaques spéculatives contre le SME a été salvatrice. L’Italie subissait alors une politique d’austérité conduite sous la direction de Giulio Amato pour qualifier le pays à la monnaie unique. Sans cette dévaluation, l’Italie n’aurait pu supporter cette austérité.
L’euro ne fera que renforcer cette contrainte, même si l’on peut admettre que la monnaie unique a autorisé une détente en matière de taux d’intérêt. L’euro apparaîtra peu profitable à l’économie italienne, car depuis la fin des années 1990, l’Italie dégage un excédent primaire et une croissance atone.
Bien souvent, les commentateurs oublient de dire qu’en dehors de taux d’intérêt qui ont été particulièrement élevés sur la période, l’Italie s’est imposé une cure budgétaire largement payée par les Italiens en termes de services publics. Les privatisations du réseau autoroutier engagées par le gouvernement Prodi ont été profitables aux sociétés qui en ont assuré la gestion, mais pas aux citoyens. L’écroulement d’un pont à Gênes a révélé la gabegie en la matière.
L’Italie a été un véritable laboratoire d’un néolibéralisme que les gouvernements de gauche n’ont pas interrompu malgré la fin apparente du berlusconisme qui en a été un terrible vecteur. Le berlusconisme a engagé un ensemble de réformes qui ont conduit à la précarisation de nombreux services publics et à une austérité budgétaire importante. On peut penser à la malheureuse réforme Maria Stella Gelmini de l’Université qui a proposé une loi d’autonomie des universités aux conséquences néfastes, sans compter les privatisations à répétition, ou les ouvertures répétées à la concurrence.
La gauche italienne, transformée en partie centriste avec la naissance du Parti démocrate, n’a fait qu’entériner la logique du vincolo esterno, et allant plus loin dans l’agenda d’inspiration néolibérale. N’oublions pas que l’Italie de Romano Prodi (gouvernements Prodi I 1996-1998 et Prodi II 2006-2008) a procédé à des privatisations massives.
Des gouvernements successifs tous désireux de mettre en œuvre les réformes européennes
Rappelons ce qui constitue l’essence des réformes européennes : des politiques budgétaires contenues ; une politique monétaire dont le but est d’assurer une stabilité des prix ; et des variations de change avec l’extérieur relativement contenues.
À ce cocktail de politiques économiques peu actives, s’ajoutent des réformes structurelles concernant le marché du travail, l’organisation des marchés de biens et de services, et la libre circulation des capitaux et une protection sociale qu’il s’agirait de rendre plus active. En somme, des politiques économiques sous tutelle du marché.
L’espace de cet article ne permet pas de livrer un bilan exhaustif de ces choix de politique économique depuis plus de trente ans, mais un bilan s’impose. Le cas italien nous permettra de mesurer l’échec de cette orientation.
Un constat d’échec
L’Italie a procédé à une profonde réforme de ses administrations et a fait disparaître sa fonction publique ou, du moins l’a considérablement réduite – sans compter les coupes claires dans ses administrations dont elle mesure aujourd’hui l’ampleur, car ses administrations dépeuplées ne peuvent plus faire face aux enjeux de la répartition des fonds européens.
Les travailleurs italiens avaient arraché de haute lutte le statut des travailleurs de 1970, dont l’article 18 allait défrayer la chronique bien des années plus tard. Cet article était largement protecteur des travailleurs, qui en cas de licenciement abusif pouvaient l’objet d’une réintégration dans leur entreprise.
C’est la gauche, et particulièrement celle de Matteo Renzi (2014-2016) qui s’est employée à le démanteler. Le Jobs act du même Renzi porta un coup fatal à cet article.
On retrouve ici une approche orthodoxe largement partagée au niveau européen : en accordant des facilités aux entrepreneurs en matière de licenciement ou d’embauche, le nombre d’emplois viendra à croître. Il n’en fut rien : le surcroît d’emplois est dû à une croissance supérieure.
On peut dire que des années 1980 à nos jours, on a assisté à un démantèlement systématique d’un ensemble de protections. La gauche a été le porte-drapeau de ces évolutions. Cette dernière a porté un projet régressif le Jobs act dont les effets escomptés sur le marché du travail n’ont pas été observés.
Le capitalisme italien a vu des industries clés passer sous contrôle étranger – que l’on pense à Telecom Italia, devenue la TIM, qui est aujourd’hui convoitée par un géant américain, ou à la fin de la Parmalat, leader agroalimentaire ayant fait faillite sous l’effet de pratiques de corruption et ayant été racheté par une entreprise française, Lactalis.
Les élites italiennes ont fait de l’Italie le bon élève de la classe européenne en implantant à marche forcée, et parfois sans légitimité électorale, des réformes qui ont modifié l’organisation de l’économie du pays. Aujourd’hui, c’est le tissu même du capitalisme italien, son réseau de petites entreprises organisées en clusters, qui est jugé inadapté aux mutations économiques modernes, et qui est l’objet de changements en cours et à venir.
Il ne s’agit pas de dire que des facteurs internes n’ont pas joué dans les faiblesses de l’économie italienne, mais de reconnaître que l’implantation de réformes libérales, la perte de la souveraineté monétaire, le redimensionnement de l’État et de ses interventions ont été des facteurs de déstabilisation, d’appauvrissement de l’Italie, de fuite de la main-d’œuvre surtout jeune, d’un égoïsme territorial.
En somme, l’Italie ne s’appauvrit pas, ou ne se fragilise pas par manque de réformes, mais bien par un excès et par une mise aux normes d’un capitalisme européen qui lui est devenu peu favorable.
Frédéric Farah – Professeur de sciences économiques et sociales, chercheur affilié au laboratoire PHARE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne