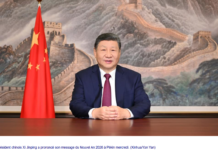Dans l’imaginaire collectif congolais, le mot inflation est devenu une insulte, une menace, presque une malédiction qu’on agite pour effrayer les foules. Comme « économie » ou « macroéconomie », il est perçu comme une langue étrangère, réservée à une élite technocratique qui s’exprime dans des chiffres incompréhensibles au quotidien du citoyen. Dans le récit qui est servi à la population, l’inflation est toujours un désastre. Elle ne serait que le signe d’un organisme malade, d’une économie en train de pourrir de l’intérieur. Le mot est d’ailleurs rarement expliqué, mais toujours brandi comme un épouvantail : « attention, l’inflation arrive », comme on annoncerait une invasion de criquets ou une peste prête à décimer la population.
Pourtant, ailleurs, l’inflation est parfois un moteur. Elle peut refléter une vitalité économique, encourager l’investissement, stimuler la production. Mais en RDC, le mécanisme tourne à l’envers : au lieu de fertiliser la terre, il l’épuise ; au lieu de pousser l’économie vers l’avant, il l’enfonce dans la dépendance et creuse encore plus profondément le fossé de l’injustice sociale.
Et cette peur de l’inflation ne se limite pas à un simple malentendu économique, elle est enracinée dans une culture politique particulière. Nous sommes dans un pays qui se proclame égalitaire et anti-tribaliste, mais qui consacre dans sa Constitution l’autorité du « chef coutumier » et lui attribue même un vice-ministre dédié. Dans ce décor, les débats économiques se perdent dans des prêches religieux et des conférences de « leadership », où les slogans moralisateurs remplacent l’analyse.
La peur l’absence d’inflation dans les économies modernes
Dans une économie moderne, une légère inflation joue le rôle de carburant. Quand les prix montent un peu chaque année, les gens se disent : « Si j’attends, ce sera plus cher demain. » Alors ils achètent maintenant : une voiture, une maison, ou même un nouveau frigo. Pour ça, ils utilisent leur carte de crédit ou prennent un prêt. Résultat : les entreprises vendent plus, produisent plus, et embauchent. Les nouveaux salariés, à leur tour, consomment et empruntent. La roue tourne.
Mais si l’inflation tombe à zéro, le vélo ralentit dangereusement. Les gens se disent : « Pas besoin d’acheter aujourd’hui, ce sera pareil demain. » Alors ils attendent. Les ventes baissent, les entreprises produisent moins, licencient, et tout le cycle s’enraye. Pire encore, si les prix commencent à dégringoler, déflation, c’est comme si le vélo reculait, tout le système économique risque de tomber. Trop d’inflation est aussi dangereux car c’est comme pédaler trop vite en descente, on perd le contrôle et on finit par s’écraser. C’est ce qui arrive lors des bulles spéculatives.
C’est pourquoi les banques centrales des pays développés surveillent l’inflation au même titre et valeur, si pas plus, les indicateurs comme le taux d’emploi, la confiance des ménages ou encore la santé des marchés financiers. Leur mission est d’orchestrer un équilibre délicat. C’est l’acrobatie de laisser assez d’inflation pour que l’économie avance, comme une roue qui tourne, mais pas trop pour éviter l’emballement et l’explosion. Trop peu, et la roue s’arrête net ; trop, et elle s’emballe jusqu’à sortir de piste.
Tout l’art est donc de marcher droit, pas à pas, pour que le système reste en mouvement sans jamais basculer. Et si vous leur demandez, ils vous diront qu’il vaut toujours mieux être en position à chercher comment freiner une économie trop rapide que de se gratter la tête à trouver comment la faire accélérer pendant que le public grogne.
Pourquoi la magie ne fonctionne pas en RDC
Le premier problème vient d’un postulat simple : dans une économie moderne, les ménages s’endettent pour s’offrir un confort, réaliser un rêve ou céder à un caprice. Acheter une maison, une voiture ou même un nouvel appareil repose souvent sur un prêt bancaire ou une hypothèque. C’est ce mécanisme qui fait tourner la roue, on emprunte aujourd’hui, on consomme, et l’économie s’emballe. Or, en RDC, ce marché du crédit est quasiment inexistant. Les banques ne prêtent qu’à une poignée de privilégiés, et l’hypothèque est un luxe inaccessible. Et donc, il n’existe aucun levier pour pousser la population à consommer maintenant plutôt que plus tard. Dans ce contexte, voir la Banque centrale jongler avec ses taux d’intérêt revient à regarder un prestidigitateur faire des tours de cartes devant un public qui n’a même pas de cartes en main. Le spectacle amuse peut-être les initiés, mais il n’a aucun effet sur la réalité de l’économie.
Le deuxième problème tient à la structure même de la production : une économie ne se développe que lorsque ses citoyens participent à produire et à consommer ce dont ils ont besoin. En RDC, la principale richesse vient des minerais, mais ce secteur emploie très peu de Congolais et n’exige presque aucune compétence locale. Depuis la vague de privatisations sous Kabila, l’essentiel du secteur minier a glissé dans les mains des multinationales, transformant les richesses du sous-sol en festin réservé à quelques acteurs étrangers. Les citoyens n’en voient que des miettes, l’État n’en reçoit que des gouttes, tandis que les sociétés minières s’accaparent le banquet entier. C’est comme si le pays possédait une cuisine débordant d’or et de diamants, mais que la population restait affamée derrière la porte, condamnée à lécher les miettes tombées de la table.
Le vrai problème n’est pas la macroéconomie, mais l’absence des briques élémentaires d’une économie moderne, surtout au sens même du capitalisme dont on prétend se draper, un marché du capital, c’est-à-dire du prêt et du crédit. Et si ce manque n’a jamais été érigé en priorité, c’est parce qu’il s’enracine dans un vieux réflexe colonial : nourrir l’État d’abord, pour qu’il « redistribue » ensuite. Mais, comme hier les colons, l’État s’empiffre, digère tout ce qui est bon et chie sur ses citoyens ce que son système digestif n’a pas pu retenir. À force de confondre la nation avec une cantine coloniale, les Congolais ont fini par croire qu’ils étaient nés pour se contenter des poubelles.
Ils ne sont pas comme nous
Pourquoi ai-je inscrit, dans le projet de Constitution que j’ai proposé RDC Constitution Révision 2024, https://rdcconstitutionrevision2024.com/, l’obligation pour le gouvernement de publier chaque 20 février un nouveau SMIG automatiquement ajusté à l’inflation, sous peine de démissionner ? Parce que l’ajustement des salaires déclenche ce que les économistes appellent la « course entre salaires et prix » : lorsque les revenus suivent l’inflation, les travailleurs gardent leur pouvoir d’achat, continuent de consommer, ce qui pousse les entreprises à produire davantage et donc à embaucher. Cette dynamique entretient la demande, stimule l’investissement et alimente, au lieu d’étouffer, la croissance. En faire une obligation constitutionnelle, c’est transformer un mécanisme souvent redouté en moteur assumé de développement.
La différence est avant tout une question d’école de pensée, entre eux, qui contrôlent et enseignent les facultés d’économie à travers la République, vos idoles, et nous, entre orthodoxes et hétérodoxes. Les orthodoxes, formatés par leur cursus, ressemblent à des chiens de Pavlov, dressés à réagir mécaniquement à des modèles prédéfinis. Leur vision réduit l’économie à un exercice de calibration, une mécanique d’équations et de courbes où l’on ajuste des variables comme si la société n’était qu’un tableau Excel géant. Pour eux, la croissance se décrète à coups de coefficients et d’indices, sans jamais voir que derrière chaque chiffre il y a un être humain, un comportement, une réaction imprévisible. C’est là toute la faille : ils confondent la carte avec le territoire, le modèle abstrait avec la vie réelle.
Pour des gens comme moi, la politique économique, ces principes qui fixent les règles du jeu, et fait de l’économie tout autre chose. C’est une science sociale, une science empirique nourrie par l’observation et l’ajustement constant des comportements. Chaque décision entraîne une réaction, chaque changement ouvre sur des effets inattendus, et rien n’est jamais totalement prévisible. L’économie n’est pas une éprouvette dans un laboratoire, mais une arène vivante où se croisent intérêts, émotions et rapports de force. L’improvisation des acteurs, citoyens, entreprises, gouvernants, qui crée la véritable musique, avec ses dissonances et ses surprises. C’est pourquoi l’économie, ainsi comprise, devient avant tout un outil de manipulation des comportements, qu’il s’agisse d’un individu, d’un groupe ou d’une nation entière. Fixer un taux d’intérêt, ajuster un salaire minimum ou annoncer une réforme fiscale, ce n’est pas seulement jouer avec des chiffres, c’est envoyer des signaux, créer des incitations, forcer des arbitrages. En réalité, on ne mesure pas simplement des flux, on oriente des choix, on influence des trajectoires collectives parfois pour maintenir l’équilibre social, parfois pour déclencher une dynamique de croissance.
Mais les Congolais continuent de confier leur conscience et l’esprit économique de la nation aux économistes orthodoxes, ces prêtres en soutane académique qui psalmodient des équations comme des prières et enseignent leurs dogmes dans les amphithéâtres comme dans des chapelles. Pourtant, ils ont démontré à maintes reprises que leurs recettes ne fonctionnent pas : croissance sans développement, stabilité monétaire sans prospérité, inflation combattue au prix de la misère. On persiste malgré tout à les ériger en guides, comme si l’échec répété pouvait devenir une doctrine sacrée. Beaucoup confondent encore diplôme et sagesse : un doctorat n’est qu’une formation, pas une compétence, et un passage à la Banque mondiale ou au FMI n’est qu’une expérience professionnelle, pas une onction d’expertise. Ces orthodoxes ne sont pas des savants, mais des faux prophètes, gardiens d’un catéchisme économique importé, qui exigent la foi aveugle des nations tout en les condamnant à tourner en rond dans le désert de la dépendance.
Dans une cité d’aveugles, celui qui tient une canne devient, par défaut, un guide. Peu importe qu’il ignore où il mène les autres ; l’objet dans sa main suffit à lui donner autorité. Mais comment convaincre, sans canne, que l’on voit réellement, quand on a passé des années à lire les radiographies du monde, à tracer des cartes et à fonder des compagnies de guides ? Et lorsque ces aveugles ne reconnaissent pas en toi la voix de ceux qui, jadis, les guidaient, les colons, ils en viennent à refuser obstinément la main que tu leur tends.
Jo M. Sekimonyo
Économiste politique, théoricien, militant des droits humains et écrivain. Actuellement chancelier de l’Université Lumumba.