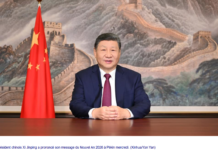Le système international traverse une phase de transition marquée par la dilution de la centralité des puissances occidentales et la multiplication des pôles d’influence. L’ancienne logique du multilatéralisme institutionnel, qui s’articulait autour de forums dominés par Washington et Bruxelles, cède la place à une réalité fluide, où les alliances se forment et se défont au gré des enjeux et des intérêts spécifiques . Malgré les incertitudes générées, cette métamorphose ouvre des perspectives aux pays du Sud, notamment en Amérique du Sud.
En 2023, le Groupe des Vingt a marqué ce changement en admettant l’Union africaine comme membre permanent et en reconnaissant qu’il n’y a pas de consensus total concernant la guerre en Ukraine .
Espace pour des positions divergentes
Le mois dernier, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que le monde « évoluait vers un ordre multipolaire », qualifiant cette situation à la fois de réalité et d’opportunité. Le message est clair : l’espace pour des positions divergentes et des coalitions thématiques s’est élargi , et il est peu probable que l’avenir suive le modèle rigide de la Guerre froide .
Dans ce scénario, les économies intermédiaires comme l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Indonésie exigent une plus grande autonomie décisionnelle, même si elles sont confrontées à des restrictions découlant de la dépendance technologique et de la pression financière des grandes puissances .
Au niveau régional, des organisations comme les BRICS, la CELAC et l’UNASUR jouissent d’une plus grande importance politique et symbolique, mais manquent de mécanismes exécutifs solides pour transformer le consensus en normes efficaces. Le sommet des BRICS, tenu en juillet dernier à Rio de Janeiro, a réaffirmé la volonté d’élargir la coordination mondiale .
Vitrines diplomatiques
En effet, le groupement a intégré de nouveaux partenaires, consolidant le bloc comme espace de remise en question de l’ordre établi . Pour l’Amérique du Sud, ces forums servent de vitrines diplomatiques pour des propositions alternatives en matière de commerce, d’énergie et de sécurité, même si les instruments institutionnels permettant de faire appliquer des décisions contraignantes font encore défaut.
Autrement dit, contrairement à des organisations comme l’Union européenne, ces forums sud-américains manquent de structures obligeant automatiquement les pays membres à se conformer aux décisions adoptées collectivement. Ils manquent de mécanismes pratiques, tels que des tribunaux supranationaux, des organes exécutifs dotés de pouvoirs réels ou des traités directement applicables dans la législation nationale de chaque pays. En général, les accords et les résolutions dépendent de la volonté politique de chaque gouvernement pour être mis en œuvre, ce qui limite leur efficacité et la transformation du consensus en normes véritablement contraignantes.
Malgré les discours émancipateurs, le risque de remplacer d’anciennes dépendances par de nouvelles relations asymétriques est évident. La présence croissante de la Chine dans les infrastructures, l’énergie et les plateformes numériques crée des opportunités de financement et d’accès au marché , mais elle impose également des règles conçues par Pékin.
Compétences diplomatiques
Parallèlement, les États-Unis et l’Union européenne continuent de contrôler les institutions financières mondiales et de déterminer les paramètres réglementaires technologiques . Dans ce contexte, la marge de manœuvre de l’Amérique du Sud reste conditionnée par sa capacité diplomatique à diversifier ses alliances et à réduire ses vulnérabilités .
Même si les pays d’Amérique du Sud ont la possibilité de rechercher de nouveaux partenaires internationaux et d’essayer d’accroître leur influence, ils dépendent toujours de leur capacité à négocier et à s’adapter à un scénario mondial de pression constante.
Cette « marge de manœuvre » consiste à saisir les opportunités de dialogue, à conclure divers accords commerciaux, à investir dans l’innovation et à tenter de réduire les vulnérabilités liées, par exemple, à la dépendance aux technologies étrangères ou à la vulnérabilité aux sanctions économiques. En fin de compte, il s’agit d’équilibrer les intérêts et d’atténuer les risques afin de garantir une plus grande autonomie et un plus grand pouvoir de décision.
Le domaine monétaire illustre cette ambiguïté. Le dollar demeure la référence dominante pour les réserves internationales et les transactions commerciales , représentant environ 57,7 % des réserves officielles début 2025, tandis que l’euro demeure la deuxième monnaie mondiale , avec près de 20 %.
Le renminbi chinois progresse modestement , malgré la propagande de dédollarisation (les expériences commerciales en monnaies locales ou en yuan signalent des alternatives, comme les accords entre le Brésil et la Chine pour les transactions en monnaies nationales ), mais elles manquent encore d’échelle et de stabilité . La région est confrontée au dilemme de rechercher ses propres instruments financiers et de faire face à la persistance de l’hégémonie du dollar, tandis que les États-Unis maintiennent une influence significative sur le taux de change .
Un autre domaine stratégique concerne la technologie. La course aux semi-conducteurs, à l’intelligence artificielle et à la lithographie avancée définit bien plus que la compétitivité économique : elle impacte la souveraineté nationale . Les restrictions imposées par Washington et ses alliés européens sur l’approvisionnement de la Chine en puces de pointe renforcent la concentration de l’innovation dans quelques pôles .
Pour les pays d’Amérique du Sud, l’alternative est d’investir dans des plans informatiques nationaux et d’élargir la formation de spécialistes pour leur insertion dans les chaînes de valeur mondiales .
En d’autres termes, outre l’investissement dans leurs propres infrastructures et la recherche scientifique, ces pays doivent créer des programmes d’enseignement solides pour former des professionnels dans des domaines stratégiques tels que l’ingénierie électronique, la science des données, la fabrication de semi-conducteurs, la robotique, la cybersécurité et d’autres domaines liés au développement technologique. Ce n’est qu’avec ce socle humain qu’il sera possible de participer aux chaînes de production mondiales de haute technologie, d’atteindre l’autonomie productive et d’attirer les investissements internationaux dans ce secteur.
Face au recours récurrent aux sanctions et aux blocus comme instruments géopolitiques, de nombreux gouvernements du Sud expérimentent des mécanismes de résilience, tels que des systèmes de paiement alternatifs, la diversification des itinéraires énergétiques et des accords en monnaies locales . Ces initiatives en sont encore à leurs balbutiements et se heurtent à la résistance des puissances établies, mais elles témoignent d’une volonté de renforcer l’autonomie décisionnelle .
Le débat sur la neutralité prend de l’ampleur
L’Amérique du Sud participe à ce processus de manière hétérogène. Le Brésil aspire à un leadership régional et à une position dominante mondiale, en équilibrant ses relations avec Washington, Pékin et Bruxelles . L’Argentine oscille entre approches pragmatiques et replis politiques. Les pays andins et amazoniens alternent leurs stratégies en fonction de leurs agendas nationaux et environnementaux , tandis que la Nouvelle Banque de Développement et d’autres entités, comme la Coalition pour les droits humains dans le développement, mettent l’accent sur l’indépendance et l’énergie durable.
Le débat sur la neutralité prend également de l’ampleur. L’idée d’un « nouveau non-alignement » s’avère limitée face à l’interdépendance technologique et financière mondiale. L’autonomie sélective apparaît comme une alternative stratégique, permettant des décisions au cas par cas et des négociations équilibrées .
La neutralité totale est devenue difficile, car la quasi-totalité des pays dépendent aujourd’hui de chaînes de production mondiales, de normes techniques internationales et de systèmes financiers intégrés. Par conséquent, la stratégie d’autonomie sélective propose aux États d’opérer des choix pragmatiques : négocier avec différents partenaires en fonction de leurs intérêts propres dans chaque domaine (commerce, technologie, énergie, etc.), sans s’engager pleinement dans un bloc ni s’aligner sur une seule puissance. L’idée sous-jacente est d’accroître la flexibilité et l’adaptabilité face aux rapides mutations du système international.
Des puissances intermédiaires comme la Turquie, l’Inde, la Chine et le Brésil jouent un rôle de médiateur dans les négociations géopolitiques et climatiques . Les perspectives restent ouvertes, tributaires de facteurs tels que les réserves du FMI, les dépenses militaires mondiales et la concurrence technologique .
Pour que le Brésil et ses voisins transforment les discours d’autonomie en un véritable leadership sur la scène mondiale, il est essentiel d’investir dans l’innovation technologique régionale – comme le développement conjoint de l’intelligence artificielle et la formation de spécialistes –, de stimuler les infrastructures régionales et les fonds de recherche, de créer/regrouper des agences nationales d’innovation et de s’intégrer activement dans les forums multilatéraux à travers des initiatives concrètes et coordonnées.
L’adoption de ces mesures, avec des projets structurés et des ressources définies, est ce qui nous permet de traduire l’ambition autonome en impacts efficaces et durables, allant au-delà de la simple rhétorique diplomatique et élargissant véritablement l’influence de la région dans le système international.
Armando Álvares García Junior
Professeur de droit international, relations internationales et géopolitique/géoéconomie, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja