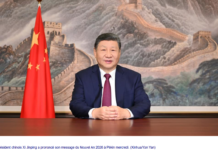En avril 2011, l’Éthiopie a commencé la construction du plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), sur le Nil Bleu. Le barrage devrait produire plus de 6 000 mégawatts d’électricité , faisant de l’Éthiopie le premier exportateur d’électricité du continent .
Le barrage touche 11 pays, deux en aval et neuf en amont.
Addis-Abeba a achevé la construction du projet de plus de 4 milliards de dollars américains en juillet 2025, principalement grâce à des fonds provenant d’Éthiopiens du pays et de la diaspora, avec un lancement officiel le 9 septembre 2025.
Les tensions qui couvent autour du lancement officiel du barrage
Le conflit autour de la répartition et de l’utilisation des eaux du Nil dure depuis de nombreuses années . Il a été exacerbé par le changement climatique et la demande croissante en nourriture et en eau d’ une population croissante .
Les onze pays qui partagent les eaux du Nil ont eux aussi des priorités de développement concurrentes. Parmi ces États figurent l’Éthiopie, l’Égypte, le Soudan, le Rwanda, la Tanzanie et le Kenya.
L’Égypte et le Soudan se trouvent en aval. Ils ne reçoivent les eaux du fleuve qu’après son passage dans les neuf États situés en amont.
Au départ, les États situés en aval, notamment l’Égypte, se sont opposés à la construction du barrage, arguant qu’il constituait une menace pour leurs droits sur l’eau.
Cependant, l’Éthiopie a poursuivi la construction. L’Égypte et le Soudan ont ensuite orienté les négociations vers la conclusion d’un accord pour le remplissage et l’exploitation du barrage.
Les deux États en aval avaient suggéré que le remplissage du barrage devrait prendre entre 12 et 21 ans afin de protéger leur approvisionnement en eau. Pour des raisons internes et politiques, Addis-Abeba a préféré une période de remplissage plus courte . De plus, l’Égypte et le Soudan ont fait valoir que remplir le réservoir sans accord juridiquement contraignant serait contraire à leurs intérêts et à leurs droits .
Mais le barrage étant désormais entièrement rempli et devant être officiellement inauguré le 9 septembre 2025 , la question d’un accord contraignant pour le remplissage du réservoir du barrage est sans objet.
Les efforts politiques et diplomatiques de l’Égypte et du Soudan mettent en lumière ce qu’ils considèrent comme l’illégalité d’ une exploitation unilatérale du barrage sans accord contraignant. Malgré l’intervention de l’Union africaine et du gouvernement américain, ainsi que les appels de l’Égypte au Conseil de sécurité de l’ONU , les trois pays n’ont pas réussi à conclure d’accord.
L’une des raisons est que l’Égypte a insisté pour que toute négociation sur la répartition de l’eau commence par les droits qui lui sont accordés en vertu du traité sur les eaux du Nil de 1959 avec le Soudan .
En vertu de cet accord, l’Égypte s’est vu attribuer 66 % du débit annuel moyen du Nil, estimé à 84 milliards de mètres cubes. Le Soudan en a obtenu 22 %. Le traité ignore les revendications légales des pays en amont sur les eaux du Nil, puisque 10 milliards de mètres cubes étaient réservés à l’infiltration et à l’évaporation. Les hautes terres éthiopiennes, par exemple, fournissent plus de 86 % de l’eau qui alimente le Nil.
L’Égypte continue de soutenir que le barrage éthiopien constitue une menace pour sa sécurité hydrique et que, si nécessaire, elle prendra des mesures pour protéger ce qu’elle appelle ses « droits historiques » sur les eaux du Nil.
L’Égypte dépend du Nil pour plus de 90 % de son approvisionnement en eau douce. Les besoins en eau du pays ont augmenté avec la croissance démographique et la forte expansion de son économie.
Cependant, l’insistance de l’Égypte et du Soudan à conserver leurs parts historiques d’eau ne peut être considérée comme équitable et raisonnable. De plus, Le Caire ne semble pas privilégier une approche d’utilisation de l’eau qui reconnaisse les revendications juridiques des États situés en amont sur les eaux du Nil.
Au lieu d’améliorer et de moderniser ses infrastructures hydrauliques, de minimiser les pratiques d’irrigation gaspilleuses et d’améliorer généralement l’utilisation de l’eau, l’Égypte s’est concentrée sur des projets grandioses qui exercent une pression considérable sur les rares ressources en eau de la région.
Le Soudan, en proie à une guerre civile dévastatrice depuis 2023, s’inquiète de l’impact du barrage éthiopien sur le fonctionnement de ses propres barrages . Cela compliquerait la gestion des projets de développement de Khartoum.
L’accord sur le Nil si difficile à trouver
Le cadre juridique régissant la répartition des eaux du Nil est dominé par des accords datant de l’époque coloniale. Ceux-ci ont été adoptés par les deux États situés en aval, le Soudan et l’Égypte, mais contestés par les neuf États situés en amont.
Deux des accords les plus importants sont le traité anglo-égyptien de 1929 et le traité égypto-soudanais de 1959 .
Le traité de 1959 a augmenté les allocations d’eau accordées à l’Égypte et au Soudan par le traité anglo-égyptien de 1929. Ces traités ont également accordé à l’Égypte un droit de veto sur tout projet de construction sur le Nil ou ses affluents.
Les termes de ces traités ne sont toutefois possibles que si les neuf États riverains en amont n’accèdent pas ou n’utilisent pas l’eau du Nil et de ses affluents.
Plus important encore, ils rendent les droits sur l’eau des autres pays du Nil dépendants de la bonne volonté de l’Égypte et du Soudan .
L’Éthiopie et d’autres États en amont affirment depuis longtemps qu’ils n’étaient pas parties aux traités de l’époque coloniale et qu’ils n’étaient donc pas liés par eux.
Principes internationaux guident l’utilisation de l’eau au-delà des frontières
Les piliers du droit international des eaux transfrontières sont :
(i) utilisation équitable et raisonnable
(ii) l’obligation de ne pas causer de préjudice important
(iii) le devoir de coopérer.
Les juristes internationaux ont souligné que le Traité du Nil de 1959 est en contradiction flagrante avec ces principes. Il méconnaît les droits souverains des autres pays riverains sur leur juste part du Nil et entrave leur développement.
Que promet le barrage aux Éthiopiens ?
Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne est un symbole d’unité et de fierté nationales . Il est significatif que sa construction ait été entreprise sans dépendre de financements extérieurs, tels que des institutions financières internationales ou de grands pays industrialisés.
La production d’électricité du barrage pourrait potentiellement transformer le développement de l’Éthiopie .
Premièrement, l’électricité fournirait une source d’énergie fiable pour l’industrialisation rurale, réduisant la déforestation en éliminant la nécessité pour les ménages de couper des arbres pour se chauffer.
Deuxièmement, cela réduirait la pollution associée à la combustion du bois, du fumier et d’autres formes de biomasse pour la cuisine et d’autres activités.
Troisièmement, cela améliorerait l’accès à l’éducation, en fournissant un éclairage efficace qui permettrait aux élèves de faire leurs devoirs et d’étudier le soir. Pendant les périodes chaudes, l’électricité produite pourrait servir à rafraîchir les salles de classe, améliorant ainsi les résultats scolaires.
Enfin, une production d’électricité plus élevée permettrait d’améliorer la connectivité Internet dans les zones rurales d’Éthiopie, améliorant ainsi l’accès au monde extérieur.
Le barrage pourrait également contribuer à la lutte contre les inondations au Soudan et à la protection contre la sécheresse en Égypte, mais seulement si les trois pays travaillent ensemble.
John Mukum Mbaku
Professeur, Université d’État de Weber