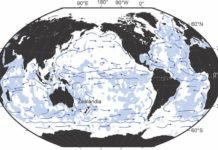Lindokuhle Sobekwa a reçu le FNB Art Prize 2023 d’Afrique du Sud. Il devient le premier artiste utilisant la photographie documentaire comme médium principal à remporter le prestigieux concours.
Né à Katlehong en 1995, Sobekwa a commencé à acquérir des compétences en photographie en 2012, grâce au programme d’enseignement de la photographie Of Soul and Joy dans la commune de Thokoza, où sa famille avait déménagé. Il savait, lorsqu’il était jeune garçon, qu’il pensait en images, visualisant ce qu’il vivait. En rencontrant des caméras, il s’est rendu compte qu’il existait un équipement – une petite machine, un rouleau de plastique transparent perforé et une réaction chimique – capable d’extérioriser ses processus de pensée.
Thokoza, comme de nombreuses colonies situées à la périphérie des villes sud-africaines, existe en raison de la ségrégation spatiale coloniale et de l’apartheid . Les Sud-Africains noirs n’étaient pas autorisés à vivre dans des zones résidentielles « réservées aux Blancs », mais fournissaient pourtant une main-d’œuvre essentielle et mal payée pour la ville. Ils ont créé des logements à partir de tous les matériaux qu’ils ont trouvés pour construire un abri.
Bien que Thokoza ne se trouve qu’à 26 km de Johannesburg, la métropole commerciale du pays semble aussi lointaine qu’une autre planète. La misère de nombreuses personnes dans les townships, ainsi que l’engagement constant les uns envers les autres – nécessaire pour rendre la vie possible dans des conditions précaires – sont évidents dans le travail de Sobekwa.
Spécialiste des identités visuelles et de l’ héritage de la photographie documentaire, j’ai rencontré Sobekwa lorsqu’il a obtenu une bourse pour étudier au Market Photo Workshop de Johannesburg en 2015. J’ai mené de nombreuses interviews sur le développement de ses projets que je tire d’ici pour réfléchir. son travail.
J’ai été frappé par l’objectif clairement exprimé de Sobekwa : représenter Thokoza d’une manière qui s’écarte de l’image qu’on en avait dans les années 1980, pendant l’apartheid – en tant que lieu de violences spectaculaires contre la police et contre les autres, incitées par les forces gouvernementales fantômes . .
Je l’ai interviewé cette année, à propos de son prochain livre , Je porte sa photo avec moi. J’ai encore une fois été séduit par sa capacité à conceptualiser visuellement les grands fils de l’histoire sud-africaine : les migrations vers les zones urbaines pour gagner de l’argent, les séparations violentes des familles, les disparitions d’êtres chers dans les entrailles des mines d’or.
Ces perturbations ont laissé des blessures dans les récits familiaux qui ne se sont jamais cicatrisées. La photographie est devenue le moyen pour Sobekwa de créer un lien provisoire et vivant avec ce qui a été perdu, pour trouver une voie à suivre. Son exploration des luttes internes et des conditions extérieures qui ont marqué sa propre famille – tout ce qui reste inexprimé et indicible – fait danser ses images avec dimension et profondeur, pleines de fantômes et de présences étranges.
Des histoires interconnectées
Les deux séries qui lui ont valu le FNB Art Prize – Lockdown et Ezilalini (The Country) – ne pourraient pas sembler plus différentes. Tandis que Lockdown suit la vie à Thokoza, Ezilalini est un voyage à Tsomo dans la province du Cap oriental, d’où ont émigré son grand-père puis sa mère. L’apartheid a regroupé de force les Sud-Africains noirs dans de petits territoires, donnant les terres arables sur lesquelles ils vivaient autrefois pendant des générations aux agriculteurs blancs. Incapables de gagner leur vie dans ces soi-disant homelands , beaucoup ont cherché du travail comme travailleurs migrants dans les villes.
Lockdown et Ezilalini sont deux récits interconnectés. L’histoire qui a créé Thokoza est la même qui a déplacé tant de personnes des belles vues avec lesquelles Sobekwa renoue, à son retour au lieu où sont enterrés les cordons ombilicaux et les os de ses parents par le sang.
Confinement
Pendant le confinement dû au COVID-19 en 2020, Sobekwa n’avait pas beaucoup de travail. Avec la fermeture des lieux d’affaires, les revenus se sont taris pour la plupart des habitants des townships. Les directives de sécurité entendues dans le monde entier semblaient comiques pour ceux qui vivent à proximité dans des cabanes. Mais il n’y avait pas de quoi rire.
Sobekwa vivait aux côtés du surréaliste – les responsables insistaient sur la distance sociale – et de l’hyper-réalité de sa vie quotidienne : l’intimité, les interdépendances, le désespoir économique et les peurs de son entourage.
Il a pris son appareil photo et a commencé à raconter sa place. Les photographies de Sobekwa montrent la lenteur avec laquelle la pandémie a exacerbé les conditions de violence créées par de vastes inégalités. Mais il y a aussi des moments de beauté, d’amour et de communauté.
Au crépuscule, un groupe de jeunes tendent le cou pour regarder à travers les barreaux de fer d’une confiserie, peut-être pour acheter des bonbons et des chips bon marché, une évasion momentanée de la monotonie. Le soir, les amis se rassemblent autour d’un brasier à charbon de bois. Par une journée brumeuse, un jeune berger se couche sur des broussailles au pied de pylônes électriques, entouré de mille détritus. Deux petites filles marchent dans un couloir fleuri, plongées dans une conversation intime. Un petit conte de fées, piégé dans un cauchemar mondial plus vaste.
Parfois, les gens arrivent à un point de rupture face aux coupures d’électricité interminables dans le pays . Ils se rassemblent pour protester, fuyant la même machine terrifiante de l’État que leurs aînés. Sur une photographie, un homme a enroulé son corps autour du long poteau métallique d’un lampadaire, abattu de force sur une route jonchée de béton projeté. Dans ce moment de répit, il semble inconscient du chaos qui l’entoure.
Sobekwa et sa famille, vivant dans une cabane sans eau courante ni électricité, étaient disproportionnellement sensibles au virus. En visite chez sa mère, il l’a photographiée dans son rituel nocturne. Elle est assise sur le lit, les épaules affaissées, profondément absorbée par la lecture de sa Bible, un rituel dans lequel elle a toujours trouvé du réconfort. Ses inquiétudes sont apaisées un instant par la promesse et la puissance du Divin. Elle ne remarque pas que Sobekwa est témoin de sa méditation. Mais nous, témoins de ce que voit sa caméra, pouvons le repérer dans un miroir ovale, portant un masque pour protéger sa mère de tout ce avec quoi il aurait pu entrer en contact.
L’une des photographies de confinement les plus marquantes de Sobekwa est celle de la maison familiale de son partenaire à Thokoza lors d’une coupure de courant. Ici, le mécanisme d’évasion est l’écran du téléphone et l’accès à Internet. Chacun est profondément concentré sur son propre écran, qui illumine son visage. C’est à ce moment-là que la vidéo du policier de Minneapolis, Derek Chauvin, étranglant brutalement à mort George Floyd, se répand à travers le monde. La famille de Sobekwa était tout aussi enfermée dans la même horreur, écrite par la suprématie blanche, que celle des États-Unis.
Ezilalini
Ezilaleni, lancé en 2018, est un projet en cours motivé par le retour de Sobekwa à Tsomo, où repose sa sœur Ziyanda. Il a commencé à réfléchir à la manière dont les disparitions faisaient partie du récit de sa famille : son grand-père était parti pour Johannesburg, la ville de l’or, et n’était jamais revenu. Sa sœur a disparu quand il était très jeune.
S’adressant à sa grand-mère, il a été frappé par sa conceptualisation de Johannesburg comme d’une entité monstrueuse qui « engloutissait » ses enfants. Dans le même temps, il s’est rendu compte que les habitants de Thokoza parlaient rarement de la ville comme de leur « chez-soi ». Quand quelqu’un demandait à Sobekwa d’où il venait, il voulait dire d’où venait son clan ancestral. C’est ainsi que les gens ont résisté à se laisser engloutir, entièrement digérés par une ville qui représentait la misère, le travail et peu de plaisir autrement que par des mécanismes d’évasion.
Le retour à Tsomo retrace les tentatives exploratoires de Sobekwa pour imaginer ce que cela pourrait signifier d’appartenir. En retraçant la lignée de son clan, uMthimkhulu (clan du Grand Arbre), et où leurs voyages ont pu les mener, il retrace les fragmentations créées par la fiscalité coloniale et l’expropriation des terres, par les processus d’extraction minière pour lesquels l’aménagement spatial de l’apartheid a été conçu. . C’est une manière de ramener les disparus dans leur foyer, de reconstituer une famille fragmentée.
La terre, telle que photographiée par Sobekwa, porte en elle le romantisme que d’autres photographes avant lui ont recherché et imagé. Ce qui me semble différent, c’est que les personnages présents dans ses paysages sont des personnes et non des romans décoratifs.
Réinventer la tradition
Bien que la tradition documentaire ait une longue histoire en Afrique du Sud, elle a été associée à la capacité perçue de la photographie à témoigner et à dénoncer les injustices , incitant peut-être le public à exiger un changement. Son potentiel en tant que support créatif est rarement reconnu.
Une telle reconnaissance, dit Sobekwa, permet à la nouvelle génération d’espoirs photographes de Of Soul and Joy d’imaginer qu’il est possible, pour eux aussi, de trouver des moyens de raconter tout ce qui est inexprimé et inexprimable, de rentrer chez eux.
Neelika Jayawardane
Professeur agrégé d’anglais, Université d’État de New York Oswego