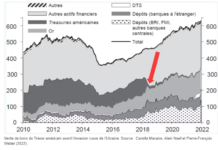À mesure que s’achève l’année 2025, et dans les jours qui en prolongent la résonance, les échanges se densifient selon une cadence devenue presque réflexe. Les appels affluent, les messages se succèdent, ravivant des liens maintenus à distance et des formes d’attention dont la sincérité, parfois, persiste. Lorsqu’ils émanent de la RDC, espace social traversé par la rareté et l’instabilité, cette circulation en apparence anodine se charge plus souvent d’une attente d’un autre ordre, celle d’une reconnaissance sociale transitoire, mise en scène dans la fête, le paraître et la fiction fragile d’un « bon vivre » suspendu. Dans un pays désigné l’an dernier comme le principal foyer mondial de l’extrême pauvreté, la majorité de ces appels ne poursuit alors rien de plus qu’un objectif immédiat, l’obtention d’un transfert permettant d’acheter une soirée, une présence, une visibilité sans lendemain.
Lorsque l’appel ou le message émane d’un membre de la diaspora congolo-américaine, une interrogation s’impose presque d’elle-même au fil de l’échange. Je leur demande s’ils mesurent la place singulière que leur confère l’accord de partenariat stratégique récemment conclu entre la RDC et les États-Unis. La question demeure sans prise. Non par désaccord, mais par défaut de perception. L’accord reste appréhendé comme une affaire d’États, lointaine et abstraite, sans traduction tangible dans l’expérience diasporique immédiate, encore largement enfermée dans l’horizon court du transfert ponctuel et de la reconnaissance fugace.
Ce flottement renvoie à une économie morale ancienne, patiemment construite au fil des décennies. La diaspora congolaise a été pensée, et a fini par se penser elle-même, avant tout comme un canal de transferts de fonds, un prolongement financier des familles restées au pays, un mécanisme privé de compensation des insuffisances publiques. Elle n’est que rarement envisagée comme un réservoir d’expertises, de compétences professionnelles, de savoir-faire institutionnels ou de capital organisationnel accumulés dans les sociétés d’accueil. Cette réduction n’est pas neutre. Elle enferme l’engagement diasporique dans une fonction strictement financière et prive l’action collective de toute projection stratégique. Dans un tel cadre, un accord de portée stratégique ne peut être saisi comme une ouverture de champ. Il demeure un texte lointain, sans traduction opératoire, incapable de susciter une mobilisation qui dépasserait la logique, désormais intériorisée, des seuls transferts de fonds.
L’État congolais et ses représentations diplomatiques semblent enfermés dans cette même lecture appauvrie. Le discours officiel se concentre sur la scène intérieure, cherchant à justifier l’accord auprès de la population nationale, à en défendre les promesses et les équilibres. À l’extérieur, et notamment là où se concentre une partie décisive de la diaspora congolo-américaine, le propos reste indifférencié. Les ambassades, à Washington comme à New York, peinent à donner sens à ce qui fait la nature profonde de cet accord. Il en résulte une situation paradoxale où un instrument conçu pour organiser des circulations demeure sans circulation réelle, comme si la clé même de son activation échappait à ceux qui en ont la charge, non par dissimulation, mais par défaut de pensée.
Un dispositif explicitement favorable aux citoyens américains
L’annexe relative aux critères d’éligibilité des projets stratégiques ne laisse place à aucune ambiguïté quant à la philosophie qui structure l’accord. Tout projet qualifié doit non seulement servir les objectifs formels de l’accord, mais aussi les intérêts de sécurité nationale des parties. Cette double exigence situe d’emblée le dispositif hors d’une logique de marché neutre. L’éligibilité n’est pas définie par la seule viabilité économique ou par la contribution au développement local, mais par l’alignement explicite avec des considérations stratégiques. Dès l’entrée, l’accord affirme ainsi que l’investissement n’est pas un espace ouvert, mais un champ ordonné par des priorités étatiques.
Le cœur de cette architecture réside dans les règles de propriété et de contrôle. La norme implicite est claire. Un projet n’est pleinement légitime que s’il est majoritairement détenu par des personnes américaines, ou à défaut, placé sous leur contrôle effectif. Même lorsque la participation américaine descend à quarante pour cent, le pouvoir décisionnel doit rester entre des mains américaines ou alignées, que ce soit par la majorité des sièges au conseil d’administration, par un droit de veto sur les décisions stratégiques, ou par la maîtrise des flux d’écoulement des minerais critiques. La propriété formelle importe, mais elle est secondaire par rapport à ce qui compte réellement dans l’économie politique des ressources, à savoir le contrôle de la gouvernance et des décisions irréversibles.
Cette préférence structurée se renforce dans le temps par un mécanisme de contraction programmée du capital non aligné. La part maximale autorisée pour les acteurs extérieurs au cercle américain ou aligné est appelée à diminuer progressivement, passant de quarante pour cent à trente, puis à vingt, jusqu’à atteindre dix pour cent à long terme. Ce calendrier n’est pas technique, il est politique. Il institue une trajectoire d’exclusion graduelle, transformant l’alignement stratégique en condition durable de participation. Certes, une clause de flexibilité permet ponctuellement d’accorder une place plus large à des acteurs non alignés, mais cette possibilité reste discrétionnaire et exceptionnelle. L’architecture d’ensemble demeure inchangée. L’accord ne se contente pas de favoriser les acteurs américains à un moment donné, il organise leur centralité dans le temps, en faisant du contrôle américain la condition normale de l’investissement stratégique.
Là où la diaspora congolo-américaine devient centrale
La diaspora congolo-américaine occupe une position institutionnelle singulière, trop souvent décrite mais rarement pensée. Juridiquement américaine, elle répond sans difficulté aux critères formels de l’accord. Culturellement et socialement congolaise, elle conserve une connaissance intime des réalités locales, de leurs contraintes comme de leurs attentes. Cette double appartenance la distingue radicalement des investisseurs étrangers classiques, dont la présence est souvent perçue comme distante, voire prédatrice. Elle n’entre ni comme force exogène ni comme acteur local marginalisé. C’est précisément dans cette zone intermédiaire, ni totalement extérieure ni pleinement intérieure, que le dispositif révèle un interstice stratégique que peu semblent avoir identifié.
Aucun autre groupe ne dispose d’un tel avantage comparatif. Les Congolais établis au pays demeurent juridiquement exclus des mécanismes centraux de l’accord, tandis que les autres diasporas, même bien dotées en capital, ne bénéficient ni de la légitimité sociale ni de la continuité historique équivalente. La diaspora congolo-américaine concentre, à elle seule, l’accès juridique, la crédibilité institutionnelle et l’ancrage culturel. Elle constitue ainsi le véritable pivot potentiel du montage, non par faveur implicite, mais par stricte cohérence avec les règles établies. Pourtant, cette centralité reste invisible, y compris à ses propres yeux. La diaspora continue de se percevoir en marge, tandis que l’accord ne lui est jamais présenté comme un espace d’action concret.
C’est ici que le paradoxe prend une gravité particulière. Probablement de manière inconsciente, de part et d’autre de la table, l’accord est structuré de telle sorte que la diaspora congolo-américaine y occupe une position objectivement centrale, tout en demeurant absente du champ explicite de la réflexion politique. Ni véritablement nommée ni institutionnellement mobilisée, elle reste une présence implicite, reconnue par l’architecture juridique mais ignorée dans sa fonction stratégique. Cet angle mort, partagé entre les représentations américaines et congolaises, ne relève ni du hasard ni d’un simple défaut de communication. Il révèle une incapacité plus profonde à penser la diaspora comme sujet économique et politique à part entière. À terme, si cette défaillance n’est pas corrigée, elle ne peut que se traduire par des pertes économiques réelles, par des projets qui voient le jour sans participation ni contrôle congolais, et par une puissance collective maintenue à l’état latent, révélant moins un manque de ressources qu’un défaut de pensée stratégique dont les Congolais, en première instance, portent la responsabilité.
Une menace structurelle sur les mécanismes de la rétrocommission
L’accord n’introduit pas seulement des critères techniques ou des règles de gouvernance. Il importe avec lui un ordre juridique extérieur, doté d’une portée extraterritoriale assumée. Les lois américaines anticorruption s’appliquent aux ressortissants et aux entreprises américaines indépendamment du lieu où les faits sont commis. La responsabilité ne s’éteint ni à la frontière ni avec la signature d’un contrat local. Elle suit l’acteur dans le temps et dans l’espace. Ce faisant, l’accord instaure une dissuasion systémique fondée non sur la vertu, mais sur la sanction. Il transforme des pratiques longtemps tolérées en risques pénaux directs, et non plus en coûts négociables. Ce cadre ne vise pas à moraliser les économies locales, mais à sécuriser des intérêts stratégiques en rendant la prédation juridiquement intenable.
Cette dissuasion verrouille de manière décisive les marges de manœuvre des membres de la diaspora congolo-américaine. Leur exposition permanente au droit pénal américain rend impraticables les arrangements opaques, les paiements dissimulés et les compromis informels qui structuraient jusqu’alors l’accès aux projets. Dans cette configuration, la diaspora ne peut servir ni de relais complaisant ni d’intermédiaire accommodant. Elle introduit de la traçabilité là où prévalait l’opacité, et de la contrainte là où s’exerçait la flexibilité informelle. Pour les acteurs dont le pouvoir repose sur la jouissance discrétionnaire des rentes et la négociation implicite des accès, ce type de partenaire devient structurellement indésirable. Le dispositif ne laisse alors subsister qu’une alternative claire, se conformer à un cadre juridique contraignant ou se tenir à l’écart des projets stratégiques.
La question qui se pose est dès lors fondamentalement politique. En choisissant de ne pas mobiliser la diaspora congolo-américaine comme levier central de mise en œuvre, l’État ne se contente pas de différer une option. Il décide, de facto, de renoncer à une part significative des gains potentiels générés par l’accord, qu’il s’agisse de retombées financières, de création de valeur locale ou de contrôle sur les chaînes de décision. Ne pas activer cet acteur juridiquement éligible, institutionnellement crédible et structurellement contraint par le droit américain revient à accepter que des projets se développent sans apport congolais substantiel, et parfois sans maîtrise réelle des arbitrages stratégiques. Ce renoncement n’est pas neutre. Il constitue un arbitrage implicite entre deux trajectoires, la poursuite d’un ordre rentier accommodant et l’entrée dans un cadre plus exigeant mais plus structurant. Ce choix ne relève ni de la technique ni de la communication. Il engage une conception de l’État, de la place de la diaspora et de la manière dont une nation entend transformer un accord international en puissance économique effective.
Le dilemme du pont
Le pont dont il est ici question n’est ni n’abstrait ni symbolique. Il est humain. Il est la diaspora congolaise elle-même. En son sein coexistent des logiques distinctes que l’on persiste pourtant à confondre. Certains retournent au pays pour contribuer, structurer, investir, forts de trajectoires professionnelles construites ailleurs et d’un capital de compétences mobilisable. D’autres y reviennent pour tirer avantage d’un système perçu comme accommodant, dans une logique d’extraction rapide, sans transformation durable. Cette distinction, pourtant déterminante, demeure rarement opérée. Les comportements des seconds sont projetés sur l’ensemble, et la diaspora se voit assignée une responsabilité collective qui neutralise toute lecture fine des intentions et des capacités.
Cette confusion est d’autant plus problématique qu’elle pourrait être dissipée sans difficulté. Les profils engagés dans la contribution sont visibles, traçables, souvent publics. Leurs parcours, leurs expertises, leur crédibilité institutionnelle peuvent être établis sans effort particulier, tant ils s’inscrivent dans des trajectoires professionnelles vérifiables. Ils incarnent une capacité d’action constructive, tournée vers l’édification, la transmission et la structuration. À l’inverse, d’autres trajectoires se caractérisent par l’absence d’ancrage, la recherche de raccourcis et la tentative de compenser des parcours inaboutis par un retour opportuniste, fondé sur l’extraction plus que sur la construction. Les premiers arrivent avec un capital à engager, les seconds avec une attente à satisfaire. Ne pas distinguer ces dynamiques revient à rendre impraticable toute politique sérieuse de mobilisation diasporique.
La situation est toutefois plus pernicieuse encore. Un acteur animé par une logique de construction peut se retrouver immergé dans un environnement dominé par des logiques prédatrices sans pour autant y adhérer. Il peut s’y adapter temporairement, en tirer un bénéfice marginal, ou au contraire s’en détourner avec dégoût et rompre tout lien avec l’espace national. Dans les deux cas, la perte pour la nation est réelle, bien que rarement perceptible. Ce capital humain découragé, détourné ou définitivement éloigné ne laisse pas de trace comptable immédiate. Il disparaît silencieusement du champ des possibles, transformant une ressource stratégique en coût invisible, supporté collectivement mais assumé par personne.
Façade ou levier stratégique
Comme tout pont, la diaspora organise des asymétries. Elle canalise des flux de compétences, de normes, de pratiques organisationnelles et de pouvoir, bien avant de produire des flux financiers. Dans l’économie politique des accords stratégiques, le capital humain précède toujours le capital financier.
Les États-Unis pourraient saisir en premier l’importance de ce pont humain que constitue la diaspora congolo-américaine dans l’économie de l’accord, et bâtir autour d’elle un dispositif intelligible, fonctionnel et avantageux, en cohérence avec leurs priorités stratégiques. Une telle configuration répondrait à une logique de sécurisation des projets et de montée en compétences locales, tout en offrant une façade politiquement utile. Elle permettrait de présenter l’accord comme un partenariat où les Congolais apparaissent en position de leadership opérationnel, même lorsque les leviers stratégiques demeurent ailleurs. La diaspora deviendrait alors à la fois un vecteur réel de transfert de savoirs, de méthodes et de standards, et un instrument de légitimation internationale, donnant à voir une conduite congolaise des projets qui rassure, communique et stabilise, sans nécessairement remettre en cause l’architecture profonde du pouvoir.
La responsabilité qui en découle demeure néanmoins congolaise. Il appartient à la RDC de décider comment ce pont doit lui servir, selon quelles règles et dans quelle direction elle entend orienter les flux qu’il rend possibles. La diaspora congolo-américaine peut être pensée comme un prolongement de la capacité étatique dans un espace juridique et économique contraint, capable de rassurer les partenaires américains, d’aligner les projets sur les critères d’éligibilité et d’en sécuriser la gouvernance dans la durée. Elle peut aussi être maintenue à distance par inertie institutionnelle ou par calcul politique. Ce choix engage une vision de l’État et de sa capacité à transformer un accord international en puissance réelle. Il n’épuise toutefois pas la question.
Il appartient également à la diaspora congolo-américaine de s’auto-activer, de se constituer en acteur lisible et structuré, et de prendre position indépendamment des hésitations étatiques. Dans ce cadre, l’inaction cesse d’être une neutralité. Elle devient, pour tous les acteurs en présence, une décision implicite.
Jo M. Sekimonyo, PhD
Économiste politique, théoricien, militant des droits humains et écrivain
Chancelier de l’Université Lumumba