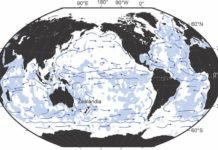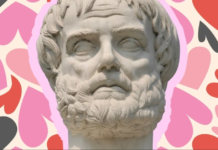Pendant trois jours, la Table ronde sur l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes a rejoué un rituel impeccablement chorégraphié qui relevait davantage du spectacle que d’un véritable travail de politique publique. Rien d’étonnant dans un pays où l’extrême pauvreté écrase la majorité et rend presque inévitables le chômage et le sous-emploi. L’événement ressemblait à une salle d’hôpital remplie de bébés en pleurs à qui l’on demande ce qui ne va pas et ce qui pourrait les apaiser. La réponse serait prévisible. Des cris pour obtenir des bonbons et des biscuits. La scène brillait, mais la réalité ne bougera pas et la douleur, elle, restera exactement là où elle était.
Cette mise en scène reposait surtout sur une fragmentation commode du problème. En réduisant la réflexion à la « jeunesse », on entretient l’illusion que les autres générations évoluent dans un marché du travail stable, comme si la crise ne touchait qu’une tranche d’âge. Cette fiction s’effondre dès qu’on regarde le pays tel qu’il est. Le sous-emploi et la précarité frappent les parents autant que les jeunes diplômés et traversent toute la vie active. Personne n’est épargné. Si les jeunes inquiètent davantage le système, c’est seulement parce que les plus âgés, usés par les défaites répétées, finissent par considérer la misère comme un destin figé. En découpant un symptôme collectif en catégories artificielles, on crée l’illusion d’agir alors qu’on détourne simplement le regard de la crise globale. Le pays manque d’emplois pour tous, et manque aussi d’opportunités permettant à chacun de préserver sa dignité en mobilisant son capital, qu’il soit financier ou humain, pas seulement à ceux que l’on étiquette comme jeunes.
En vrai, c’est quoi le taux de chômage en RDC et combien de personnes compte réellement la population du pays ? Comment peut-on prétendre réduire quelque chose dont on ne connaît même pas la véritable mesure ?
Dans un contexte aussi fragile, la participation n’a de sens que si elle repose sur des données réelles, des diagnostics solides, des contradictions assumées, des chercheurs qui structurent la réflexion et un espace où les gouvernants et les experts écoutent vraiment, prennent des notes et apprennent au lieu de se comporter en maîtres d’école. Rien de cela n’était présent. Ce n’était pas une consultation, mais un exercice sans colonne vertébrale, sans données, sans science, sans le moindre outil capable de transformer un cri collectif en politique publique réelle.
Le grand malentendu persiste malgré mes cris
Les propositions qui circulent depuis des années fabriquent une illusion d’action sans jamais toucher à la structure qui entretient la stagnation. Construire des écoles d’entrepreneuriat partout dans le pays, introduire l’entrepreneuriat dès le primaire, lancer des concours d’idées ou distribuer des passeports symboliques à ceux qui créeraient trois cents emplois peut flatter l’imaginaire national, mais rien de tout cela ne repose sur un socle économique sérieux. Cette frénésie découle d’une confusion tenace entre commerce et entrepreneuriat et d’une incompréhension flagrante du rôle réel de l’État dans la création d’emplois au sein d’un marché libre que nous prétendons avoir adopté depuis longtemps. On exige de l’État ce que seul un tissu productif solide peut accomplir, et on demande au marché des miracles institutionnels qu’il n’a ni la mission ni la capacité de produire. Ainsi chacun joue un rôle qui n’est pas le sien et personne ne génère les transformations nécessaires.
Ouvrir une boutique relève du commerce et dépend d’un fonds de commerce obtenu sous forme d’emprunt ou de crédit. L’entrepreneuriat véritable, lui, transforme une économie parce qu’il absorbe des risques technologiques, crée de l’innovation, produit des externalités de connaissance et génère des gains de productivité. L’entrepreneuriat a besoin d’un environnement qui protège le risque, d’institutions stables et d’un marché capable d’absorber l’innovation. Une économie a besoin de commerçants pour fonctionner, mais c’est l’entrepreneuriat schumpetérien qui construit les plateformes techniques et cognitives capables de sortir un pays de la pauvreté. En RDC, on célèbre pourtant des initiatives isolées comme s’il s’agissait de stratégies de développement, alors qu’elles ne créent aucun choc structurel et ne font qu’alimenter la lutte pour survivre dans un marché déjà saturé ou qui n’existe que dans l’imaginaire de ceux qui confondent pauvreté de masse et dynamisme économique.
Les travaux de Mokyr, Mazzucato et Acemoglu rappellent que la prospérité ne naît pas du volontarisme ni de l’invocation vague de l’esprit d’entreprise. Elle repose sur une architecture du savoir, sur des institutions capables de catalyser l’innovation et sur des stratégies publiques qui transforment les idées en valeur. Elle exige des mécanismes qui sécurisent le risque tout en encourageant l’accumulation de capital cognitif. La Table ronde, elle, a célébré l’entrepreneuriat sans aborder la productivité, l’innovation, la recherche scientifique, le capital cognitif ou la gouvernance des risques, qui en sont pourtant les fondations indispensables. On aurait dit une assemblée de malades obligés de s’auto-diagnostiquer et de s’auto-médicamenter, comme si la méthode pouvait produire une guérison.
Dans un pays qui prendrait son avenir au sérieux, la discussion porterait sur des leviers concrets. Les étudiants et doctorants recevraient de véritables bourses de recherche. La recherche et le développement seraient financés de manière stable. Les laboratoires universitaires seraient équipés et connectés à l’industrie. Les chercheurs collaboreraient avec les entreprises pour transférer les connaissances vers le terrain productif. Des fonds d’innovation compétitifs soutiendraient les projets technologiques. Les incubateurs seraient adossés aux universités. Des infrastructures technologiques nationales existeraient enfin. La propriété intellectuelle serait protégée et encouragée. La fiscalité récompenserait l’innovation plutôt que la rente.
Dans ce vide structurel, les jeunes présents ont préféré concocter et avaler des slogans, comme si la récitation d’intentions pouvait remplacer une politique économique digne de ce nom. Pourtant, la réalité exige des écosystèmes de savoir, des institutions crédibles et une vision lucide du capital cognitif comme moteur central de la croissance.
Ce que le Président aurait dû annoncer tout en ôtant la sucette de la bouche de Wameso
Au lieu de sponsoriser et de se féliciter de ce cirque politique, le Président aurait dû inviter la jeunesse auprès de lui pour exposer ce que l’État entend réellement accomplir. Ce moment devait être un tournant, non une célébration vide. Il devait présenter une politique industrielle moderne, structurée et ambitieuse, une vision capable de dépasser son propre mandat qui s’achève en 2028. C’est seulement après avoir posé cette architecture économique qu’il aurait pu annoncer un nouveau mandat pour la Banque Centrale du Congo, un mandat élargi qui associe la stabilité monétaire au plein emploi, à la modernisation financière et à la construction d’un véritable écosystème de production nationale.
D’ailleurs, le Gouverneur de la Banque Centrale, visiblement blasé après avoir trituré le taux de change du franc congolais face au dollar, s’est contenté d’organiser une retraite à Kisangani pour son équipe, comme si changer de décor suffisait à changer de stratégie. L’image est pathétique : déplacer une poule dans un autre poulailler en espérant qu’elle se mette soudain à pondre autre chose que des œufs. Et au lieu de solutions, la résolution clé de la Table ronde se réduit à une chanson mal inspirée en l’honneur du franc congolais, comme si une mélodie ratée suffisait à redonner appétit pour une monnaie que l’on a cessé de rendre crédible.
Un mandat rénové et modernisé va mettre fin à la tentation de Wameso de manipuler les leviers monétaires comme un enfant qui s’amuse dans un magasin de jouets, en obligeant enfin la BCC à se consacrer à la reconstruction méthodique de l’appétit pour le franc congolais par la maîtrise de mécanismes complexes ; cela commence par la dédollarisation du secteur public, se poursuit par la « congolisante » des paiements officiels et transforme la Banque Centrale en véritable ossature d’infrastructures nationales de paiement, capables d’offrir aux entrepreneurs congolais l’espace nécessaire pour concevoir leurs propres technologies, se concurrencer librement et faire émerger des systèmes robustes et efficaces. Une BCC modernisée devra également numériser intégralement les paiements administratifs en autorisant chaque service public à choisir librement son prestataire congolais, créant ainsi un marché dynamique pour les entrepreneurs de toutes générations et favorisant une convergence naturelle entre les plateformes de paiement imaginées, développées et gouvernées par des Congolais eux-mêmes.
La BCC devra aussi jeter les bases d’un véritable marché financier en franc congolais en tirant enfin les leçons des dérives de John Law ; l’émission d’obligations hybrides, dont le principal serait garanti en devises tandis que les intérêts seraient payés en monnaie locale, permettra de capter l’épargne nationale et de rétablir la confiance dans la monnaie du pays. Elle devra également instaurer un mécanisme de titrisation en créant une institution chargée de racheter les prêts immobiliers en francs congolais, de les regrouper et d’émettre des titres adossés à ces portefeuilles, titres ensuite absorbés par la Banque centrale, selon un modèle qui a fait ses preuves dans les économies avancées pour élargir l’accès au crédit immobilier, fluidifier la circulation du capital et accélérer l’accumulation de richesse domestique.
Et surtout, une véritable réforme va exiger la création d’un Centre national de recherche monétaire et financière capable de publier deux fois par an des analyses scientifiques, de lancer des appels à travaux et d’organiser une conférence internationale réunissant économistes, technologues, historiens du progrès et innovateurs, afin d’installer enfin une culture économique fondée sur la preuve et de conférer à la BCC une légitimité intellectuelle nouvelle ; car ce que je propose ici est à mille lieues des apprentis sorciers persuadés qu’il suffit d’ordonner un changement de comportement, il s’agit plutôt de raviver l’appétit pour le franc congolais en créant des conditions structurelles qui stimulent la croissance des économies locales et encouragent une créativité moderne réellement capable de diffuser la prospérité.
Mythologisation de la présomption de savoir
Les Congolais ont besoin d’un État qui comprenne ce qu’est réellement une transformation économique et qui soit enfin capable de créer les conditions qui la rendent possible. Le problème congolais n’est pas seulement technique, il est profondément culturel. Le Président ne manifeste aucun signe d’une volonté de gouverner en s’appuyant sur la recherche. Il ne sollicite ni diagnostics rigoureux, ni pensée scientifique, et ses initiatives laissent clairement entendre que, pour lui, la science est davantage une gêne qu’une force, comme si s’informer équivalait à céder une part de son autorité. Cette posture nourrit l’illusion dangereuse selon laquelle l’intuition d’un dirigeant pourrait remplacer le travail patient, cumulatif et collectif d’une nation entière.
La responsabilité ne repose cependant pas uniquement sur les dirigeants et les entrepreneurs politiques. L’intelligentsia congolaise porte aussi sa part de défaillance. Au lieu d’assumer son rôle critique, elle préfère flatter le pouvoir et laisse prospérer, dans l’imaginaire collectif, une armée de nains intellectuels qui se réfugient dans des slogans creux. Cette complicité silencieuse, renforcée par les médias et les institutions religieuses aka les marchands d’opium des masses, érode la crédibilité du savoir et installe une culture où même les diplômés universitaires apprennent à mépriser l’exigence scientifique. Le pays se retrouve ainsi amputé de ses propres sentinelles, celles qui auraient dû alerter, corriger, éclairer et inspirer.
Privée de ses vigies intellectuelles, la nation improvise là où d’autres planifient et modélisent. Elle confond réaction et politique publique, remplace la science par la spontanéité et transforme chaque occasion fondatrice en rendez-vous manqué. Elle parle d’avenir mais refuse les mécanismes qui permettent de le penser, multiplie les cérémonies mais ignore les institutions du savoir, réclame la prospérité mais néglige les outils qui la produisent. Aucune nation ne s’est modernisée en marginalisant ses penseurs. La RDC possède un potentiel immense, mais il lui manque encore l’art de transformer l’intelligence collective en progrès concret. Cela se voit dans le fait qu’au 21ᵉ siècle nous continuons à nous massacrer au nom du développement, du partage du pouvoir ou de revendications tribales grimées en idéologie, tandis que l’État dépense des milliards pour apprendre à des jeunes Congolais comment tuer un autre Congolais et n’accorde ni aux jeunes ni aux esprits mûrs les bourses de recherche ni les écosystèmes nécessaires pour résoudre l’énigme pourtant urgente de la modernisation réelle et mesurable du standard de vie national.
La modernisation ne naîtra ni des discours, ni des cérémonies, ni des concours symboliques qui ne font qu’entretenir l’illusion de l’action. Elle commencera le jour où la nation célébrera la science, où l’État sera tenu d’étayer ses décisions par des analyses solides avant de les mettre en œuvre, où les élites accepteront la contradiction, et surtout le jour où les Congolais refuseront d’être convoqués pour applaudir et exigeront d’être appelés à raisonner, contester et contribuer à une démarche rigoureuse et crédible plutôt qu’à un exercice de pensée collective pour la forme. Tant que ce désir profond manquera, nous continuerons de nous émerveiller devant des scènes brillantes tandis que notre réalité restera immobile, figée comme une porte verrouillée. Tant que nous persistons, sans même en rougir, à applaudir l’ethnocratie sans gêne, nos propres défaillances et cette manière stupide de célébrer ce qui nous détruit au lieu de dénoncer ce qui nous retient au sol, nous continuerons de confondre notre déclin avec un destin plutôt qu’avec une faute collective que nous pouvons encore corriger.
Jo M. Sekimonyo, PhD
Économiste politique, théoricien, militant des droits humains, écrivain et chancelier de l’Université Lumumba