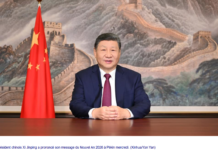L’inauguration officielle du Grand Barrage de la Renaissance en Éthiopie, en septembre 2025, a fait le tour du monde. Le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique a été inauguré en grande pompe après 14 ans de travaux et 5 milliards de dollars américains .
L’achèvement du projet concrétise un rêve national mûri depuis longtemps. Il a été officiellement lancé par feu Meles Zenawi, président de l’Éthiopie de 1991 à 1995 et Premier ministre de 1995 jusqu’à sa mort en 2012. Mais l’idée d’un barrage sur le Nil éthiopien remonte à bien plus loin. Dès les années 1950, l’empereur Haïlé Sélassié avait reconnu le potentiel d’un barrage pour le développement de l’Éthiopie.
Cette vision a occupé l’imaginaire national éthiopien depuis lors. C’est pourquoi les Éthiopiens ont célébré son inauguration comme une réalisation nationale majeure. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué le barrage comme une « opportunité partagée » pour la région, qui devrait bénéficier des exportations excédentaires d’électricité. L’inauguration du barrage a également été célébrée par des défilés dans les rues du pays.
L’achèvement du barrage constitue une avancée majeure. En tant que source d’énergie hydroélectrique, il devrait offrir des avantages concrets , notamment l’approvisionnement en électricité d’un grand nombre d’Éthiopiens. Plus encore, il sert également à galvaniser la fierté et l’unité nationales .
En tant que spécialiste de la politique africaine et intéressé par l’Éthiopie et la Corne de l’Afrique, mon travail s’est concentré sur les défis de la construction de l’unité nationale et de l’inclusion en Éthiopie .
Il n’est pas surprenant que le gouvernement ait saisi cette occasion . La fierté et l’unité nationales ont été faibles en Éthiopie ces dernières années.
La quête de cohésion nationale a occupé les bâtisseurs de l’État éthiopien, depuis l’ époque impériale jusqu’à nos jours . Les tentatives précédentes se sont toutefois révélées largement symboliques, avec un pouvoir transformateur limité.
Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne risque de suivre le même schéma. Son inauguration intervient au lendemain d’un conflit largement non résolu au Tigré, dans un contexte de fragmentation politique intense et de guerres civiles persistantes en Éthiopie. À la fin de la guerre avec le Tigré, d’autres ont éclaté dans différentes régions du pays, notamment dans les régions d’Amhara et d’Oromo .
Une unité nationale insaisissable
L’Éthiopie est un pays diversifié de plus de 120 millions d’habitants. Elle comprend de multiples groupes ethniques, linguistiques et religieux.
Plus de 80 langues sont parlées, l’amharique étant la lingua franca. Les groupes ethniques les plus nombreux correspondent aux langues les plus parlées : l’oromiffa, l’amharique, le tigrinya et le somali.
Depuis la fin du XIXe siècle, divers dirigeants ont tenté de construire une nation parallèlement à l’État. Un État naît de la définition de frontières et de la reconnaissance internationale. La construction d’une nation est différente . Il s’agit du processus d’instauration d’un sentiment d’identité et d’un objectif communs parmi les habitants d’un État. Ce processus a été violemment contesté et tendu dans l’histoire politique éthiopienne.
Les conséquences de cette histoire controversée peuvent surgir aux endroits les plus inattendus. Par exemple, l’inauguration du barrage était prévue pour le mois de Meskerem (septembre), quelques jours avant le Nouvel An éthiopien – Enkutatash – célébré le 11 septembre. Cette fête est un événement majeur du calendrier éthiopien et est généralement marquée par des célébrations nationales.
Cependant, cette fête est profondément ancrée dans les traditions orthodoxes éthiopiennes. Elle revêt une forte symbolique pour au moins un groupe particulier : les chrétiens orthodoxes éthiopiens, qui représentent un peu plus de 43 % de la population. Mais d’autres ont pu se sentir exclus par ce choix.
Cela n’a pas dissuadé ceux qui sont au pouvoir, tout au long de l’histoire, d’utiliser de tels événements et occasions symboliques pour favoriser un sentiment d’unité nationale.
Nationalisme symbolique
Le régime impérial de Hailé Sélassié déploya des efforts concertés pour unifier la nation après l’occupation italienne de 1935. À cette époque, la souveraineté de l’État était compromise , certaines régions du pays étant encore sous occupation étrangère. Le pays était divisé entre ceux qui résistaient à l’occupation et ceux qui collaboraient avec les Italiens.
Pour consolider sa légitimité et son unité, l’empereur s’est tourné vers les efforts héroïques de la résistance patriotique contre l’occupation italienne, source de fierté nationale. Il a également engagé une politique de modernisation de l’État. L’un des événements marquants de cette période fut la création d’Ethiopian Airlines en 1945.
La compagnie aérienne a connu un grand succès et a été rentable. Elle a contribué à renforcer la marque Ethiopian. Cependant, elle n’a visiblement pas permis d’assurer l’unité nationale à long terme ni d’empêcher les violences politiques en Éthiopie.
Le gouvernement d’après 1991 a également eu recours à des symboles et des événements pour promouvoir l’unité nationale. Face aux inquiétudes croissantes quant à l’orientation du pays par la coalition au pouvoir, le gouvernement a organisé, à l’approche de l’an 2007 (2000 selon le calendrier éthiopien), les célébrations du millénaire. Celles-ci ont captivé l’imagination nationale et offert un répit temporaire aux tensions politiques. D’ailleurs, le nom initial du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne était « Barrage du Millénaire » .
Ces tentatives symboliques n’ont eu pour effet que d’attiser la fierté nationale de courte durée. Elles ont également détourné l’attention des défis structurels auxquels le pays est confronté.
Ce qui est nécessaire pour parvenir à une unité nationale à long terme
L’Éthiopie doit s’attaquer aux problèmes profondément ancrés d’inégalités et aux griefs historiques et contemporains d’exclusion et de marginalisation. Ce sont les principaux moteurs des cycles récurrents de violence politique. Le pays doit mener des discussions franches, dans des espaces non partisans.
Le dialogue national actuellement en cours constitue un bon point de départ. Lancé en 2022, ce processus vise à répondre aux principales questions nationales soulevées, en partie, par la guerre désastreuse du Tigré. Il vise à créer les conditions propices à un consensus national sur les causes profondes des divisions dans le pays.
Les dialogues nationaux sont des outils utiles , utilisés dans divers contextes nationaux pour transformer les conflits et résoudre les conflits internes. Ils peuvent produire des résultats positifs s’ils sont inclusifs et assortis de plans de mise en œuvre clairs.
On craint cependant que le dialogue soit compromis par le gouvernement éthiopien, notamment dans la perspective des élections de 2026. Le gouvernement pourrait utiliser le dialogue national pour faire avancer sa position et se présenter sous un jour positif par rapport à ses opposants politiques.
Si le Dialogue national échoue à atteindre ses objectifs, il appartiendra aux différentes communautés éthiopiennes d’organiser leurs propres plateformes non partisanes pour mener ces discussions nationales urgentes. Elles devront alors parvenir à un consensus sur les principaux sujets de préoccupation nationale et rechercher collectivement des solutions. Ce faisant, les Éthiopiens auront franchi des étapes importantes vers la construction nationale.
Namhla Thando Matshanda
Professeur associé, Département des sciences politiques, Université de Pretoria