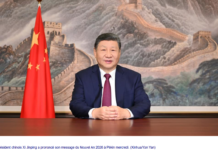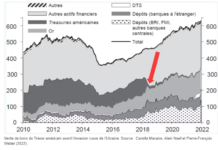C’est la grande question qui plane sur la campagne présidentielle de Kamala Harris depuis le début : les États-Unis sont-ils prêts à avoir une femme noire à la présidence ? On me pose cette question presque à chaque fois que je parle de politique américaine. C’est une question que les experts, les observateurs et les commentateurs ne cessent de poser , sans jamais trouver de réponse.
C’est parce que la question est, en fin de compte, sans réponse. Elle est tellement chargée que pour y répondre, il faut trop d’histoire, de connaissances culturelles, de jugement et de spéculation.
Bien que la question fasse allusion au racisme et au sexisme profondément enracinés dans les structures de la politique et de la culture américaines, elle n’aborde pas directement ces sujets, laissant sans réponse les hypothèses sur le degré de sexisme et de racisme du pays.
Se demander si l’Amérique est « prête » suppose également que l’histoire est un progrès, que les choses avancent de manière relativement linéaire. Cela suppose que par le passé, l’Amérique n’était pas prête à avoir une femme noire à la présidence, mais qu’à un moment donné, elle le sera peut-être. Cela suppose, comme l’a si bien dit Martin Luther King junior , que « l’arc de l’univers moral est long, mais qu’il penche vers la justice ».
Comme une grande partie des enseignements du roi, cette idée a été transformée en une hypothèse selon laquelle le « progrès » est inévitable – que les femmes et les personnes de couleur finiront par obtenir une représentation et un traitement égaux à mesure que la société apprendra, progressivement, à devenir plus juste, plus tolérante et plus tolérante.
Elle part du principe qu’un jour, les États-Unis seront à la hauteur de leur propre idéal fondateur selon lequel « tous les hommes sont créés égaux ».
Mais comme l’a dit Harris elle-même, les États-Unis n’ont pas toujours été à la hauteur de leurs propres idéaux. Les progrès en matière d’égalité – notamment en ce qui concerne l’extension de cette égalité au-delà des hommes blancs identifiés à l’origine dans la Constitution – ont été inégaux et désespérément lents. Ils ont également été entachés par la violence et même par la guerre.
L’histoire n’est pas une marche en avant. Elle ne « progresse » pas vers un idéalisme final. Elle est, le plus souvent, un combat.
Êtes-vous prêt pour cela ?
De nombreux autres pays ont montré qu’il était possible d’être « prêts » à accueillir une femme à leur tête à différents moments de leur histoire, pour ensuite à nouveau se retrouver dans une situation où ils n’étaient pas prêts.
L’Inde, la plus grande démocratie du monde, a élu Indira Gandhi au poste de Premier ministre en 1966. Gandhi a occupé ce poste pendant plus d’une décennie, puis de 1980 à 1984, date à laquelle elle a été assassinée. Depuis, tous les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir ont été des hommes.
De même, le Royaume-Uni a élu sa première femme Premier ministre, Margaret Thatcher, en 1979. Après la démission de Thatcher en 1990, le Royaume-Uni n’a pas eu d’autre femme à sa tête jusqu’à Theresa May de 2016 à 2019, puis Liz Truss en 2022 (et cela ne s’est pas vraiment bien passé).
En Australie, Julia Gillard a remporté une élection très serrée pour devenir Premier ministre en 2010, mais elle a perdu face à un homme quatre ans plus tard. Rien n’indique vraiment qu’une femme, et encore moins une femme de couleur, puisse accéder à la tête de l’un ou l’autre des principaux partis au cours de la décennie qui a suivi. Et l’Australie pourrait-elle être définitivement considérée comme « prête » à accueillir une femme à la tête du pays à cette époque, compte tenu de la manière dont Gillard a été traitée pendant son mandat de Premier ministre ?
Le célèbre discours sur la misogynie de Julia Gillard en 2012
La Nouvelle-Zélande a un bilan plus positif. Jenny Shipley est devenue la première femme Premier ministre en 1997, devançant le chef du gouvernement de coalition. Helen Clark a ensuite été la première femme à être élue Premier ministre en 1999, suivie par Jacinda Ardern près de deux décennies plus tard, en 2017.
Si la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et l’Australie présentent certaines similitudes politiques et culturelles avec les États-Unis, leurs structures politiques sont différentes. Contrairement aux États-Unis, leurs dirigeants ne sont pas directement élus, ce qui fait que l’identité spécifique du dirigeant n’est pas au centre des élections.
D’autres pays ayant adopté des élections directes ont également été « prêts » à accueillir des femmes à leur tête à un moment ou à un autre. En 1980, l’Islande est devenue le premier pays au monde à élire directement une femme à la présidence. Vigdís Finnbogadóttir a occupé ce poste pendant 16 ans. L’Irlande, pays profondément conservateur, était également prête à accueillir des femmes à sa présidence il y a trente ans, en élisant directement sa première femme présidente, Mary Robinson, en 1990.
Inégalités structurelles
Pour la plupart, ces femmes sont des exceptions à l’inégalité structurelle et profondément ancrée entre les sexes en politique à travers le monde – même si cette réalité se reflète de manière plus flagrante dans l’expérience américaine.
Le fait que la question de la « préparation » reste si importante reflète la réalité fondamentale de la représentation inégale des femmes, en particulier des femmes noires et des femmes de couleur, non seulement en Amérique mais dans la plupart des démocraties.
En juin de cette année, ONU Femmes a constaté que seulement 27 pays avaient actuellement des femmes à leur tête. Elle a déclaré :
Au rythme actuel, l’égalité des sexes aux plus hautes fonctions du pouvoir ne sera pas atteinte avant 130 ans.
L’idée d’un « taux » de progrès suppose une fois de plus que le monde sera prêt à accueillir des femmes dirigeantes un jour (même si ce jour peut prendre plus d’un siècle).
Sans surprise, les mêmes inégalités structurelles se retrouvent aux échelons les plus élevés. ONU Femmes a recensé seulement 15 pays où les femmes occupent au moins 50 % des postes ministériels. Et lorsque des femmes accèdent à des postes de direction, c’est souvent dans des domaines traditionnellement considérés comme des questions « féminines » ou « minoritaires », comme les services sociaux ou les affaires autochtones.
Cette tendance générale se reflète également aux États-Unis. Après les dernières élections, le Congrès compte un « nombre record » de femmes. Pourtant, ce chiffre n’est encore que de 28 %.
De même, en Australie, une étude menée par l’Australia Institute a révélé que les femmes sont sous-représentées dans sept des neuf parlements australiens.
Cela ne doit cependant pas remettre en cause les importantes réalisations des femmes et des personnes de couleur, qui se battent depuis longtemps pour une place à la table du pouvoir – souvent au péril de leur vie.
Selon le Pew Research Center , le Congrès américain actuel est également le plus diversifié sur le plan racial et ethnique de l’histoire, avec 133 représentants et sénateurs identifiant leur appartenance ethnique comme autre chose que blanche non hispanique.
En 2021, Harris est devenue la première femme, la première personne d’origine sud-asiatique et la première femme noire à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis. Autre étape historique : le président Joe Biden a nommé la première femme amérindienne à un poste au sein du Cabinet : la secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland .
Une étape importante a également été franchie en Australie, lorsque Linda Burney est devenue la première femme aborigène à occuper le poste de ministre des Affaires autochtones en 2022.
Armer le genre et la race
Rien de tout cela ne peut cependant confirmer ou infirmer la « volonté » des États-Unis – ou de tout autre pays – d’élire une femme noire à sa tête.
Certains signes montrent qu’une part importante de l’électorat américain n’est décidément pas prête à élever une femme, et encore moins une femme noire, au plus haut poste de pouvoir.
L’attitude des candidats républicains actuels à l’égard du genre et de la race a suscité une attention particulière, à juste titre. Le candidat à la vice-présidence JD Vance, par exemple, a fait de nombreux commentaires sur les femmes, insistant notamment sur le fait que les « femmes-chats sans enfants » ont trop de pouvoir. Donald Trump a également attaqué à plusieurs reprises les femmes avec des remarques sexistes, a fait des commentaires obscènes sur le corps des femmes et a été reconnu coupable d’agression sexuelle par un tribunal civil.
En août, le présentateur de Fox News, Jesse Watters, a suggéré que les généraux « feraient ce qu’ils veulent » avec Harris si elle était élue.
Trump, Vance et leurs substituts utilisent la race et le genre pour délégitimer leurs adversaires, suggérant qu’ils ne sont pas aptes à occuper des postes de pouvoir.
De telles attaques misogynes sont monnaie courante chez les femmes en politique. Des décennies avant que Vance n’insiste sur le fait que seules les personnes ayant des enfants biologiques ont un « enjeu » légitime dans l’avenir, un sénateur libéral australien avait suggéré que Gillard n’était pas apte à diriger le pays parce qu’elle était « délibérément stérile ».
En tant que femme noire, Harris est confrontée à des attaques à la fois sur sa race et son genre. Les personnalités de droite l’ont à plusieurs reprises rejetée en la qualifiant de candidate « DEI » (diversité, équité et inclusion), suggérant qu’elle n’a pu aller aussi loin qu’elle l’a fait grâce à un traitement spécial fondé non pas sur son mérite, mais sur son identité.
Adoptant une fois de plus une tactique perfectionnée pendant la présidence de Barack Obama, Trump a également remis en question à plusieurs reprises la légitimité de Harris en tant que vice-présidente et candidate en raison de sa race.
Le contexte est important
Il n’y a pas si longtemps, beaucoup pensaient qu’Hillary Clinton allait remporter la course et être la « première ». Lorsqu’elle a accepté la nomination présidentielle lors de la Convention nationale démocrate de 2016, elle se trouvait symboliquement sous un plafond de verre qui se brisait.
Quelques mois plus tard, ce plafond s’est rapidement reformé.
Mais même la défaite de Clinton en 2016 ne peut pas prouver de manière définitive que l’Amérique n’était « pas prête » à accueillir une femme à la présidence. Le contexte est crucial.
Même les électeurs qui seraient « prêts » à voir une femme présidente ne voteront pas pour n’importe quelle femme . Ils prendront des décisions en fonction de facteurs complexes et interdépendants, notamment les positions politiques d’une candidate.
On peut affirmer que le rôle joué par Bill et Hillary Clinton dans l’adoption des accords de libre-échange (de la supervision par Bill Clinton de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) au soutien d’Hillary Clinton au Partenariat transpacifique (TPP)) ainsi que la stagnation économique aux États-Unis ont joué un rôle bien plus important dans la défaite de Clinton que son sexe. Et sa caractérisation des électeurs aliénés comme « un panier de déplorables » n’a certainement pas aidé.
Clinton avait un lourd bagage politique après des décennies passées sous les feux des projecteurs. Les circonstances politiques, économiques et historiques de la campagne présidentielle de 2016 – ainsi que l’ascension politique de Trump – sont impossibles à décortiquer.
De même, si certains Britanniques ont peut-être voté pour Thatcher parce qu’elle était une femme, beaucoup ont également voté pour elle en raison de ses positions politiques conservatrices, ou peut-être parce qu’ils désapprouvaient davantage ses adversaires.
Des décennies plus tard, et à des années-lumière de la politique, Harris subit la pression d’une partie importante de la base de son propre parti pour modifier sa position sur Israël. Il s’agit d’un problème politique grave et urgent qui n’a rien à voir avec sa race ou son sexe, mais tout à voir avec les visions concurrentes du rôle des États-Unis dans le monde. Et cela aura un impact sur les décisions de nombreux électeurs en novembre.
En d’autres termes, on ne peut pas affirmer de manière définitive que Clinton a perdu en 2016 parce que l’Amérique n’était « pas prête » à accueillir une femme. Ou que les circonstances ont suffisamment changé pour que le pays puisse être considéré comme prêt désormais.
Dans un contexte différent, avec un candidat différent et un programme politique différent, l’Amérique aurait très bien pu être « prête » en 2016. Une autre femme – comme, par exemple, la très populaire Michelle Obama – aurait très bien pu battre Trump. Ou pas. Nous n’avons tout simplement aucun moyen de le savoir.
Et même si c’était le cas, nous ne pourrions toujours pas savoir si l’Amérique était définitivement « prête » à accueillir une femme noire à sa tête.
Les « premières » de Kamala Harris
Pourtant, lors de la Convention nationale démocrate de cette année à Chicago, Hillary Clinton a évoqué la possibilité de « premières » et le progrès de l’histoire américaine. Elle a proclamé qu’un « avenir où nos rêves ne connaîtront plus de limites » était enfin arrivé.
Harris, elle aussi, se concentre sur l’avenir – mais pas sur ses « premières fois ».
Lors de sa première interview avec les médias depuis qu’elle est devenue candidate démocrate, elle a par exemple écarté une question sur l’importance accordée par Trump à sa couleur de peau. Son équipe de campagne a réussi à qualifier de « bizarre » toute attention particulière portée au genre ou à la race – et en particulier au corps des femmes.
De cette façon, la campagne de Harris a clairement réorienté le débat politique vers Trump et Vance. Sa campagne met en avant un type de masculinité très différent , qui se sent parfaitement à l’aise avec les femmes noires occupant des postes de direction.
La campagne de Harris renforce ce cadre en se concentrant non pas sur les « premières » individuelles, mais sur les inégalités structurelles de genre et de race et sur les droits fondamentaux des femmes à l’autonomie corporelle. De cette façon, la campagne adopte un féminisme collectif, plutôt qu’un féminisme individualiste des « femmes blanches » des années 1990, plus proche de Clinton. Kamala est, après tout, une gamine .
La campagne de Harris évite explicitement la tentation de la superficialité de la politique identitaire, tirant les leçons d’une campagne Clinton souvent tendue qui semblait supposer que les Américains voteraient pour elle précisément parce qu’elle était une femme, ou parce qu’il était temps que l’Amérique élise enfin une femme présidente.
Tout cela est, du moins implicitement, une reconnaissance du fait que la « préparation » n’est pas une question simple à laquelle il est possible de répondre de manière simple. La campagne de Harris reconnaît qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une question de « préparation » collective, mais d’une question de mobilisation et d’inspiration d’un nombre suffisant d’Américains déjà prêts.
Comme Biden l’a répété à plusieurs reprises , « les femmes ne sont pas dépourvues de pouvoir électoral ou politique ». Selon une analyse , au cours des quatre années écoulées depuis 2020, l’inscription des femmes noires sur les listes électorales a augmenté de 98,4 %. Chez les jeunes femmes noires, elle a augmenté de 175,8 %.
Les femmes noires américaines sont clairement prêtes pour ce moment.
La question n’a pas de réponse
Si Harris est élue en novembre prochain, beaucoup y verront la preuve qu’un seuil a été franchi, que l’Amérique était effectivement collectivement « prête » à être dirigée par une femme noire. Et cela pourrait être vrai. Jusqu’à un certain point.
Les États-Unis se sont montrés autrefois « prêts » à élire leur premier président catholique. En 2008, ils se sont montrés « prêts » à élire le premier président noir. Mais huit ans plus tard, dans un contrecoup historique et mondial, ils sont redevenus très loin d’être prêts .
Les divisions politiques américaines sont profondes et structurelles. Elles n’ont pas été résolues depuis la fondation du pays. L’élection de la première femme noire serait d’une importance capitale, une avancée historique remarquable dans une campagne qui a déjà été extraordinaire.
Mais la question de savoir si l’Amérique est « prête » pour ce moment ne peut pas être répondue par un seul individu.
Il existe deux versions de l’Amérique : l’une qui est prête pour ce moment (et l’a toujours été), et l’autre qui ne le sera probablement jamais. Ces deux versions coexistent. Et elles sont, pour l’instant, irréconciliables .
Les deux camps savent que la victoire de novembre ne sera qu’une indication de la puissance du moment. Elle ne constituera pas une solution claire à une question vieille de plusieurs siècles sur ce que sont les États-Unis et ce qu’ils veulent être.
Ce n’est pas ainsi que fonctionne l’histoire.
Emma Shortis
Chercheur principal adjoint, École d’études mondiales, urbaines et sociales, Université RMIT