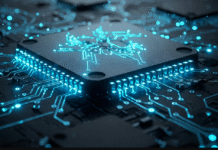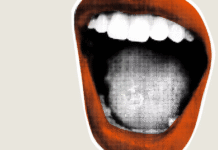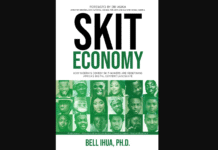Lors de sa visite officielle au Kenya , le roi Charles III a reconnu les « actes répréhensibles » de la Grande-Bretagne à l’époque coloniale. Il a également rendu hommage aux soldats kenyans qui ont participé aux première et seconde guerres mondiales au nom de la Grande-Bretagne. Sa visite a coïncidé avec le 60e anniversaire de l’indépendance du Kenya.
La domination coloniale britannique au Kenya était caractérisée par des injustices . Parmi ces mesures figurent la dépossession forcée des terres des peuples autochtones, la torture, la détention et la répression brutale des mouvements anticoloniaux.
Un extrait du discours du roi Charles est utile pour décrypter la valeur et les implications de ses excuses, du point de vue du droit international :
Les actes répréhensibles du passé sont la cause de la plus grande tristesse et des plus profonds regrets. Des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis contre les Kenyans alors qu’ils menaient, comme vous l’avez dit aux Nations Unies, une lutte douloureuse pour l’indépendance et la souveraineté – et il ne peut y avoir aucune excuse pour cela. En revenant au Kenya, il est très important pour moi d’approfondir ma propre compréhension de ces torts et de rencontrer certains de ceux dont les vies et les communautés ont été si gravement touchées.
L’héritage de la domination coloniale est également apparent dans d’autres contextes d’Afrique de l’Est. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a récemment fait un geste similaire en Tanzanie suite à la répression brutale des mouvements anticoloniaux. En 2020, le roi Philippe de Belgique a exprimé ses regrets quant à l’héritage colonial en République démocratique du Congo.
De telles reconnaissances publiques sont-elles simplement symboliques ? Ou ont-ils le potentiel d’obtenir des réparations en vertu du droit international ?
En tant qu’universitaire et praticien du droit international et de la justice transitionnelle, j’ai travaillé (en tant que professionnel invité) au Bureau du conseil public pour les victimes de la Cour pénale internationale.
À mon avis, ces reconnaissances publiques de l’héritage colonial en Afrique de l’Est par la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la Belgique peuvent être classées dans le cadre plus large de la justice transitionnelle, par opposition aux simples relations ou politiques internationales.
La justice transitionnelle implique généralement des mesures judiciaires et non judiciaires visant à réparer les séquelles des violations des droits humains. Elle diffère de la vision traditionnelle de la justice dans la mesure où elle offre des moyens de réparer les atrocités de masse, en l’occurrence l’héritage colonial. Les mesures prises dans le cadre de la justice transitionnelle vont de la formation de commissions vérité aux poursuites pénales et aux programmes de réparation. Le processus de mémorialisation à travers les musées et les monuments est un autre outil important dans le processus de justice transitionnelle.
Les options
Le droit international des droits de l’homme fournit les normes en matière de justice transitionnelle. Il repose sur quatre piliers : les poursuites judiciaires, la révélation de la vérité (commissions vérité), les réparations et la réforme institutionnelle.
Commissions vérité : Ce sont des enquêtes quasi judiciaires temporaires. Ils sont normalement chargés par les États d’enquêter sur des actes répréhensibles antérieurs et de formuler des recommandations.
La Belgique, par exemple, a créé une commission parlementaire spéciale pour traiter de l’héritage colonial du pays. Il s’agissait du premier du genre en Europe et s’est achevé en décembre 2022. Aucune proposition concrète n’en est ressortie. Le gouvernement n’a pas montré un intérêt sérieux pour les travaux de la commission.
Poursuites pénales : Ce n’est pas une véritable option car les crimes coloniaux sont des crimes d’État. La Cour pénale internationale traite des cas d’individus et non d’États. Et il ne prend en compte que les crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut de Rome , en 2002.
Justice réparatrice : Les excuses et les mémoriaux sont des formes de réparation. Mais celles-ci sont incomplètes sans les aspects matériels comme la restitution ou l’indemnisation monétaire d’un groupe de victimes. Le droit international ne propose pas de directives spécifiques sur les réparations pour les crimes des États coloniaux.
La Grande-Bretagne pourrait s’inspirer, en matière de réparations, des articles de l’ONU sur la responsabilité des États (pour faits internationalement illicites) adoptés par la Commission du droit international en 2001. L’ONU dispose également d’un ensemble de principes de base sur les recours pour les victimes de violations des droits de l’homme.
Les réparations pour les crimes coloniaux de l’État doivent tenir pleinement compte des préjudices individuels et collectifs. Mais cela n’a jamais été fait auparavant.
Les gouvernements des anciennes colonies sont politiquement orientés vers le maintien de relations bilatérales amicales avec les puissances occidentales. Ainsi, la voix des familles des victimes des atrocités coloniales reste périphérique.
Le droit international et le cadre de justice transitionnelle repoussent les limites du symbolisme et offrent un potentiel de réparations réelles, mais favorisent également la réconciliation .
Pourquoi est-ce important
Il y a un contexte historique à cet aveu de culpabilité et à cet engagement envers le Kenya. Au cours de la dernière décennie, des groupes kenyans ont déposé au Royaume-Uni une série de demandes d’indemnisation datant de l’époque coloniale, liées à la répression brutale de l’ insurrection Mau Mau par la Grande-Bretagne . En 2013, alors que le Kenya célébrait son 50e anniversaire d’indépendance, le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé qu’il réglerait les réclamations des Kenyans concernant les événements de Mau Mau. Le gouvernement britannique a également promis de financer la construction d’un mémorial à Nairobi. Il s’agissait en grande partie d’un règlement négocié à l’amiable et non du résultat d’une enquête judiciaire.
Les récentes excuses du roi Charles III ne sont pas un événement isolé, mais plutôt le reflet des progrès réalisés par le Kenya dans sa quête de réparation.
Tonny Raymond Kirabira
Chargé d’enseignement, Université de Portsmouth